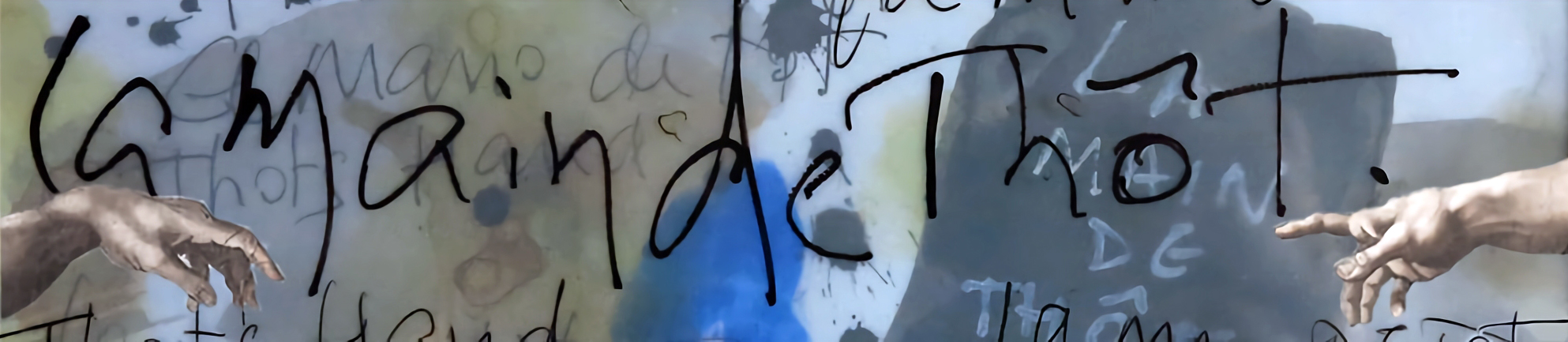Entassement de pierres au bord du chemin, providentiel repère déposé par Hermès, le dieu ingénieux qui inventa la lyre et fonda les échanges, un hermaion désigne au sens figuré « une bonne aubaine », « une heureuse trouvaille », la manifestation d’une volonté ou d’un principe transcendants venus dénouer, le plus souvent de manière inespérée, des situations complexes. Ce nom suggère à lui seul la nature d’un collectif passionné qui s’est fixé pour mission d’être un médiateur entre le monde des lettres germaniques et les aires francophones, tout en favorisant une expérience professionnelle de la traduction, littéraire et à visée éditoriale.
Fondé à l’université Toulouse Jean Jaurès en février 2014, peu avant que paraisse aux Presses universitaires du Midi la traduction d’une pièce du dramaturge Michel Decar, Waldemarwolf (DECAR, 2010)1, réalisée conjointement par des étudiants de L3 LLCE allemand et de Master CeTIM, ce jeune collectif fédère des traducteurs, des enseignants chercheurs et des étudiants, avancés et moins avancés, germanistes bien sûr, mais également philosophes ou spécialistes de l’histoire antique2, domiciliés au quatre coins de l’Europe. Leur projet commun est de traduire puis faire publier en français des œuvres modernes ou contemporaines de langue allemande, plus rarement l’inverse, même si HERMAION a également vocation à accueillir des traducteurs germanophones3.
Dans cette structure, où l’union de compétences très diverses vise aussi à garantir la plus haute qualité de rendu, les traductions peuvent être soit collectives et participatives soit collaboratives soit encore faire l’objet de révisions effectuées dans le cadre de simples échanges de service : chacun à son tour traduit, fait réviser, révise, sollicite des textes ou des conseils, que ce soit en matière de traduction ou de négociation des droits, de recherche d’éditeurs et/ou de financements.
À la fois dans l’université, au croisement de la formation et de la recherche, et hors l’université, dans sa marge du point de vue de la professionnalisation et de l’engagement, fondé sur le volontariat et la cooptation, le collectif HERMAION est une économie souple et un terrain d’expérimentations menées aussi bien sur le plan de l’organisation du travail en interne que dans les formes du traduire et de l’être ensemble. Il postule une coopération non hiérarchique entre ses membres, même s’il demeure confronté aux épineux problèmes du pilotage et du nécessaire équilibre entre reconnaissance des individus et projets communs.
Le modèle d’HERMAION et les circonstances de sa création suscitent en particulier deux questions : pourquoi, par-delà le double impératif de la formation et de la professionnalisation, des traducteurs qui peuvent désormais prétendre être reconnus comme des auteurs à part entière4, choisissent-ils de diluer leur identité au sein d’un collectif ? cette démarche est-elle plus naturelle au théâtre, où traduire suppose qu’on s’inscrive d’emblée dans un dialogue pluriel, avec l’auteur, le metteur en scène, les comédiens et les spectateurs/lecteurs ?
1. Prémisses
Rarement traitée en tant que telle dans les histoires de la traduction5, sa pratique collective ou collaborative n’en a pas moins cours depuis longtemps et dans différents territoires géoculturels, notamment pour des textes fondateurs, des œuvres capitales et denses, où les enjeux propres à la traduction croisent, voire servent, des desseins politiques au sens large, puisqu’il s’agit de propager, transmettre ou mieux connaître, des lois, une culture, une idéologie6. Les co-traducteurs conjuguent leurs forces pour traduire au mieux, mais aussi au plus vite, ces œuvres aux ramifications puissantes.
Souvent plus invisible – car moins aisément identifiable – et plus ʽsecondaireʼ encore que les autres formes de la traduction, le traduire ensemble revient par vagues, à des époques distinctes, en fonction de situations historiques et d’objets textuels déterminés7. Notre hypothèse est qu’à l’ère télématique du web participatif, il constitue une huitième saison dans la chronologie qu’esquissait Dieter Hornig en 2011 à la suite d’Umberto Eco8. Sa recrudescence via internet, à une échelle et selon des modalités technologiques sans équivalent jusqu’alors, participe d’une refonte d’à peu près toutes les pratiques traductives, y compris dans les cadres institutionnels et contrôlés, telles les universités ou l’ATLF, pour ne citer que deux exemples.
Les traducteurs exploitent au mieux les possibilités offertes par la toile. Ils appellent à la rescousse, en un clic – telle est la véritable nouveauté –, sur de nombreux forums de traduction, autorisés ou pas, spécialisés ou plus généralistes, pour résoudre des problèmes de traduction, qu’il s’agisse de référentialité – intertextualité, crypto-citations… –, ou de mise en français de termes et passages particulièrement ardus. Ils partagent des glossaires, mettent en commun leurs informations, échangent leurs méthodes et partis pris. À l’extrême de cette mutation des pratiques, on trouve ce qu’on pourrait appeler les traductions participatives de génération spontanée, quand des internautes disposant de quelque connaissance en langue traduisent en réseau, les épisodes de leur série préférée, par exemple9.
Force est de constater que la saison des « Belles infidèles », où l’adaptation, la transposition, voire la correction de l’original s’accomplit au nom d’une supériorité culturelle de la langue cible, et celle plus sourcière, léguée par les Lumières allemandes, qui génère « une véritable éthique de ʽl’hospitalité langagière’ » (HORNIG, 2011), refusant d’adapter ou de naturaliser, soucieuse de préserver l’étrangeté – au sens de caractère étranger – du texte original, ne sont plus seules depuis les années 2000 à définir « l’horizon de notre réflexion sur la traduction » (HORNIG, 2011). Marquée par le traduire ensemble, la huitième saison de la traduction s’envisagera dans cette déclinaison particulière de son caractère pluriel et utopique.
En allemand comme en français, le « collectif » (dasKollektiv) s’est progressivement substitué depuis le XIXe siècle à la « communauté » (die Gemeinschaft)qu’avaient entachée certaines dérives à différentes époques et dans différents espaces, pour créer un lien social qui ne soit pas perçu dans l’extériorité à l’individu mais voulu et vécu dans l’intériorité10 : en se concentrant sur ce qui est « commun », sur l’articulation entre le « je » et le « nous », comme horizon d’attente, le collectif propose sinon une utopie, du moins un modèle alternatif, y compris dans l’urgence qu’il pourrait y avoir à se détacher de l’un ou l’autre schèmes connus de la collectivité11. Au moyen de la traduction collective, c’est bien la création d’un lien civil et en intériorité qui est visé, en même temps que la revendication du caractère « poélitique » (CORMANN, 2012, 33-60) de la traduction. Il s’agit de trouver en même temps une nouvelle forme pour le « commun » et la traduction, de faire qu’ils adviennent en auto-organisation. Que ce soit sur le world wide web ou au sein d’un collectif comme HERMAION.
Au théâtre, le collectif est à la fois une condition a priori, une expérience sensible et une incarnation spécifique, notamment en Allemagne depuis le début du XXe siècle avec l’émergence des collectifs de théâtre socialistes comme celui d’Erwin Piscator. La dimension politique et critique caractérise également le travail théâtral du collectif tel qu’il s’organise et se radicalise à partir de 1970, autour de Peter Stein et Claus Peymann, notamment à la Schaubühne de Berlin (cf. SANDMEYER, 197312) où la performance artistique et la qualité esthétique sont déterminées par le travail intellectuel préparatoire, requièrent parfois une longue maturation, une temporalité à contre-courant (slow time) au bénéfice de l’analyse, du débat et de l’imprégnation par les textes ou les rôles.
Les formes les plus récentes du « théâtre de metteur en scène » (Regietheater), hérité des années 1960 et des collectifs ci-dessus13, privilégient une écriture de plateau, soit une écriture participative qui doit beaucoup aux programmes de lecture préalables et aux comédiens, et qu’accompagnent parfois des traducteurs. L’auteur, metteur en scène, Falk Richter, est à cet égard un exemple emblématique : traducteur de l’anglais, enfant du « monde global », friand de collaborations internationales, il n’est pas rare que ses pièces plurilingues s’écrivent conjointement dans sa langue maternelle et celle de Shakespeare, tandis que sa traductrice française, Anne Monfort, également metteure en scène, traduit dans la nuit les « corps-textes » (Textkörper) du jour (RICHTER, 2009, 121)14. Où l’on saisit la prodigieuse accélération du temps (fast time) que peut soutenir le collectif, à rebours de la philosophie affichée dans les années 1970, mais, en l’occurrence, on ne peut mieux adaptée aux mécanismes de la mondialisation et de ses modélisations high-tech.
Pareille polyvalence n’est pas rare parmi les gens de théâtre et les auteurs dramatiques sont nombreux dans l’espace germanophone à être également traducteurs de théâtre15. Un fait qui ne s’explique pas uniquement par des raisons économiques – la traduction comme béquille d’une activité scénique fluctuante ou incertaine –ou par une bouillante volonté de diffusion des œuvres. Au théâtre, écrire, traduire et mettre en scène sont intrinsèquement liés dans leur caractère translatif, voire performatif. Au croisement de plusieurs langages ou médias, ces trois pôles de cristallisation nous semblent former à parts égales le socle de ce que Flore Garcin-Marrou nomme « la pensée-théâtre »16.
Les tandems de traducteurs qui sont particulièrement nombreux au théâtre ne se contentent pas d’associer les compétences linguistiques d’un(e) francophone et d’un(e) germanophone, une combinaison qui apparaît idéale à plus d’un titre. Ainsi la traductrice Silvia Berutti-Ronelt s’attache-t-elle à traduire avec des metteurs en scène ou des auteurs de théâtre : Jean-Claude Berutti, Laurent Hatat, Anne Monfort, Pauline Sales, pour ne parler que de ses contributions à « nouvelles scènes - allemand ».AuXVIIIe siècle déjà, la dramaturgie de Gottsched s’enrichit des apports de son épouse, la traductrice Luise Kulmus-Gottsched. Plus près de nous, les remarquables traductions de Kraus par Jean-Louis Besson et Heinz Schwarzinger, de Horváth par Hélène Mauler et René Zahnd ou de Kleist et Brecht par Ruth Orthmann et Eloi Recoing démontrent l’intérêt de traduire en association, pour une mise en commun des compétences et des idées, pour leur potentiation au carré.
Dans l’équipe d’HERMAION aussi, on rencontre des duos de traducteurs : Anne Coignard et Anthony Andurand allient leurs compétences et leurs sensibilités spécifiques pour traduire une pièce inédite de Klaus Mann, Athènes (MANN, 1932)17, tandis que Sylvia Barelli-Baud et Pauline Fois s’attaquent, chacune de leur côté, à des pans complémentaires de l’œuvre abondante de Jürgen Hofmann18 encore inconnue en France. En dernier lieu, tous s’en remettent au collectif pour la discussion et la révision de leurs traductions. À l’instar des collectifs théâtraux, dans les années 1970 comme aujourd’hui, HERMAION est né d’un désir d’échange, de réflexion et de responsabilité partagées, d’un appétit de « hors-les-murs » : hors les murs de sa propre individualité et hors les murs de l’université, sur l’agora traductive. Organisé en collectif, le traduire ensemble est un biais pour créer tout à la fois de l’être et de l’espace public, tout en pratiquant l’auto-analyse et l’auto-formation. Projet à visée émancipatoire, il vient en complément de la formation universitaire. Car, si en France la traduction, désormais entrée à la faculté, est devenue « affaire d’universitaires et d’agrégés » (HORNIG, 2011), elle y demeure parfois encore suspecte de trop d’académisme et de rigidité, sinon d’amateurisme, du moins d’une tragique méconnaissance des impératifs éditoriaux.
2. Le collectif en actes
Dans le cas d’HERMAION, l’essence et les catalysations collectives du théâtre fournissent le cadre, sinon le modèle, du traduire ensemble. Le collectif se forme autour de la traduction d’une pièce destinée à la collection « nouvelles scènes - allemand »19, en lien avec le festival Universcènes20 qui en propose la représentation en version originale sur-titrée les 19 et 20 mars 2014. Certes, l’entreprise est en partie dictée par la nécessité : pallier la défection de la traductrice professionnelle qui avait repéré le texte de Michel Decar. Mais elle procède avant tout d’une envie : offrir aux étudiants l’opportunité d’un travail réellement fédératif et d’une réalisation à forte visibilité, susceptible de valoriser un CV, suivant une pratique traductive récurrente au sein du Master CeTIM, spécialement chez les hispanistes21. L’expérience paraît si féconde et motivante aux étudiants désireux de devenir traducteurs littéraires que la création du collectif s’impose vite comme un prolongement naturel et utile.
Par ce biais, au-delà de l’opération de traduction, le groupe se familiarise avec différentes facettes de la médiation culturelle. Il entre en contact avec l’éditeur allemand Rowohlt Theater Verlag pour la demande des droits, en suit la négociation avec les PUM ; il s’initie aux patients travaux de révision et de relecture, rédige la 4e de couverture, des invitations et divers supports de diffusion pour lesquels il participe également au choix des images. Un membre du collectif traduit en allemand la préface au texte, entre autres, pour permettre à l’auteur qui ne connaît pas le français de la lire. Au moment du festival, le collectif assure la médiation linguistique, en particulier lors du bord de scène après la première22. Un traducteur/spectateur inspiré23 écrit ici une recension, là un compte rendu. Hormis pour la traduction, chacun détermine sa participation à la mesure de ses moyens et de son appétence.
Quant à l’exercice de traduire proprement dit, l’objectif est de concevoir une version française de qualité, juste et inventive, qui saisisse les spécificités de la traduction théâtrale inscrite tout à la fois dans les espaces du texte, de la voix et de la scène. Recherchant dans sa traduction la matérialité et l’efficacité immédiate du signe théâtral, le collectif est placé dans la situation d’avoir à se départir de son mode habituel d’appropriation des textes et de ne plus privilégier l’analytique sur le sensible. Se pose également le problème de la méthode pratique à définir en vue de traduire ensemble pour le théâtre et d’aménager des sensibilités plurielles. Faute de temps, on répartit équitablement les passages de traduction (plus ou moins 16 000 caractères, espaces compris) entre les membres du collectif, chaque passage faisant l’objet d’au moins deux traductions. S’ensuit une méthode comparatiste et de mise en commun, tant des résultats de recherches que des traductions révisées par petits groupes – ils se constituent organiquement, selon le bon plaisir de leurs membres –, et/ou en séance plénière. Les échanges portent tout à la fois sur la traduction, l’interprétation globale de la pièce, sur des faits de langue ou de culture.
Dans la lignée des œuvres à tonalité existentielle de Lenz, alliant profondeur et traits d’esprit, Waldemarwolf raconte en six actes les tribulations d’un jeune rêveur Cornelius Krebs (Cornelius Crabe en traduction) après le décès de ses parents. Dans la grande ville, il fait l’expérience de l’inconstance et de la mécanique d’un présent « un peu monstrueux, donné à la fois comme le seul horizon possible et comme ce qui ne cesse de s’évanouir dans l’immédiateté » (DECAR, 2010, 13). Son histoire d’amour avec l’imprévisible Mine, dont le prénom évoque l’amour courtois (Minne), se tourne en amère déception lorsque Cornelius la trouve dans le lit de son colocataire Boy Hornbach, un réalisateur de films douteux. Mais le jeune homme ne parvient à se soustraire ni à cette cohabitation malsaine ni à ces mauvaises influences. Déployant ses talents d’aspirante vétérinaire, c’est finalement son ex-petite amie, mademoiselle Schneider (« la faucheuse »), qui les liquide discrètement et ramène Cornelius dans sa campagne natale, « un aquarium d’eau douce davantage à sa mesure » (DECAR, 2014, 17), loin des requins et des gros poissons de la capitale24.
Toute la pièce joue sur une ambivalence ou une dialectique subtilement comique énoncée dès les premières pages par la défunte mère du protagoniste :
Geh raus und schau dir interessante Menschen an, interessante und uninteressante. Die Interessanten sind gefährlicher wegen ihrer Beliebtheit, aber die Uninteressanten sind gut, richtig gut, weil sie eine gewisse Verlässlichkeit oder eine verlässliche Gewissheit zur Verfügung bereithalten, eine wunderschöne Endgültigkeit. (28)
Sors et regarde des personnes intéressantes. Intéressantes et inintéressantes. Celles qui sont intéressantes sont plus dangereuses à cause de leur popularité, mais celles qui sont inintéressantes sont bien, très bien même, parce qu’elles ont à t’offrir une certaine fiabilité, ou bien une fiable certitude, une magnifique irrévocabilité. (29)
L’auteur illustre ces préceptes en plaçant au centre de la pièce le personnage en apparence le plus insipide. Ainsi le lecteur/spectateur assiste-t-il à un renversement des valeurs que reflète l’évolution intérieure de Cornelius délaissant les tumultes de la ville pour une vie calme et moins superficielle. Mais un doute subsiste, car il semble terminer son parcours dans un repli sur soi tel que la solitude le dispute à l’ennui et devient inquiétante. Monologues et dialogues prêtent leur rythme singulier à l’effacement de l’espace, du sujet et du temps. « Entre les monologues des actes « UN » et « SIX », les dialogues fusent, pétris d’humour et de jeux sur les mots » (15). Les espaces/temps et les personnages se télescopent, « mais les scènes se suivent et se répondent comme si de rien n’était » : on s’y trouve embarqués« avant même d’avoir noté les changements, aiguillés d’une scène à l’autre par des échos » (15).
Au sein d’HERMAION, on saisit vite deux impératifs majeurs. Le premier a trait à la fragmentation de la pièce par la traduction – plusieurs traducteurs chargés de traduire différents passages dans des temporalités désaccordées, et des révisions différées – qu’il faut à toute force contrer. Aussi s’attache-t-on d’abord à identifier les leitmotivs qui dessinent l’ossature de l’œuvre pour en fixer la traduction, parfois à la manière d’épithètes homériques : les « caries sous les yeux » (kariöseAugenringe) de Cornelius (51, 87), la calvitie qui gagne inéluctablement (25, 125), le jeu des jambes (51, 99), les photos pour figurer l’absence de réel (25-27, 47-51, 59-61), ou encore les attraits funestes qu’incarne entre autres Mademoiselle Schneider euthanasiant Hornbach (92-99). Et surtout la trame des métaphores animales : Cornelius en invertébré cartilagineux, mollusque ou petit poisson (23, 71), devenant « petit aigle » (75) puis « oiseau de malheur » (87), Mine en moineau égaré dans la cage de gros oiseaux déplaisants (23, 65), une proie facile (51-53), rattrapée par le « crabe » (39, 102)… Le collectif décide de surenchérir sur l’univers du zoo, à chaque fois que ce sera possible, notamment pour compenser différents effets comiques parfois difficiles à rendre : on choisit de traduire un simple « Ja, natürlichistdasschoneinbisschengemeinfür die Girls »(« oui, bien sûr, c’est un peu salaud pour les nanas ») par « Oui, bien sûr, […] c’est un peu vache pour les nanas » (57), on préfère « embêter » à « énerver » pour « ärgern » (69)…
Le second impératif pour notre traduction consiste à faire entendre la musique particulière de Waldemarwolf, une sorte de miserere25 cocasse multipliant paradoxes, oxymores et chiasmes, qui assoient la structure profonde de la pièce. On se fait une règle de respecter au plus près l’équilibre et la couleur des syllabes dans les phrases allemandes, afin de trouver un rythme juste : le personnage « pas nécessairement nécessaire » (unötignötig) de Boy Hornbach devient « futilement utile », la ville est associée « aux griffures et aux déchirures » (das Gegriffenunddas Gerissen) ; Mine est « juste qualifiée de chez qualifiée et la fille la plus belle que je connaisse » (einfachdasbestqualifiziertesteundhübscheste Mädchen, dasichkenne), prétend Cornelius dont l’exagération amoureuse est dénoncée par le superlatif « bestqualifiziertest- », redoublé et bancal. Partout où c’est possible, on récupère les allitérations ou assonances qu’on a perdues ailleurs, on ʽré-injecteʼ la saveur comique. Ainsi l’image « le grand-air passera là-dessus comme un fer à repasser » (die LandluftwirdwieeinBügeleisendarüberfahren) représente-t-il une variation bouffonne sur le thème du « temps [qui] passe et repasse » (wenndasJahrkommtundgeht, litt. « quand l’année s’en revient et s’en va »). L’enjeu est de progressivement sortir de la période ternaire d’une histoire à la Jules et Jim pour retrouver la cadence binaire de la marche :
Cornelius Krebs: Alles, was gut und wertvoll ist, muss geliebt und gelitten haben, gelebt und geteilt. So ist das Leben. Alles, was gut und wertvoll ist, muss sich bewegen. Die langen Beine, wie sie schreiten, triptrap, die weichen Hüften, wie sie gleiten, die Zeiger einer Uhr, ticktack. Alles, was gut und wertvoll ist, muss geliebt und gelitten haben, gelebt und geteilt. So istdas Leben, sodrehtsich die Welt– (98)
Cornelius Crabe : Tout ce qui est bon et précieux doit avoir aimé et souffert, vécu et partagé. Ainsi va la vie. Tout ce qui est bon et précieux doit bouger. Les longues jambes, comme elles marchent, tip tap, les douces hanches, comme elles glissent, on dirait l’aiguille d’une montre, tic tac. Tout ce qui est bon et précieux doit avoir aimé et souffert, vécu et partagé. Ainsi va la vie, ainsi tourne le monde– (99)
La relecture, après deux ans, de notre version éditée, permet d’en éprouver les subtilités et la justesse. L’alliance de quinze esprits au moment de l’analyse globale du texte et de la révision collective des extraits traduits a produit du fruit : créant des zones de tension fécondes, elle a généré maintes trouvailles et d’authentiques bonheurs partagés. Mais, dans un mouvement contradictoire, les lissages et révisions ont également été l’apprentissage du renoncement et de l’effacement individuel, de sa souffrance aussi, face aux dynamiques et aux arbitrages collectifs. Et pas question de faire valoir une quelconque autorité professorale ou professionnelle !
Aujourd’hui le collectif a changé de visage. Les raisons sont diverses : outre la dimension chronophage du traduire ensemble, la difficulté de trouver des créneaux pour se rassembler, il y a les renouvellements parmi les membres d’HERMAION, leur éparpillement à travers l’Europe, leurs envies respectives, des questions complexes de légitimité et de propriété intellectuelle, ainsi qu’un appariement de plus en plus fort non seulement à des visées éditoriales mais aussi à des projets de recherche. Autant d’aspects qui font l’objet d’une observation scientifique in vivo au sein du collectif, et dont les premiers résultats ont été présentés le 13 mars 2015 lors de la journée d’études IRPALL « Traduire ensemble le théâtre ».
Le projet de traduire collectivement l’œuvre de l’auteure roumaine de langue allemande Carmen-Francesca Banciu (*1955), Berlin istmein Paris (BANCIU, 2002)26, est en suspens, principalement faute d’avoir pu trouver un éditeur ; mais trois extraits ont paru dans la revue en ligne, transdisciplinaire et transnationale, Levure Littéraire27. De même, Tristan Kuipers a mis entre parenthèses son ambitieux projet autour de Jean Gebser (1905-1973)28 pour, notamment, créer avec Beatriz Nino-Bonett la revue CARMEN29. Exception faite du projet de traduction théâtrale co-porté par Anne Coignard et Anthony Andurand à fin de mise en scène et d’édition, le collectif accompagne désormais des traductions littéraires relevant d’époques et de genres divers, associées à des travaux de Master en traductologie.
François-Xavier Ragaru se penche sur l’histoire comparée des codes gourmands au XIXe siècle en Allemagne et en France pour dégager les spécificités de la mise en français de La Gastrosophie(1851)30 du baron Eugen vonVaerst (1792-1855), à paraître en 2018. Sylvia Barelli-Baud étudie les liens entre topographie et traduction à l’exemple des « non-lieux » du Berlin scindé entre l’Est et l’Ouest, tous ces lieux qui ont disparu, recouverts par les strates de l’unification31. Pauline Fois, pour sa part, enquête sur les traces, matérielles et immatérielles, du Berlin des années 68, et détermine les stratégies à élaborer en vue de traduire un roman à caractère autobiographique32.
L’ancrage dans la recherche lève certaines ambiguïtés structurelles inhérentes aux débuts d’HERMAION : né à l’intersection de l’université et du monde professionnel, le collectif se développe d’abord dans leurs marges, sans assise ou statut clairement définis. Aussi, corréler étroitement traduction et recherche permet-il d’inscrire pleinement HERMAION dans le champ de l’université. Mais cette légitimité académique toute neuve, et les garanties de qualité induites, ne suffisent pas encore à dissiper la méfiance des éditeurs indépendants envers les traductions collectives, a fortiori universitaires. La dilution de l’identité des traducteurs, de la responsabilité et de la propriété intellectuelle ne se conçoit pas aisément et paraît de surcroît peu compatible avec les exigences de lisibilité, voire de visibilité, sur les couvertures des livres : publier sa traduction demeure plus facile pour un traducteur seul ou en tandem, même inconnu.
Malgré tout, HERMAION se félicite d’avoir pu commencer à jouer son rôle de truchement entre des traducteurs en devenir et le continent de l’édition. Catherine Mazères et Pascal Piskiewics, Le Pérégrinateur Éditeur33, ont su saisir, sans préjugés, l’opportunité qu’offre cette structure d’échanges et de services particulièrement adaptable pour donner corps à leur ample projet de traduction de La Gastrosophie. Signalée de manière élogieuse par Ernst Jünger dans une note de son journal, cette somme considérable complètera leur ligne éditoriale dédiée aux joies de la table et aux traditions alimentaires. Ils ont confié le découpage du texte et la traduction de ses morceaux choisis à l’un des membres d’HERMAION, car le crible du collectif représente pour eux, comme pour le traducteur, une assurance supplémentaire. Conformément au programme émancipatoire du collectif, ce genre d’aventures éditoriales vise l’affermissement des vocations et l’avènement de traducteurs qui pourront ensuite, à leur guise, poursuivre ou non l’expérience collective, transmettre ou non le savoir acquis au cours de leur expérience de traduction/recherche/édition.
Pour finir, au-delà d’un programme de recherche et de formation – où la formation est tout à la fois auto-formation, responsabilité et apprentissage partagés –, le traduire ensemble apparaît comme une potentiation, soit un renforcement des capacités traductives par l’union ou la mise en réseau de sensibilités plurielles. C’est donc un supplément d’âme, mais aussi une fabrique d’être dans lequel l’exercice de traduction se double d’un apprentissage social : y entrent à part égale les bonheurs et les frustrations du collectif, la défense opiniâtre de son point de vue et la « diplogance » – facétieux amalgame, souvent vain, de diplomatie et d’élégance – en vue de ménager les autres.
À l’ère de la mondialisation et de son translation turn, quand la traduction semble « la seule éthique possible » pour le monde global (HORNIG, 2011), ses formes collectives, collaboratives ou participatives, revêtent un rôle clé et ouvrent une huitième saison traductive. Un enjeu de taille est maintenant d’en définir le territoire et ses arborescences multiples dans les hors-champs de l’anonymat ou l’invisibilité, dans la dissolution de la propriété intellectuelle. Du côté des traducteurs de ce vaste collectif qu’est le net, on imagine qu’une certaine délectation de l’incognito interactif, la jouissance juvénile d’une (ir)responsabilité parcellisée se mêlent aux idéaux de l’échange et du dialogue entre les cultures.
Pour les traducteurs littéraires qui ont acquis de haute lutte, il y a moins de vingt ans, la reconnaissance de leur statut et de leur art comme auteurs à part entière, il n’est guère étonnant qu’ils se livrent moins volontiers au jeu de la traduction collective, sauf à la revendiquer comme une activité militante, à vouloir changer l’horizon du traducteur en faisant sa part à la convivialité, ou encore pour améliorer la qualité et les délais de traduction. Les traducteurs de théâtre sont néanmoins une exception notable : la dimension performative de l’écriture dramatique, ainsi que l’habitus collectif du milieu théâtral, non seulement encouragent, voire exigent, une pratique collective de la traduction mais ils sont aussi facteurs de grande polyvalence.
Quant à l’expérience d’HERMAION, elle permet de mesurer le réel bénéfice du traduire ensemble et de sa belle diversité – tout à la fois diversité des pratiques et chronodiversité – pour une formation qui déborde ses cadres ordinaires. Si la question de l’intérêt et de la légitimité du collectif au sein de l’université est en partie résolue par sa composante réflexive et l’adossement à la recherche, seule l’inscription dans le temps démontrera la capacité d’HERMAION à développer, ou pas, des relations pérennes avec le monde de l’édition. En attendant, le collectif se plaît dans les espaces qu’il a choisis pour lui-même, résolument transitoires, et où peuvent se déployer sans contrainte de nombreuses figures.