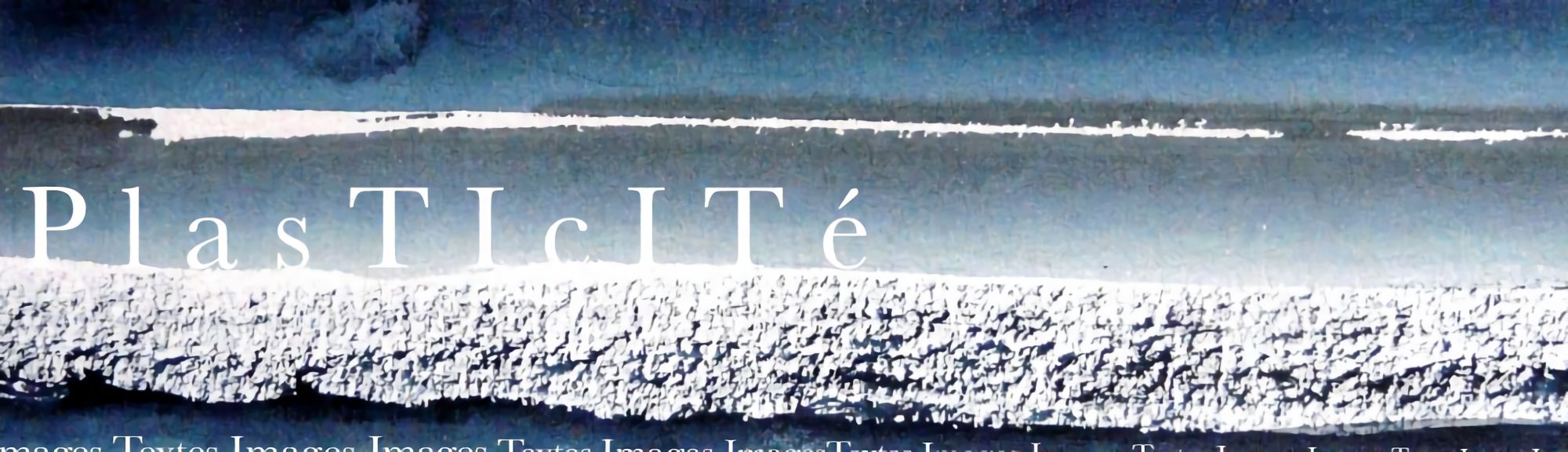1. Doubles-Je
Qu’ont en commun le Parisien Pierre Jallez, normalien, agrégé de philosophie, qui consacrera sa vie à écrire et à défendre la paix, au sein notamment de la Société de Nations ; Jean Jerphanion, son cothurne, enfant du Velay, futur Ministre des affaires étrangères ; Louis Bastide, le fils de Montmartre, qui pousse son cerceau à travers les rues de la Butte ; le Docteur Viaur enfin, dont les recherches bouleversantes sur l’intervention de la volonté dans les fonctions automatiques du corps humain resteront ignorées des autorités officielles, et qui devra sa reconnaissance par le monde académique à des découvertes d’une portée bien plus modeste ? D’être des personnages des Hommes de bonne volonté, certes ; mais au-delà de cette parenté horizontale, de ce simple voisinage ontologique, ils convergent verticalement vers un même référent qui n’est autre que leur créateur lui-même. Ils sont tous, peu ou prou, Jules Romains – des Jules Romains incomplets, inexacts, embellis ou appauvris, pléthoriques ou lacunaires, soit, mais des Jules Romains tout de même. Romains n’a jamais été Ministre des affaires étrangères ; ses travaux, qu’il voulait révolutionnaires, sur la vision extra-rétinienne et le sens paroptique (ROMAINS, 1921) n’ont jamais été pris au sérieux1, et aucune compensation, même médiocre, n’a été offerte dans ce domaine à son orgueil blessé. En revanche, il faut bien dire que la bibliographie de Jallez2 est loin d’être aussi somptueuse que celle de son créateur et que le destin de Louis Bastide, qui finira ingénieur aux Colonies, n’égale pas celui, glorieux, du petit Louis Farigoule, qui se choisira un pseudonyme césarien…
Toujours est-il que, malgré les infidélités qui semblent répondre aux ordres alternés de la vanité et de l’humilité – Romains ne se vante pas de ce qu’il a accompli, mais paraît avoir besoin de se consoler, dans la fiction, de ses échecs scientifiques et de ses demi-succès politiques – Jallez, Jerphanion, Bastide et Viaur forment un jeu de frères fictionnels de l’auteur – un jeu3, c’est-à-dire à la fois un ensemble d’éléments de même nature et une série d’instruments qui permettront à Romains, nous le verrons plus loin, de tirer son épingle du jeu qui oppose – ou mêle – la réalité à la fiction.
Mais nous avons tu jusqu’à présent le nom du cinquième double de l’auteur – le moins présent et le plus exact. Nous l’avons celé, et cité pourtant à plusieurs reprises. Car il est fait mention, dans les Hommes de bonne volonté, d’un poète et auteur dramatique, à qui l’on doit notamment le fameux Knock – en un nom comme en cent périphrases, de Jules Romains. On nous répondra que c’est l’auteur lui-même. Non : on le sait depuis Genette, la fiction, ce n’est « guère que du réel fictionnalisé » (GENETTE, 1991, 92). En d’autres termes, Jules Romains pris dans l’univers de sa propre fiction, Jules Romains entouré de ses personnages, entouré de Strigelius et d’Ortegal et non de Paul Valéry et de Pablo Picasso, c’est un autre Jules Romains – d’autant plus autre qu’il est confronté à un « lecteur fraternel » au sens propre de l’adjectif, à Jallez, qui voudrait, au cours d’une soirée à la Closerie des Lilas, lui témoigner son admiration pour La Vie unanime, mais lui trouve l’air « distant », et, mi-intimidé, mi-vexé, ne se décide pas à l’aborder (ROMAINS, 1932c, 255-256)…
Il y a du jeu (de la latitude, une marge d’imprécision) entre la fiction et le référent : aucun des personnages ne peut être considéré comme le strict jumeau de l’auteur. À chacun, il est laissé une part de liberté, une certaine licence d’exister par lui-même. Jules Romains en personne est pris à son propre piège : il se complaît dans une certaine promiscuité narrative, et plus fondamentalement textuelle, avec ses créatures de papier, et il se condamne ainsi à partager leur sort chimérique. Romains ne se représente pas lui-même, il se recrée : il ne peut être examiné par l’œil de Jallez ou d’Odette Jerphanion sans renoncer, sinon pour lui-même, du moins pour son jumeau d’encre, à son statut d’auteur et surtout à son prestige d’homme réel.
Mais cette société fraternelle qui s’introduit dans le roman est en fait un groupe d’agents doubles. Romains prétend se charger de connaître la réalité et de la représenter. Comment y parviendrait-il, s’il n’y participait pas lui-même – non seulement dans la réalité, mais aussi dans la fiction ? L’auteur se doit, et doit à ses lecteurs, de s’intégrer à sa propre fiction. Ce procédé – car il s’agit bien d’un tour de prestidigitation de l’auteur, qui se joue des contradictions propres à la fiction qui se veut mimétique – relève à la fois de l’illusion et de la désillusion. L’auteur justifie sa connaissance du monde en s’y montrant immergé – il prévient le reproche qu’on pourrait lui faire de se tenir hors de la réalité qu’il décrit, il use d’une méthode prophylactique pour paralyser d’avance les soupçons du lecteur. Il ne veut pas être de ces dieux purement verbaux, qui créent de toutes pièces un monde sans épaisseur, en lieu et place de l’univers consistant qu’ils prétendent représenter. Et puis, se montrer soi-même, c’est donner une garantie immédiate de fidélité référentielle : le premier objet qui se présente aux yeux et à l’esprit de l’auteur, c’est sa propre personne. S’escamoter lui-même, ce serait abuser déjà du pouvoir discrétionnaire que lui confère sa position de maître de la parole. Voilà pour le mirage – qui n’éblouira qu’un très improbable lecteur naïf. Le lecteur, s’il est tant soit peu averti, saura déjouer les tentatives de guet-apens mimétiques dont Romains se rend coupable. Il saura voir que tout cela n’est qu’un jeu : Romains place ses lacets fictionnels sans avoir l’ambition d’attraper personne, ses stratégies ne sont que des imitations de pièges, des faux-semblants qui ne cherchent même pas à faire véritablement illusion. En revanche, ces mensonges qui ne trompent personne ont pour vertu de réveiller la faculté critique du lecteur : si l’auteur est capable de peindre son visage avec le fard de la fiction, s’il peut ajouter un suffixe à sa personne pour en faire un personnage, s’il peut impunément mélanger les plans dans un agencement géométriquement impossible, s’il n’hésite pas à glisser des intrus dans la fiction, des hommes de chair dans un monde de mots, des créatures de sang dans un univers de feuilles blanches et de lettres noires – c’est qu’il est libre de tout, qu’il s’est affranchi des lois de la logique et de l’ontologie. Jules Romains, personnage des Hommes de bonne volonté, est réel, et ne l’est pas ; il renvoie à deux référents – l’un qui siège dans la réalité, l’autre qui évolue dans un monde parallèle – et ce double renvoi simultané à deux mondes non pas complémentaires, mais bel et bien concurrents, est ce qu’il peut y avoir de plus scandaleux pour l’esprit vigilant. Il y a, derrière le nom, un homme de trop : si le mouvement référentiel qui part du mot est ainsi divergent, c’est qu’il n’est qu’illusoire. Il y a donc un paradoxe, non seulement du narrateur, mais aussi de l’auteur extradiégétique, que Romains résout en l’aggravant : c’est en se fictionnalisant lui-même qu’il donne de la réalité à sa fiction.
Il se dessine de la sorte un Grand Jeu, dans le sens kiplingien du terme, d’échanges plus ou moins officieux entre réalité et fiction. Le récit de Kipling4, qui inspira – c’est Roger Caillois (bien placé pour savoir que les critiques peu scrupuleux qui attribuent à la locution un sens ésotérique se trompent et trompent leur lecteur) qui le révèle (CAILLOIS, 1977) – aux poètes du Grand Jeu le nom de leur groupe, n’est rien d’autre qu’un roman d’espionnage. Toute la saveur sémantique du mot jeu est ici mise à contribution : l’espionnage est un monde de faux-semblants, où les règles sont arbitraires et pourtant acceptées dans leur stricte rigidité, où le sérieux des enjeux est compensé par la légèreté désabusée de ceux qui sont engagés dans la partie. Jallez, Jerphanion, Viaur, Bastide, et même le Jules Romains de la fiction, sont tous des sosies peu fiables, derrière leur apparence de santé se cache un vice ontologique. Il semble que ces noms renvoient à un objet bien concret – l’auteur – quand, au contraire, parce qu’ils sont des avatars de l’auteur qui contribuent à bâtir un monde affaibli, ils ne font que déstabiliser la figure réelle de leur créateur. Le mélusinien et le morganatique se mêlent, et quand l’auteur magicien croit inviter ses créatures à lui rendre visite dans le monde bien réel qu’il pense habiter sans ambiguïté, c’est elles en fait qui l’attirent dans cet univers tronqué, décharné, sans épaisseur, dont il veut bien être le démiurge, mais dans lequel il refuse de s’engager.
À moins bien sûr que ce risque ne soit qu’apparent, et que les voies de Jules Romains ne soient moins facilement pénétrables qu’il ne semble au premier abord. Romains peuple l’univers de son roman de personnages qu’il crée à sa semblance. C’est peut-être un moyen, précisément, d’alourdir cet univers de peu de poids – de l’alourdir, c’est-à-dire d’y établir une loi de gravitation. L’auteur se veut le centre vers quoi convergent toutes les particules de la matière fictionnelle. Ce centre-là n’est pas immanent : car il est fait d’une autre sorte, ou plutôt d’une autre matière, que le monde qu’il commande et aimante. Romains intègre ainsi à son univers une transcendance implicite. Le Tout-Puissant est présent, non seulement dans la figure muette de l’auteur – qu’on peut toujours considérer comme le point de transcendance de la fiction, quelle qu’elle soit – mais de manière plus palpable, encore que discrète, dans la personne de ses créatures. Toute transcendance n’est pas gravitation : la gravitation, c’est la présence, dans les éléments de l’univers transcendé, d’un écho de l’entité transcendante, écho qui leur donne du poids – ils sont moins irréels – et qui les oriente.
2. Le Grand Je
Romains imite donc la création dans les deux sens du terme : l’acte de créer et son résultat. Le rapport entre création et virtualité saute aux yeux : ce qui est créé aurait aussi bien pu ne pas l’être, ou ne pas l’être ainsi. La création suppose un moment préalable de délibération : le créateur choisit de créer ou non, de créer ceci plutôt que cela. Mais ce n’est pas qu’à l’instant de cette hésitation initiale que la création est virtuelle : elle le reste au moment même de sa maturité. C’est le sort de toute création de n’être jamais pleinement réelle, car elle n’est jamais qu’une émanation. La réalité de référence, c’est celle du créateur, c’est le plan sur lequel il évolue. Ce qu’il crée est voué à n’appartenir jamais qu’à une réalité seconde, à la fois issue de lui, et qui ne sort jamais de lui. En d’autres termes, toute création est abyme : sa profondeur est toute intérieure. Ce mouvement d’extraction de la création hors du créateur n’est pas latéral : la création n’est pas projetée dans l’environnement du créateur. Mais elle n’est pas non plus solidaire du créateur : elle est bien exclue de lui, et c’est pourquoi elle n’appartient à aucune réalité, ni extérieure, ni intérieure. Elle est mise à distance, mais de l’intérieur : en d’autres termes, elle est une terre étrangère au sein même du territoire familier, elle est un abîme sans profondeur. C’est dans ce sens – parmi d’autres lectures possibles bien sûr – qu’on peut entendre l’affirmation à première vue péremptoire de D. W. Winnicott, qui écrit que « c’est en jouant, et peut-être seulement quand il joue, que l’enfant ou l’adulte est libre de se montrer créatif » (WINNICOTT, 1975, 75).
Et c’est précisément cette double-mimesis – imitation du geste créateur, duplication de son résultat – qui déstabilise la notion même de réalité : référence et fiction semblent interchangeables, chacune peut jouer le rôle et mettre le masque de l’autre. S’il est possible de reproduire intégralement, de l’origine aux résultats, dans une sorte de pan-mimesis, le mécanisme de la création, il n’est plus possible d’affirmer que le monde réel n’est pas lui-même un reflet (para-platonicien) plus ou moins fidèle d’une plus réelle Réalité. C’est le tort – ou la vertu, selon qu’on préfère la stabilité rassurante ou la vérité vertigineuse – de toute construction en abyme que de suggérer qu’elle pourrait aussi bien fonctionner à l’envers, qu’on pourrait aussi bien, logiquement parlant, rebrousser chemin, et que rien n’empêche l’emboîtant d’être également emboîté. Le geste de créer est donc doublement virtualisant : non seulement il produit un monde qui ne sera jamais qu’en puissance, mais il met aussi discrètement le doigt sur une faiblesse ontologique, non pas certaine c’est vrai, mais tout de même théoriquement possible, de la réalité.
Il convient peut-être ici de préciser le lien que nous avons laissé implicitement entrevoir entre le créatif, le ludique et le virtuel. Nous n’hésitons pas à nous réclamer de la définition que donne du jeu Johan Huizinga – définition célèbre, mais qui ne doit pas être suspecte pour autant. Le jeu, donc, selon le premier segment de cette définition, est « une action libre, sentie comme “fictive” et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber totalement le joueur » (HUIZINGA, 1988, 16). Ce qui caractérise le jeu, et qui nous permet d’avancer l’hypothèse que la création est sa sœur sérieuse, c’est bien sûr sa situation de hors-la-réalité, mais également sa capacité d’ingestion de la réalité : non seulement le jeu fascine le joueur au point qu’il en oublie pour un moment ce qui l’entoure (c’est une forme d’aimantation banale, mais non insignifiante, et d’ailleurs Romains, nous le verrons, nous la montre en pleine activité à plusieurs reprises) ; mais surtout, le joueur, une fois qu’il s’est placé au sein de la réalité seconde qu’est le jeu, est bien forcé de s’avouer que, vue de l’intérieur, elle est aussi réelle que ce qu’il considère comme la réalité – en d’autres termes, il est bien obligé de reconnaître que rien ne lui permet d’être assuré que la réalité première n’est pas elle aussi seconde. Le doute platonicien est donc étendu à l’infini : tout pourrait bien n’être que reflet, et il n’y aucune raison pour que cette mécanique de la défiance s’arrête nulle part. Se mêlent donc ici le jeu comme Mimicry, c’est-à-dire comme double illusion (représentation et erreur), et comme Ilinx (plus précisément comme vertige de la gratuité et du désengagement), puisque ce jeu de miroirs sans fin annule toute valeur de référence. À force de multiplier les Je para-auctoriaux, Romains transforme son « roman-monde » (SAMOYAULT, 1999, 179) en roman-moi, c’est-à-dire à la fois en aucto-fiction qui construit le Je du créateur et en auto-récit qui bâtit le Je du texte. La logique des Hommes de bonne volonté, contrairement à ce que veut la tradition critique, n’est pas si éloignée de celle de Paludes et des romans du roman. Le créateur n’est plus en lutte avec une matière extérieure qu’il aurait à dompter. La logique de l’abyme se substitue au mouvement ascendant, l’emboîtement remplace la verticalité. L’excès de puissance du Je entérine le triomphe du Jeu.
3. Quand les doubles jouent
De telle sorte que nulle foi retrouvée ne se décèle dans le roman-fleuve, malgré l’« ambition démiurgique » (LEBLOND, 2010, 16) qu’il suppose. On a du mal, c’est vrai, à croire Romains capable de se montrer désabusé. Quoiqu’il s’en soit défendu (il n’est que de lire les pages où il s’excuse d’avoir rompu son vœu de n’être jamais Immortel5 pour se convaincre qu’une certaine vergogne le disputait en lui à la satisfaction vaniteuse au moment d’être accepté parmi les Quarante), il aimait trop les honneurs (qui le lui rendaient bien, puisqu’il fut, entre autres, Président du PEN Club international) pour ne pas prendre son œuvre au sérieux. Il avait trop d’ambition aussi bien pour lui-même – dans ses Sept mystères du destin de l’Europe, publiés à New-York pendant la deuxième guerre, et heureusement oubliés par la postérité, il n’hésite pas à affirmer qu’une certaine jeunesse voyait en lui le possible Führer français, et il se présente comme l’ambassadeur de l’ombre chargé par les rois et les ministres d’Europe de sauver coûte que coûte la paix (ROMAINS, 1940, 12-15 et 208-209 notamment) – que pour ses livres – l’unanimisme n’est ni « une école littéraire » ni « un système philosophique », c’est tout bonnement « une attitude générale de tout l’être pensant », « un des grands styles de l’humanité apte à marquer de son empreinte toute la pensée, toute la vie, toutes les œuvres de l’homme » (ROMAINS, 1931, 153, 156 et 157) – pour ne pas voir dans son travail de romancier plus qu’un jeu. Et pourtant, comment ne pas penser que Louis Bastide, ce petit pasteur de cerceaux, est plus que Louis Farigoule – comment ne pas céder à la tentation de le nommer Jules Romains, et de considérer ses jeux un peu sérieux comme une allégorie de la fiction ?
Quand nous le rencontrons pour la première fois dans le premier volume des Hommes de bonne volonté, le petite Bastide est en train de guider son cerceau à travers les rues de Montmartre (ROMAINS, 1932a, 174-184). Or, cet humble jouet d’enfant pourrait bien n’être pas si modeste que cela. En effet, le cerceau de Louis Bastide est doué d’une forme d’ubiquité discrète. Louis le mène un peu partout dans Montmartre, et au-delà, comme Romains mène son œuvre un peu partout dans Paris, et plus loin. Montmartre serait ainsi la miniature de Paris, Paris celle du monde – et le cerceau celle des Hommes de bonne volonté. La dignité du cerceau et de son petit conducteur n’est d’ailleurs pas secrète : ils sont, c’est Jules Romains qui le dit (ROMAINS, 2001, c.d. 1, plage 3), le lien qui unit divers thèmes de l’œuvre. Le parcours du cerceau à travers Paris est donc l’image de la circulation de la conscience narratrice à travers l’œuvre. C’est le point mobile vers où convergent les différentes lignes de force qui parcourent le roman, c’est le centre mouvant du livre, où les « touffes de désordre » (ROMAINS, 1932a, XIX) qui le forment viennent se réunir pour composer un corps unanime. Ce n’est pas tout : le cerceau ne rend pas seulement tangible l’essence de l’œuvre. Il suit aussi son mouvement. Les Hommes de bonne volonté se veulent le récit d’une « onde historique » dont la « crête » (ROMAINS, 1964, 110) est la bataille de Verdun (les tomes XV et XVI sont ainsi intitulés Prélude à Verdun et Verdun). Or, quel parcours Louis Bastide et son cerceau suivent-ils ? Ils montent vers les hautes rues de Montmartre, avant d’en redescendre, préfigurant ainsi, dès le premier tome, la courbe de l’œuvre entière. Enfin, on peut voir dans le cerceau une miniature de la Fiction en général. D’abord, s’il faut que Bastide lui donne un coup sec de son bâton pour qu’il démarre, le cerceau a tendance ensuite à se nourrir de son propre mouvement. Parfois même, il fait preuve d’une indépendance excessive, et n’est pas loin d’échapper à son jeune maître qui doit, comme on fouette un cheval, le rappeler à l’ordre. Or, n’est-ce pas le danger que court celui qui crée un monde ? La fiction risque toujours de vouloir vivre selon ses propres lois. La création et les créatures sont désireuses d’échapper à leur créateur, et le démiurge, qui se croyait Tout-Puissant, se rend bien vite à l’évidence : il doit lutter contre sa propre œuvre. Par ailleurs, qu’est-ce qu’un cerceau si ce n’est un disque de bois dont il n’existe que la circonférence ? Clôture et (relative) inconsistance : n’est-ce pas deux propriétés que l’on attribue souvent à la fiction ? Certes, il y a là matière à discussion, et si Margaret MacDonald et Gérard Genette estiment que les éléments référentiels intégrés à un texte de fiction « fonctionnent eux aussi comme les éléments purement fictionnels avec lesquels ils sont toujours mélangés dans le récit » (MACDONALD, 1992, 224) et que « le texte de fiction est […] intransitif » de telle manière que « chaque emprunt qu’il fait (constamment) à la réalité se transforme en élément de fiction » (GENETTE, 1991, 36-37), d’autres, comme Searle, tiennent à établir une distinction entre les œuvres de fiction et « le discours de la fiction » (SEARLE, 1982, 118). Quant au manque de matière qu’on reproche à la fiction, c’est pour Thomas Pavel6 et ses émules une illusion ontologocentrique : notre monde n’aurait rien d’une référence, et ce que nous tenons pour la réalité ne serait qu’une réalité parmi d’autres – mais on n’est pas obligé de les suivre dans ce relativisme ontologique.
Toujours est-il que de Louis Bastide conduisant son cerceau, il est dit qu’il feint d’avoir une mission à remplir. Il joue à l’adulte, il mime des actes sérieux, comme l’écrivain qui se donne l’illusion de mener à bien une tâche importante, et même deux : d’abord, par identification avec ses personnages, il croit accomplir ce qu’il ne fait que raconter ; ensuite, le fait même d’écrire lui semble une lourde responsabilité. Mais le cerceau qui bondit sans apparence de poids à travers Paris, ayant pour pasteur un enfant, dénonce l’innocente légèreté de la littérature et trahit son peu d’influence sur le cours des choses.
Les doubles de Romains sont d’ailleurs coutumiers du fait : ils aiment jouer (et pas seulement ce double-jeu dont nous les accusions tout à l’heure). Prenons Jallez et Jerphanion. Un jour de janvier 1910, ils partent pour une de ces longues promenades qu’ils affectionnent. Ils vont jusqu’à Saint-Denis, où il s’arrêtent « dans une auberge sur la grand’route ». Ils ont « auprès d’eux une bouteille de vin blanc, et deux verres ». C’est le moment de s’adonner au « jeu des préférences » (ROMAINS, 1934, 142-143). De quoi s’agit-il ? De répondre à une série de questions à la fois graves et enfantines. Chacun doit dresser la liste de ses prédilections : son mois de l’année, sa couleur, son tableau, son œuvre musicale, sa statue, son artiste, son écrivain, ses poèmes préférés. Jallez et Jerphanion tiennent à respecter une certaine méthode, et cette occupation quelque peu puérile est l’occasion de débats presque passionnés : « Tout en protestant qu’ils devaient garder une spontanéité entière, et résister aux effets de leur influence réciproque, ils s’adressaient des objections, des critiques, défendaient leurs choix, se rappelaient l’un l’autre à une plus juste appréciation des choses, à plus de fidélité envers eux-mêmes » (ROMAINS, 1934, 143). Rien de léger, donc, dans ce jeu des dilections, qui répond à ce « besoin de voir clair7 » en soi-même qui obsède Jules Romains : c’est la part la plus précieuse de l’être qui y est engagée. Une autre fois, Jallez et Jerphanion s’amusent à inventer un « Jeu de l’Académie » (ROMAINS, 1935, 315). C’est à nouveau au cours d’une promenade, qui les mène sur la Montagne Sainte-Geneviève puis du côté de la Butte. Une fois de plus ils s’arrêtent chez le bistrot, et c’est là qu’il leur vient l’idée de jouer à être les Robespierre de la littérature : « Jallez et Jerphanion imaginèrent donc qu’un Pouvoir Révolutionnaire les chargeait de fabriquer pour la France une Académie tout neuve » (ROMAINS, 1935, 315). On remarque en passant que le jeu de Jallez et Jerphanion révèle un aspect intéressant de la psychologie ludique : ils ne se contentent pas de s’attribuer des pouvoirs accrus, ils inventent un ordre nouveau qui vient soutenir cet élargissement d’eux-mêmes, cette augmentation de leur force et de leur influence. Les voilà donc maîtres des rangs et des ordres, ils décident des chutes et des triomphes. Le jeu est une manifestation de l’hybris, de l’orgueil, ils se trouvent soudain pareils à Dieu, ils ont un pouvoir de vie ou de mort (académique) sur ceux dont ils s’occupent. Il y aura les rescapés (France, Barrès, Loti, Régnier…), les exclus (qui sont si bien damnés qu’on ne les nomme même pas), les appelés (Suarès, Thibaudet, Péguy, Alain) finalement révoqués, les élus (Verhaeren, Claudel, Maeterlinck, Jammes, Gide, Jules Renard, Paul Fort…) Le jeu, donc, n’a pas seulement à voir avec l’art (car dans les deux cas c’est l’art qui est au cœur des débats), mais aussi avec la création et le pouvoir discrétionnaire sinon démiurgique qu’elle suppose. Est-ce à dire que le jeu est doué d’une noblesse secrète, ou au contraire que la création est minée par un invisible vice, non de forme, mais bien de fond ? Il semblerait, hélas, que ce soit bien la création qui manque de poids. Car l’illusion ludique s’évanouit au moindre rappel à l’ordre de la réalité, fût-elle impalpable et intangible. Le moindre rayon de la lumière du jour suffit à faire rentrer dans l’ombre à laquelle elles appartiennent ces artificielles constructions de l’esprit :
Mais il vint une éclaircie dans le ciel. Le soleil était brave ; le vent vif. La meilleure Académie du monde vieillirait comme les autres, et il faudrait la tuer à son tour. Il y avait des choses plus urgentes que de mettre au Musée, de leur vivant, quarante bons esprits. Les dernières nominations restèrent en panne (ROMAINS, 1935, 295).
Mais ce ne sont pas ces discrets accès de modestie qui mettent l’œuvre en péril ; l’honnêteté (sans tapage il est vrai, et savamment camouflée) de ces aveux que Romains fait sous le couvert de l’autoréflexivité8 amènerait plutôt le lecteur à s’abandonner avec confiance aux mains de l’auteur. C’est au contraire l’hypertrophie du créateur qui contribue à fragiliser la création. Le pouvoir discrétionnaire de celui qui détient les clefs de la parole est à double tranchant : il éblouit le public naïf, mais n’aveugle pas le lecteur averti, qui ne se laisse pas prendre aux pièges tendus par le récit. Romains n’en use et n’en abuse pas moins, comme si, aiguillonné à la fois par l’orgueil et la lucidité, il voulait prouver dans un même mouvement sa propre puissance et la vanité de son pouvoir. Il ne faut pas oublier qu’avec Les Copains il a été, un an avant Gide, le théorisateur de « l’Acte pur » et gratuit (ROMAINS, 1922, 188 et ROMAINS, 1970, 62), ni que les imposteurs, sérieux ou facétieux, sont légion dans son œuvre – ni non plus que lui-même fut un maître du canular. La mystification, ce leitmotiv paradoxal qui travaille à miner l’œuvre plutôt qu’à la bâtir, qui révèle en l’auteur un sapeur autant qu’un architecte, Jules Romains l’a pratiquée à tous les niveaux. Beaucoup de ses personnages sont des escrocs, plus ou moins sympathiques – à côté des sept Copains, dont la « Sagesse Facétieuse » (ROMAINS, 1922, 5) est si enthousiasmante, il y a un Haverkamp, dont Romains ne cache aucune des manœuvres frauduleuses, et que pourtant ni Jerphanion ni le lecteur ne parviennent à haïr9, il y a cette détestable « baudruche » (ROMAINS, 1964, 80) de Le Trouhadec, dont personne ne voudrait se passer, il y a Marthe Chauverel, que chacun sait criminelle et qui séduit tout le monde10… Et puis, Jules Romains pratique aussi la prestidigitation éditoriale : il prétend avoir été chargé par le journaliste américain John W. Hicks (à moins que ce ne soit John W. X.) de traduire et d’éditer ses Interviews avec Dieu (ROMAINS, 1952a). Le manuscrit original de ces entretiens suprasensibles existe : il est en français, et la graphie de l’auteur ressemble étrangement à celle de Jules Romains. Mais cela ne suffit pas à satisfaire son appétit d’illusions : pourquoi, puisque Paul Fort est le Prince des poètes, ne pas sacrer également un Prince des penseurs ? Il reste à choisir, parmi les philosophes influents du temps, de dignes candidats. Il s’en trouve deux, au goût de Jules Romains, dont Bergson, bien sûr ; l’autre nom est plus incontestable encore, c’est Pierre Brisset, l’illustre Commissaire de la gare d’Angers, auteur de traités où le mystique le dispute au grivois et le métaphysique au « scabreux ». Le second l’emporte, à la grande joie des Normaliens réunis pour célébrer la gloire de ce Nestor ferroviaire dont le « dada était la philologie, mais une philologie abracadabrante » (ROMAINS, 1970, 99).
4. Jeux sérieux
Il y a pourtant des jeux qui sont engagés, pour ne pas dire embourbés, dans la réalité. Ainsi le jeu de l’Académie sans conséquences est-il précédé de peu par un « jeu de la misère » (ROMAINS, 1935, 299) qui n’a lui rien d’amusant. Jallez et Jerphanion préparent ensemble l’agrégation. Ils imaginent tous deux les suites d’un éventuel échec : pour Jallez, une année d’études de plus, peut-être interrompue par une proposition qui lui offrirait une situation qui lui conviendrait « beaucoup mieux qu’une chaire dans un lycée de province » (ROMAINS, 1935, 303). Mais pour Jerphanion, dont les « parents sont des gens très, très modestes », être recalé, ce serait la misère, et il serait condamné « à solliciter un poste dans un collège lointain » (ROMAINS, 1935, 303).
Et que dire du « jeu de la mort et de Monsieur Quinette-Descombes » (ROMAINS, 1944, 288-292) ? Quinette, l’ancien relieur, l’assassin compulsif, qui s’est retiré à Nice où il exerce l’honnête métier de libraire d’occasion, mais où le poète Vorge (comprenez Aragon, ou Breton) le poursuit de son admiration trop perspicace – Quinette se meurt. Le drame de sa vie s’appelle Landru. Landru est comme son double, il ne sait plus quels meurtres il faut lui attribuer, et ce qu’il doit se rendre à lui-même, Quinette, comme lui appartenant de droit criminel. Le jeu de miroir est infini entre Quinette (qui est le double fictionnel du Landru réel) et Landru (le Landru de la fiction, qui est le double de Quinette). Inutile de préciser que Romains – qui dans sa jeunesse a confié l’entretien de sa première automobile à un garagiste de la Porte de Châtillon nommé Landru, qui devait quelque temps plus tard lui demander un certificat de moralité au moment de passer devant les juges (ROMAINS, 1970, 68-75) – s’amuse ici à un jeu autoréflexif qui brouille l’ordre référentiel entre réalité et fiction. Quinette, donc, sent qu’il est pris dans l’engrenage d’un jeu déréglé : « Tout est possible » (ROMAINS, 1939, 132) – telle est la devise angoissante qui hante l’assassin de bonne volonté – dans ce jeu sans bornes ni mesure. La confusion entre les deux assassins est si parfaite que les gamins que Quinette croise dans la rue lui jettent ce sobriquet qui serait ordinaire (car Quinette est un peu chauve et il a une belle barbe noire soignée) s’il n’était si approprié : « Hé ! Landru ! » (ROMAINS, 1939, 217)
Quinette ne veut pas mourir anonyme, ou pseudonyme, il ne veut pas que Landru lui vole la vedette. Il convoque donc Jallez, à qui il compte faire une confession complète. Seulement Jallez ne vient pas seul, la Mort l’accompagne, et prévient la cérémonie des aveux. Si le « jeu » des deux normaliens se projetant dans un avenir sans gloire relève de l’imagination, ici le terme revêt un tout autre sens. Ce jeu-ci est un débat, un duel, une confrontation – mais une controverse peu franche, un affrontement indirect, une rivalité où il entre une part de complicité haineuse. C’est pourquoi Jallez, qui sent que Quinette risque de mourir avant de lui avoir rien confié, est « pris d’impatience » : « L’idée de la mort le harcelait […] Il s’agissait non de la mort qui remue les grands problèmes, mais de celle qui pratique les mauvaises plaisanteries ; la mort escamoteuse, la mort escroc. » (ROMAINS, 1944, 291) Il est curieux d’ailleurs que les jeux les moins voués à l’ombre ne soient pas moins pétris d’angoisse que ceux qui se confrontent à la déchéance ou à la mort : comme s’il fallait compter comme un jeu tout ce qui a à faire, de près ou de loin, avec la fatalité. Tout le prix du « jeu du bonheur » auquel s’adonnent Jallez et Elizabeth Valavert, les deux amants niçois, est ainsi dans sa brièveté : et c’est pourquoi, « comme une petite fille », Elizabeth compte les heures qu’il leur reste avant le départ de Jallez : « Encore quatre-vingt-trois heures! » (ROMAINS, 1941, 47).
Pourtant ces jeux-là ne relèvent pas le prestige de l’art (à moins qu’on ne joue sur les mots, et qu’on ne daigne se souvenir que le prestige est illusion) : d’abord parce qu’ils ne le concernent pas, et que c’est à la vie qu’ils ont affaire. Et puis, il faut bien avouer que c’est toujours les doubles – Jallez et Jerphanion vont par deux, et sont les jumeaux dissociés de Romains ; Quinette et Landru sont des assassins siamois – qui jouent, comme si le jeu était inséparable de cette logique déréalisante des reflets infinis et sans source.
5. Double-jeu de dupes
Le dédoublement et la dissociation vont d’ailleurs de pair chez Romains : il y a ceux qui se dupliquent, les êtres uniques multiplement incarnés, les âmes à plusieurs corps ; et puis il y a ceux qui se divisent, les visages à plusieurs masques, les corps à plusieurs noms.
Ils sont nombreux, ceux qui viennent étoffer les rangs du bataillon de l’imposture romainsienne, ceux qui, par angoisse ou par ambition, par superbe orgueil ou par sotte vanité, décident de jouer le rôle d’un autre, c’est-à-dire de poser sur leur visage un masque qu’ils ont modelé à la semblance de leur âme. Car le mensonge de l’imposteur est peut-être le plus honnête des simulacres : on devient imposteur pour tirer son épingle du jeu de dupes social. Ainsi de Musse, cacique de l’école de l’hypocrisie. Quel homme plus moyen, aux revendications moins scandaleuses, que Musse ? Que demande-t-il en somme, si ce n’est qu’on laisse à l’individu le droit de jouir de ses menues lâchetés et de ses menues convoitises ? Qu’on ne le prive pas au nom d’une chimérique pureté de ces plaisirs modestes et qui s’avouent tels ?
Mais qui donc est le mieux à même de satisfaire ces petites exigences secrètes, sans portée mais qui ont ce grand tort d’échapper à la lumière sans ombres de la vertu collective ? Est-ce le petit homme revendicatif, et dont la voix discordante encore que faible a tôt fait d’attirer sur sa tête l’anathème public ? Ou ne serait-ce pas plutôt le grand Inquisiteur, le chef suprême des légions purificatrices, le César des hypocrites – le Président de la très vertueuse « Ligue pour la Protection internationale de l’homme moderne » (ROMAINS, 1929, 193) ?
Mais à côté de ceux, innombrables, qui voient dans l’imposture le moyen de se grandir, de gagner en prestige et en majesté, il y a quelques cas, moins tapageurs, mais qui parlent en faveur de l’imposture : que dire du Roi masqué (ROMAINS, 1932b), qui décide de vivre pendant quelques heures une vie sans couronne ? Que dire du roi Kharal qui, se sachant condamné par un complot mené de concert par son influent premier ministre et par sa première épouse, la reine Sikheïla, décide de se retirer quelque temps pour laisser le trône à Barbazouk, conteur des carrefours, bon imitateur, mais qui surtout « possède, à peu près, [son] physique et [son] visage » (ROMAINS, 1963, 178) ? Qu’il est lâchement criminel ? Oui, mais une fois le danger passé grâce à la poigne et à la ruse de Barbazouk, alors que ce dernier vient le retrouver, dans la boutique de Mourad le marchand où il s’est réfugié, afin de « procéder à une substitution en sens inverse » (ROMAINS, 1963, 250), Kharal comprend qu’il « se sent autant de vocation pour les charmes de la vie privée que notre cher Barbazouk s’est trouvé d’aptitudes pour la charge du pouvoir » (ROMAINS, 1963, 259). Il renonce donc à sa dignité royale et abdique en secret en faveur de son sosie.
Et que dire encore d’Haverkamp lui-même, que saisit un jour une puissante « nostalgie de la tendresse » (ROMAINS, 1944, 33) ? Frédéric Haverkamp deviendra Félix Haupetit, et c’est cet homme élégant mais sans fortune qui saura se faire aimer d’une femme honnête et désintéressée (ROMAINS, 1946, 17-52 notamment).
Voici trois imposteurs dont l’ambition n’est pas ascendante ; trois imposteurs mus par ce désir passionné de « se perdre », de « se sentir perdu » (ROMAINS, 1937c, 194) qui saisit parfois Jallez – mais ce dernier, que la renommée n’a pas encore favorisé, n’a besoin d’aucun subterfuge pour y parvenir ; trois imposteurs qui veulent se réfugier « dans une petite pliure du monde » (ROMAINS, 1941, 125), pour s’y protéger de ces simulacres d’eux-mêmes que le public connaît, ou plutôt croit connaître.
Le jeu de masques entre l’essence et les apparences semble infini : l’un (Musse) se montre tel qu’il n’est pas pour pouvoir être lui-même ; l’autre (Barbazouk) met le masque d’un autre pour montrer son vrai visage ; d’autres enfin (le roi masqué, le roi Kharal, Haverkamp-Haupetit) ôtent leur masque, non pour afficher leur visage, mais au contraire pour se rendre invisibles, ou presque.
Il est facile d’en conclure que le jeu des hommes est ainsi fait qu’il faut se cacher (en se masquant ou en se retirant) pour se révéler ou s’épanouir. Mais le discours social est doublé d’un discours sur la représentation : car Barbazouk est un conteur-acteur, et ce que nous propose Romains, c’est aussi un paradoxe de la comédie.
Quand le conteur joue le rôle du roi, la comédie n’est pas où l’on croit : ce n’est pas parce qu’on appelle Barbazouk Kharal que cette inversion des rôles relève de la comédie. Au contraire, ce n’est là qu’une restitution mutuelle : Barbazouk a l’occasion d’exercer sa dignité naturelle d’homme de pouvoir, Kharal peut enfin assouvir sa soif d’anonymat. Mais c’est quand les choses rentrent ainsi dans l’ordre que l’on commence à parler de comédie – et c’est là que se noue le paradoxe : c’est parce qu’on le nomme comédie que le jeu normal du monde devient une comédie – non pas immédiatement, par la force positive des mots – il ne suffit pas que le cours naturel des choses se nomme comédie pour qu’il devienne une comédie -, mais plutôt par la vertu d’une double négation – l’ordre des choses n’est pas une comédie ; mais il ne s’avoue pas comme naturel, et se présente au contraire comme un simulacre ; il joue donc à être une comédie, il est une comédie de la comédie.
6. Les jeux de la création et du hasard
« Tout est possible » donc au créateur épris de son propre pouvoir : mais dérégler son propre jeu, n’est-ce pas pour Jules Romains se vouer à la fois à ce qu’il maîtrise le plus (lui-même), et à ce qui lui échappe le plus (le hasard) ? Car les jeux de hasard – peut-être faudrait-il dire les jeux du hasard, car c’est le hasard qui décide, et on verra même qu’on n’est pas toujours libre de choisir de s’adonner ou non à ces occupations où la fortune est reine – ont également droit de cité chez Jules Romains, et on est tenté de voir dans ce motif, sinon obsédant du moins récurrent, un nouvel aveu autoréflexif.
George Allory, ce triste sire, cet écrivain sans talent ni puissance, ce futur héros de l’arrière, compte sur l’Académie pour le sauver d’une vieillesse sans pompe ni joie dont il sait que ses « quatre ouvrages, fragilement suspendus entre la notoriété discrète et l’oubli » (ROMAINS, 1936a, 40) ne le préserveraient pas. Il se présente au fauteuil Viney, il se démène, et il est battu. Il décide (mais peut-on appeler cela une décision ?) de recourir à l’abîme, de se vautrer dans les plaisirs louches, d’ajouter sa mélodie à la « symphonie du sabbat » (ROMAINS, 1936a, 302). Il essaiera de toutes les jouissances obscures, il fréquentera toutes sortes de milieux interlopes. Il est introduit dans le Cercles des Saussaies, où l’on joue au poker et à la roulette. Pour Bergamot, ce Pierre Louÿs du pauvre qu’Allory est amené à côtoyer, les jeux de cartes sont sans saveur : il faut y tenir compte de l’adversaire, et surtout on n’est pas libre d’y calculer son jeu. Au contraire, la roulette est un face-à-face entre le joueur et le hasard ; et puis, comme tous les joueurs, Bergamot est fasciné par cette idée contradictoire que le hasard, tout en restant le hasard, a ses lois, et qu’un esprit sagace et acharné peut, à force d’étude, les découvrir (ROMAINS, 1936a, 167). Une fois de plus, l’hybris a partie liée avec le jeu : il s’agit de se faire le complice du destin, de percer à jour ses mystères, de se rendre maître de ses rythmes.
Une fois de plus également, ce motif est traité sur le mode sérieux après avoir été exploité pour les besoins de la comédie. Comment Le Trouhadec, « saisi par la débauche » (ROMAINS, 1924), et qui suit à Monte-Carlo Mademoiselle Rolande, actrice fameuse (car les jeux du hasard et ceux de la scène sont unis par d’autres liens que ceux du lexique français), s’y prend-il pour faire fortune ? Il choisit la voie la plus aisée : y-a-t-il rien de plus facile, à Monte-Carlo, que de gagner 114000 francs en choisissant entre le rouge et le noir ? Si ce n’est de les reperdre aussi vite ? Puis de s’enrichir à nouveau, en vendant la formule d’une martingale imaginaire à un quelconque Charles-Auguste Josselin, « ancien officier de cavalerie » et « auteur de plusieurs ouvrages à succès sur l’art de gagner à la roulette » (ROMAINS, 1924, 83-84 et 109) ? Certaine tirade de ce dernier est révélatrice. Le génie consiste d’après lui à savoir entendre les confidences de ce que le vulgaire nomme la fatalité : « Alors, univers ? fait par hasard ? Etoiles, soleil, quadrupèdes, hasard ? Harmonie de la nature, hasard ? Non. Dieu ! Saluez. (Il se découvre.) Providence ! Saluez. (Il se découvre encore.) Génie ! (Il tape sur le front de Le Trouhadec.) Je salue. Il fait comme il dit. » (ROMAINS, 1924, 85)
Voilà donc Pythagore enrôlé de force dans cette armée d’imposteurs. Tout cela serait purement comique, et n’appellerait aucune lecture théorique, si Le Trouhadec ne préfigurait pas (presque imperceptiblement, mais l’écho ne fait aucun doute) non seulement Bergamot, mais aussi le Docteur Viaur. Ce dernier ne serait rien (du moins du point de vue de l’esprit, car les institutions l’adoubent pour d’autres raisons) sans un certain Vidalencque, valet de chambre à la station de La-Celle-les-Eaux, fondée par Haverkamp (car les imposteurs sont parfois les bienfaiteurs involontaires de la science) et où lui-même, Viaur, s’est vu confier la modeste tâche de soigner les pensionnaires. C’est le hasard qui met sur son chemin ce spécimen humain surprenant, capable de ralentir ou d’accélérer son tempo cardiaque ad libitum… Viaur connaît alors son « chemin de Damas », et de ce cas intéressant, mais somme toute strictement particulier, il déduit une théorie qui, si elle venait à être confirmée par l’expérience, bouleverserait la médecine toute entière : il semblerait que la volonté puisse intervenir dans les fonctions corporelles devenues involontaires au cours de l’évolution. Voilà comment Viaur voit le mécanisme (miraculeux) de la découverte scientifique :
On dirait que tu as peur […] Tu veux bien faire des découvertes, mais à condition qu’elles consentent à se trouver dans la direction que tu as choisie ; que ce soit en somme réglé d’avance. Des découvertes qui ne te dérangent pas […] Est-ce que tu t’imagines que c’est l’avis de Dieu ? Est-ce que si Dieu te fait l’honneur […] de mettre sur ton chemin une découverte, une vraie, une grande – que tu ne mérites pas – il ne se fichera pas de tes petites combinaisons ? Même si tu ne croyais pas à Dieu, si tu ne croyais qu’à l’Esprit, t’imagines-tu […] que l’Esprit, s’il te visite, aura égard à tes commodités ? […] Comment se sont comportés les grands savants d’autrefois, croyants ou non ? Tout à coup un fait étrange se trouvait sur leur chemin. Très humble souvent ; dissimulé sous des haillons. Mais eux, ils savaient le voir ; ils savaient reconnaître sa dignité extraordinaire. Ils n’avaient pas besoin d’être prévenus […] Dans ces histoires de grandes découvertes […] il y a toujours un côté chemin de Damas, ou Pèlerins d’Emmaüs. Une Présence mystérieuse ; et un homme qui s’en aperçoit. Parce qu’il a un regard plus courageux ; ou parce qu’il a été choisi entre tous comme témoin, et ne s’est pas dérobé. (ROMAINS, 1936b, 58-59)
Un hasard, qu’on reconnaît marqué du sceau de la providence, une rencontre sans gloire dont on sait découvrir l’aura secrète – c’est au fond la méthode (involontaire) que préconisent, chacun dans son domaine, et mutatis mutandis, le poète Strigelius (qui pourrait bien être l’auteur d’un certain Cimetière marin) et le peintre Ortegal (qui n’a rien à envier à Picasso). Le premier renonce à sa volonté d’auteur et laisse « l’insecte mental » (ROMAINS, 1936b, 147) élaborer des poèmes à partir de mots qu’il cueille au hasard dans le dictionnaire – mais cette très sérieuse « méthode de production » (ROMAINS, 1936b, 106) poétique n’est-elle pas la cadette de celle des Copains qui, plus de vingt ans auparavant, lisaient leur facétieux avenir en introduisant une épingle dans le bottin ? (ROMAINS, 1922, 33) Quant à Ortegal, il rencontre sur sa route un miroir qui lui renvoie une image altérée du monde, et il fait de cette équation déformante dont le hasard lui offre la formule le principe de son esthétique nouvelle (ROMAINS, 1937b, 275-278).
Jules Romains, c’est vrai, n’est solidaire ni de Strigelius ni d’Ortegal : à l’un il reproche une certaine vacuité ; et l’autre est pour lui l’exemple-type du peintre de peu de scrupules, qui oublie que l’art n’est que la première syllabe de l’artisanat, et qu’on ne peut prendre des libertés avec la technique qu’après s’en être rendu pleinement maître.
Mais, aussi critiques soient-ils, ces portraits d’artistes au travail ne contribuent pas à renforcer la foi du lecteur dans l’art. Ils mettent le doigt sur le défaut évident et secret de toute création, qui est d’appartenir entièrement, corps, âmes et biens, à son créateur, qui est libre de la réduire à un jeu de reflets ou d’échos dont lui-même n’est plus maître. Il ne semble en effet pas abusif de proposer une lecture autoréflexive de la « Leçon d’un cénotaphe » (ROMAINS, 1936b, 133-147) que la plume de Strigelius écrit guidée par la main de Romains : le tombeau vide est une image de la vanité des mots qu’aucun sens n’habite – de telle manière que cette sépulture déserte serait comme un lointain souvenir du coffret de Madame Arnoux, dont le seul secret est sa propre vacuité, et qui, si l’on en croit Georges Zaragoza, symbolise la vanité désirée du texte flaubertien (ZARAGOZA, 1989).
D’ailleurs, quand, dans la Préface aux Hommes de bonne volonté, Romains veut éclairer par une analogie le travail de composition d’un roman, il a recours à la métaphore du jeu de cartes. Il avoue par là que son travail dépend du hasard – car il est forcé de jouer avec les cartes que lui attribue le monde dont il entreprend de faire la chronique ; à moins bien sûr que sa volonté ne soit toute-puissante, puisqu’il reconnaît qu’il s’apprête à transgresser les règles du jeu : il compte ainsi mettre en scène « tout un pathétique de la dispersion, de l’évanouissement, dont la vie abonde, mais que les livres se refusent presque toujours, préoccupés qu’ils sont, au nom de vieilles règles, de commencer et de finir le jeu avec les mêmes cartes » (ROMAINS, 1932a, XIX).
Romains se veut donc aux ordres d’une réalité fatale, mais dans le même temps, il se déclare prêt à prendre toutes les libertés nécessaires avec les lois de l’architexte – ce qui nous rappelle discrètement que le créateur peut décider de se constituer prisonnier, mais qu’il est toujours libre de choisir ses fers, et de s’en libérer. Il le laisse d’ailleurs entendre en passant, un jour qu’il nous emmène en promenade avec ses deux doubles de la rue d’Ulm, tout en continuant de faire rouler de sa plume omnipotente le cerceau de Louis Bastide. La déambulation des deux normaliens n’est pas sans règles – pas plus que le jeu de Louis. Mais ce sont eux qui les édictent, ce sont eux qui choisissent les contraintes qu’ils s’imposeront – sans compter qu’aucune règle n’est rigide au point de n’admettre aucune exception ni entorse : « Il y avait bien l’arrêt chez le bistrot qui se justifiait mal. Mais quel est le jeu qui n’admet pas certaines ruptures et certains sommeils de la loi ? Louis Bastide a dû parfois porter son cerceau en traversant les carrefours. » (ROMAINS, 1935, 318)
En contrepoint, donc, des professions de foi théoriques de Romains, de ses proclamations de principe, il faut savoir entendre la vérité secrète de la pratique, il faut s’introduire dans le confessionnal de l’œuvre pour écouter les aveux de l’hypocrite auteur… Car Jules Romains, dans ses discours officiels sur la littérature, tient qu’il ne faut « nullement confondre » le « pouvoir de découverte poétique, de pénétration dans la réalité » de l’âme humaine avec « les jeux de la fantaisie intérieure, ni avec certains états plus ou moins hallucinatoires » (ROMAINS, 1983, 13), qu’il ne faut pas assimiler l’état de « transe » du romancier (il s’agit en l’occurrence de Balzac) capable de vivre pendant quelques heures « une vie de notaire, de marchand d’étoffes, de prêtre » aux « jeux ordinaires de l’imagination » (ROMAINS, 1952b, 47), et qu’« une littérature qui part à la découverte de tout un monde est une littérature qui a beaucoup de choses à dire, et qui est si préoccupée de l’urgence de les dire qu’elle ne saurait s’attarder aux jeux du verbalisme, aux recherches de la préciosité » (ROMAINS, 1983, 11). Sa position est nette : l’écrivain n’a droit à aucune licence, ni verbale, ni imaginaire. Il n’aime pas la poésie « qui se développe comme parasite de la culture, qui se nourrit de la sève des livres » (ROMAINS, 1952b, 246), et le « jeu des mots » ne se justifie à ses yeux qu’à condition qu’il contribue à « suggérer les contours, palpitations, rebroussements de l’invisible, de la chose fuyante ou cachée » (ROMAINS, 1952b, 237) – ce qui ne le gêne ni pour assimiler la poésie à un jeu intellectuel et sonore – « L’exercice proposé par une forme d’art à l’esprit de celui qui la goûte subit le sort commun à la plupart des « jeux ». Il tend à vieillir. » (ROMAINS, 1937a, 11)), ni pour admirer que son ami Georges Chennevière n’ait « cessé de renouveler ses jeux de sonorités » (ROMAINS, 1952b, 226).
Quant au peintre maudit – c’est-à-dire adroit et scrupuleux – dont Romains fait le portrait fictif et l’éloge sincère, ce qu’il reproche à ses collègues qui réussissent, c’est de ne pas « respecter certaines règles du jeu » (ROMAINS, 1962, 60). Ce que Romains lui-même blâme chez les peintres contemporains, c’est le peu de soin qu’ils apportent aux « jeux de lignes et de couleurs » (ROMAINS, 1966, 44), et ce qu’il admire au contraire dans le « New-York d’entre 1930 et 1940 », c’est qu’il invite le spectateur « à chercher son plaisir dans les jeux d’une géométrie complexe » (ROMAINS, 1966, 77-78). L’artiste a beau jeu de se vouloir l’esclave de la réalité et le serviteur de la vérité : l’œuvre d’art n’en obéit pas moins à des règles qui ne sont pas celles de la simple représentation, à des lois qui lui sont dictées par l’histoire de l’art et non du monde – sans oublier que l’artiste est libre de les renier ou de les assouplir, et que si les ordres de Malherbe lui semblent par trop contraignants, rien ne lui interdit de substituer des accords libres aux strictes rimes, et de publier un Petit traité de versification (CHENNEVIERE ET ROMAINS, 1923)…
7. En guise de conclusion : Pénélope lectrice…
De telle sorte que la lecture, de sérieuse, devient ludique11. Au lieu de fixer définitivement un système de correspondances entre les mots et les choses, le lecteur est invité à réagencer l’œuvre indéfiniment, dans un interminable jeu d’échecs : c’est parce qu’il échoue sans cesse à comprendre le texte et ses lois que le lecteur le lit et le relit. C’est parce qu’il ne parvient pas à figer un texte constitutivement plastique, pure surface flexible à la fois souple (car toutes les contorsions de sens lui sont possibles, car nul paradoxe ne lui est impraticable, car nulle déformation ne lui est étrangère) et plane (car l’autoréflexivité est à la référence ce que le jeu est à la réalité : il manque au texte une dimension, toute verticalité y est en fait horizontale, toute valeur autotélique, toute transcendance immanente), qui se joue perpétuellement de lui, que le lecteur est condamné à jouer éternellement avec et sur les mots. Tout est double : c’est qu’un miroir qui refléterait autre chose qu’un miroir y perdrait tout prestige plastique. Les images qui s’y incrusteraient le voueraient à la réalité : il demeurerait une irrévocable hiérarchie mimétique, qui exclurait toute confusion. C’est là la force des Copains : ils inversent l’ordre épistémologique, ils confondent les mots et les choses, la parole et le monde. Le Trouhadec a-t-il décrit, dans sa Géographie de l’Amérique du Sud, l’ouvrage qui a fondé son prestige scientifique, une ville qui n’existe pas, la fameuse Donogoo-Tonka ? Qu’à cela ne tienne ! Ils la bâtiront, et le texte soutiendra le monde au lieu que le monde soutienne le texte12. Il faut créer la confusion entre l’original et la copie. L’angoisse plastique n’est rien sans gémellité : il y faut deux chiens de faïence qui se regardent éternellement sans qu’aucun puisse prétendre jamais à un quelconque droit d’aînesse. Miroirs, reflets, simulacres, faux-semblants : partout où le lecteur croit retrouver la terre ferme du sens, le pied lui manque. La fiction est bien ce cerceau d’enfant qui roule, indéfiniment, pour ne s’arrêter qu’à l’endroit d’où il est parti : le principe de son mouvement est circulaire aussi bien que son mouvement lui-même. D’ailleurs les Copains ne chantaient-ils pas un hymne au cercle, un chant de gloire où, une fois de plus, la réalité et la fiction, le propre et le figuré, se mêlent, puisque Romains confond la rotondité littérale des aliments solides avec la rotondité métaphorique qui découle de l’absorption de certaines nourritures liquides, pour en déduire une métaphysique circulaire, qui sonne comme un traité de la nullité ontologique ?
Le jour d’hui est placé sous le signe du cercle. Le cercle est le principe de notre mouvement ; il va devenir l’aliment de notre force. Toutes les choses rondes ont droit désormais à notre piété » […] Bénin répéta : « Nous sommes voués au cercle. » Et la pensée des copains prit la forme d’un cercle. La salle fut une boule creuse, le village un disque, et la planète n’eut jamais autant de raisons d’être un globe. « Oui, dit Broudier, nous sommes ronds ; et nous créons le monde à notre image. (ROMAINS, 1922, 91-92)
On voit que le jeu circulaire et l’illusion de s’égaler à Dieu vont de pair et que l’hybris de Jallez et Jerphanion est précédée de son propre pastiche – car Romains, qui aime à confondre le premier et le second, a l’habitude, nous l’avons laissé entendre à plusieurs reprises, de s’autoparodier par anticipation.
C’est ainsi que chaque fil que le lecteur tisse en détisse un autre. Le tapis textuel sera-t-il jamais achevé ? Il semblerait hélas que la ruse de notre Ulysse de bonne volonté consiste non pas tant à se garder des écueils marins et des chants océaniques qui le séparent de sa terre qu’à déjouer les pièges qui pourraient le ramener à Ithaque – et le lecteur, semblable à Pénélope, se voit condamné à remettre éternellement son ouvrage sur le métier. Le texte, infiniment et indéfiniment plastique, est un cercle, vicieux et vertueux à la fois (car le plaisir qu’éprouve le lecteur-Tantale à se perdre dans le labyrinthe que dessinent ses propres pas a quelque chose d’interdit, et sa jouissance est inséparable de sa frustration) – à moins que cette pure boucle ne soit ni vicieuse ni vertueuse, puisqu’aucune transcendance ne vient la qualifier, et que, pareille au phénix, elle meurt et renaît, sans repos, d’elle-même.
ZARAGOZA, Georges, « Le coffret de Madame Arnoux ou l’achèvement d’une éducation », in Revue d’Histoire littéraire de la France, VII-VIII-1989, p. 674-688.