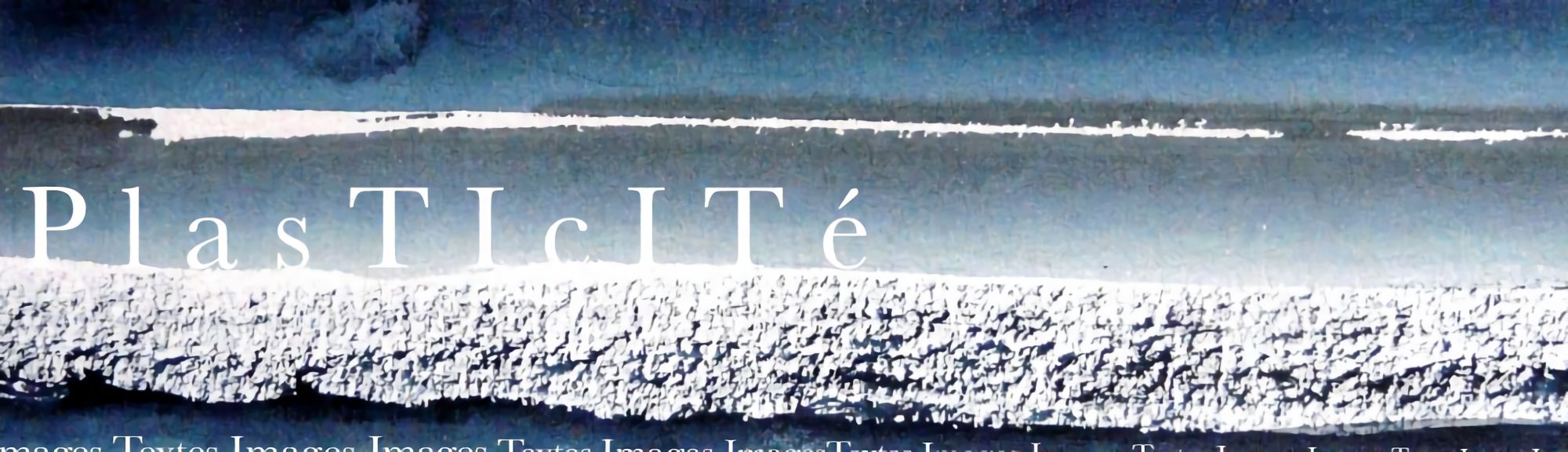En 1772, Rousseau vit à Paris où il est contraint de reprendre son métier de copiste de musique pour subvenir aux besoins de son ménage. Il sait que les lectures publiques de ses Confessions n’ont pas suffi à convaincre de sa bonne foi, qu’elles n’ont rien changé de son image auprès du public. Le chef de la police, Monsieur de Sartine, l’avise même de les suspendre. Il va alors entamer l’écriture de ses Dialogues pour tenter encore une fois de se justifier. Mais il est seul, privé de toute vie sociale, persécuté, rejeté par les intellectuels qui forment le mouvement philosophique. Ses idées sur le progrès, sa profession de foi, et, dans une certaine mesure, ses modèles politiques, sociaux et moraux ont fait de lui l’homme à abattre, l’ennemi du groupe où Diderot, Voltaire et d’Alembert tiennent, avec Grimm, les premiers rôles. Sa situation a ceci d’aliénant qu’elle le mure dans un silence profond qui l’empêche non seulement de se faire entendre mais le prive encore de comprendre ses accusateurs. Avec ses Dialogues, Rousseau crée une surface linguistique, une sociabilité virtuelle qui suit la logique échiquéenne de Philidor grâce à laquelle il va enfin pouvoir comprendre ses ennemis, les écouter et leur parler.
Il s’agira dès lors dans cet article d’examiner la fonction du jeu d’échecs dans les Dialogues de Rousseau et cette lecture peut s’énoncer en trois propositions.
Première proposition : La passion échiquéenne. Le jeu d’échecs a toujours occupé une place importante dans la vie de Rousseau et n’a jamais réellement été qu’un simple passe-temps mais aussi une obsession lui servant à prouver ses facultés stratégiques et sa supériorité intellectuelle.
Deuxième proposition : Le jeu d’échecs comme sociabilité virtuelle. En 1772, Rousseau est seul, coupé du milieu intellectuel parisien. Il ne peut ni livrer sa pensée ni imposer sa vérité. L’autre devient pour Rousseau un élément essentiel puisque c’est précisément l’absence de lien social qui lui ôte la possibilité de comprendre et d’être entendu. Il crée un espace de dialogues virtuel, ouvert et inclusif, dans lequel il rend public ce qui est maintenu secret et silencieux. Il ouvre une arène dans laquelle, à l’image du procédé employé par Philidor dans son Analyse du jeu des échecs, il expose les machinations machiavéliques mais injustes dont le personnage de Jean-Jacques est la victime innocente.
Troisième proposition : Un espace échiquéen trifonctionnel. L’espace échiquéen des Dialogues remplit trois fonctions essentielles. La première est la création d’une surface d’échanges, la deuxième est d’enseigner au public la façon dont son œuvre doit être lue, et la troisième est de comprendre et d’expliquer l’irrationalité des attaques de ses ennemis.
Cet article montrera qu’avec le jeu d’échecs Rousseau a pu matérialiser sa pensée systémique et offrir une vision tridimensionnelle du complot dont il se sent la cible afin de le rendre compréhensible à ses lecteurs.
1.La passion échiquéenne
C’est à Chambéry, alors qu’il n’a que 20 ans, que Rousseau apprend à jouer aux échecs. Sa passion pour le jeu est née en 1732, après une défaite humiliante face à un certain M. Bagueret, qui, pour comble d’insulte, lui proposa de lui enseigner les raffinements et la stratégie du jeu (ROUSSEAU, 1876, 183)1. À l’époque où Rousseau découvre les échecs, un seul traité est disponible : le Calabrois écrit par Greco, un champion d’échecs italien. C’est seulement quelques années plus tard que d’autres manuels pédagogiques sur les échecs seront publiés en France par Stamma en 1737 et Philidor en 1749, entre autres. Enfermé dans sa chambre, pendant près de trois mois, Rousseau étudie les combinaisons compilées par Greco, mais le résultat n’est guère probant. Il subit une autre défaite désastreuse face à M. Bagueret. Malgré le traumatisme de son expérience initiale, Rousseau a continué à jouer aux échecs toute sa vie et a atteint un niveau plus qu’honorable puisque, consacrant ses après-midi à jouer aux échecs au café Maugis avec les grands joueurs de son temps tels que M. de Legal, M. Husson ou encore Philidor, il ne fit certes aucun progrès selon lui, mais fut tout de même capable de rivaliser avec les champions du XVIIIe siècle parisien sans se couvrir de ridicule. Chaque fois qu’il était à Paris, Rousseau se rendait aux cafés où il pouvait trouver de nouveaux adversaires et se livrer à loisir à son jeu favori. En 1742, il fréquentait assidûment le Café de la Régence où les plus grands joueurs d’échecs se réunissaient et où une de ses connaissances, Daniel Roguin, l’a présenté à un jeune intellectuel plein de promesses, Denis Diderot (FABRE, 1961, 3:157). Deux des plus grands esprits du siècle se sont rencontrés dans l’enceinte échiquéenne la plus réputée de Paris et y passèrent leur temps à jouer et à regarder les plus grands champions s’affronter. L’estime que Diderot vouait tout particulièrement aux échecs l’a conduit à considérer ce jeu sous un angle philosophique. La concentration requise pour jouer est un recueillement profond d’où « naît l’agrément des pensées fines, qui de même que la bergère de Vigile, se cachent autant qu’il le faut pour qu’on ait le plaisir de les trouver » (DIDEROT, 1875–1877, 11:297). Il n’est nulle question de prestige dans l’exercice de l’esprit tel que le conçoit Diderot, il s’agit plus de plaisirs, de raffinements spirituels. La finesse des pensées ne viendrait pas naturellement, elle requerrait un effort intellectuel soutenu et ne serait que le fruit d’une série de réflexions. Les échecs, pour cette raison, convenaient parfaitement à l’esprit philosophique puisqu’ils exigeaient un raisonnement rationnel continu et préparaient l’esprit à des raisonnements subtils et agréables, du moins le croyait-on à l’époque.
À l’inverse de Diderot, le plaisir que recherchait Rousseau était avant tout celui de la victoire. « Vous serez battu, et bien battu » écrivait-il à son ami DuPeyrou, « je ne serais pas même fâché que cela vous dégoutât des échecs » (ROUSSEAU, 1865, 12:39). Il s’agissait pour lui d’humilier la personne assise de l’autre côté de l’échiquier et de faire admirer son agilité d’esprit. « Inhibé par la timidité, dépourvu d’humour et de légèreté d’esprit » Rousseau fit rapidement du jeu un moyen de prouver son intelligence, sa supériorité et de compenser son manque de spontanéité : « Le jeu d’échecs restait son seul recours pour rabaisser l’orgueil, la suffisance » de certains philosophes comme Frederick-Melchior Grimm dont l’éloquence l’a toujours impressionné et qui ne voyait en Rousseau qu’un lourdaud dépourvu d’humour (COULON, 2002, 459).
Diderot fut aussi la victime de Rousseau et de sa rage échiquéenne. Bien que Diderot reconnût que son ami lui était supérieur, Rousseau ne lui laissait jamais d’avantage comme était la coutume à l’époque. Il ne renonçait jamais à une de ses pièces pour assurer l’égalité des deux adversaires et prolonger la partie. Diderot n’y voyait que de l’ignorance, de la médiocrité et du mépris: « L’homme ambitionne la supériorité, même dans les plus petites choses. Jean-Jacques Rousseau, qui me gagnait toujours aux échecs, me refusait un avantage qui rendît la partie plus égale. « Souffrez-vous à perdre? me disait-il. — Non, lui répondais-je ; mais je me défendrais mieux, et vous en auriez plus de plaisir. — Cela se peut, répliquait-il; laissons pourtant les choses comme elles sont » (DIDEROT, 1875-77, 11:127). Les frères ennemis se disputaient déjà sur la politique, la religion et la philosophie, les échecs ne firent qu’exacerber encore plus leurs différends.
Depuis 1732 jusqu’à son dernier séjour à Paris, les échecs, « où l’on ne joue rien » ont été le seul divertissement qu’il avouait dans sa correspondance. Même malade, il ne pouvait se défaire de sa passion qu’il accusait d’aggraver ses afflictions : « J’ai de la fièvre, un grand mal de tête, que les échecs où j’ai joué hier ont augmenté ; je les aime, et il faut que je les quitte » (ROUSSEAU, 1959, 241). Cherchant inlassablement de nouveaux adversaires, Rousseau endurait la compagnie et la conversation de ses semblables pendant de longues heures dans l’unique but d’« obtenir une pauvre petite partie » (ROUSSEAU, 1876, 411). En 1770, lorsqu’il revint vivre à Paris, il fréquentait les nombreux cafés parisiens, consacrait ses après-midi à « pousser du bois » et faisait preuve d’une grande facilité à se lier avec des gens de toute condition pour pouvoir jouer aux échecs, n’hésitant pas à demander à un vitrier s’il connaissait les échecs (MENETRA , 1998, 219). On le trouvait au Café de la Régence où sa présence attirait à chaque fois une foule prodigieuse à tel point qu’on le priât de ne plus reparaître « ni à ce café, ni dans aucun autre lieu public », une décision qui eut pour conséquence malheureuse de le tenir à l’écart du public parisien et des joutes échiquéennes qu’il affectionnait tant et d’accentuer encore plus sa solitude et son sentiment de persécution (GRIMM, 1968, 91).
2. Le jeu d’échecs comme sociabilité virtuelle
Installé à Paris, Rousseau copie de la musique et entame la rédaction de ses trois Dialogues en 1772 ; il y consacrera quatre ans de sa vie. Les lectures publiques de ses Confessions n’ont pas eu l’effet désiré et il se lance une nouvelle fois dans l’écriture pour se justifier et défendre sa réputation auprès du public. Il accuse le milieu intellectuel parisien et plus précisément les encyclopédistes d’être les « arbitres de l’opinion publique » et « même de la destinée des particuliers, et par eux celle de l’état » (ROUSSEAU, 1817, 19:81). Rousseau se sent persécuté, il est persuadé que la clique encyclopédique et holbachique a retourné l’opinion contre lui, que ses écrits ont été dévoyés. Voltaire était habile à faire des faux et n’a pas hésité à publier le Catéchisme de l’honnête homme sous les initiales PMJJREG, c’est-à-dire, Par Monsieur Jean-Jacques Rousseau Ex-Citoyen de Genève. Il s’était emparé d’un certain nombre de pages de la Profession de foi du vicaire savoyard et y avait inséré quelques réflexions qui dénaturaient la pensée du Genevois. Il ne fait aucun doute que Rousseau a été persécuté pour ses idées politiques et religieuses : « Il y a eu la brouille avec Hume, il y avait l’hostilité de Choiseul, des encyclopédistes, d’Holbach faisait enquêter chez les banquiers pour savoir si Rousseau cachait de l’argent, et Voltaire se renseignait auprès des mouchards des ambassades sur ses activités à l’étranger » (GUILLEMIN, 2012). Les pressions étaient bien réelles, Rousseau ne les a pas imaginées. La lecture des Confessions a ouvert un espace de parole trompeur où son propre discours lui revient déformé : « On lui signifie que sa parole ne lui appartient plus » et « qu’il ne pourra rien transmettre de ce qu’il a voulu dire aux générations futures, et qu’il est finalement de son intérêt même de se taire puisqu’il n’a pas la parole » (FOUCAULT, 1962, xviii). On l’isole, on le plonge dans un silence terrible où il n’entend que l’écho de ses propos, altérés, pervertis, vidés de leur substance : « Livré pour toute lumière à mes conjectures, je n’en ai su former aucune qui put expliquer ce qui m’arrive, de manière à pouvoir croire avoir démêlé la vérité » (ROUSSEAU, 1817, 18:22-23). Maintenu à l’écart du milieu intellectuel, isolé de la sphère encyclopédique, il veut assurer la postérité de son œuvre et de son nom, se justifier, se disculper aux yeux de l’opinion publique, et faire la lumière sur le complot dont il pense être la victime innocente. Aussi devient-il essentiel de recréer un espace de dialogue, une forme de sociabilité où il va pouvoir non seulement s’expliquer, faire parler ses accusateurs, les contredire, mais encore montrer à ses contemporains la manière de le connaître. Dans Rousseau juge de Jean-Jacques, Rousseau écrit sa propre partie d’échecs « comme on compose solitairement un problème, en prévoyant à sa guise les coups possibles à jouer des blancs et des noirs » (BERCHTOLD, 1996, 40:145). Rousseau veut enseigner la meilleure façon de le lire, de le comprendre. A cette fin il va reproduire la structure d’un des traités pédagogiques les plus célèbres du XVIIIe siècle et un manuel qu’il aura passé de longues heures à étudier : L’Analyze des Echecs par François Philidor.
Parmi tous les champions d’échecs, François André Danican Philidor (1726-1795) était la figure emblématique du XVIIIe siècle. Il publie son premier livre en 1749 et y explique clairement et simplement la théorie et la pratique des échecs. Son approche a ceci de pédagogique qu’elle s’adresse principalement aux néophytes : le lecteur doit reproduire les parties et « bien examiner chaque coup en détail » et apprendre à « en pénétrer l’intention » (PHILIDOR, 1821, 5). Philidor fascinait les foules par ses prouesses intellectuelles en jouant plusieurs parties d’échecs simultanément les yeux bandés. Un article de L’Encyclopédie fait même l’éloge de sa mémoire et de son intelligence. Le subtil Philidor tel que Diderot le nomme dans son Neveu de Rameau devint rapidement une figure publique, une célébrité admirée de tous les joueurs en France et commençait à se faire un nom en Angleterre où ses parties d’échecs remplissaient le St. James Chess Club (DIDEROT, 1926-27, 2:2). Habitué à fréquenter le Café de la Régence, il y rencontre Jean-Jacques Rousseau avec qui il se lie d’amitié assez longtemps pour participer à la composition de son opéra-ballet, Les Muses galantes (METZNER, 1998, 25). Avant d’acquérir une renommée internationale, tous deux étaient des compositeurs et avaient suivi une formation musicale. S’ils ne sont jamais réellement tombés d’accord sur l’importance de leur contribution respective, il ne fait cependant aucun doute que leur collaboration a donné au Genevois la possibilité de défier le plus grand joueur d’échecs de son siècle et de suivre les enseignements du maître de même que les qualités de pédagogues qu’il démontre dans son traité sur les échecs.
Dans la préface de son traité Analyse du jeu des échecs, Philidor précise que dans chacune de ses remarques, « pour éviter toute équivoque », il « traite toujours le Blanc à la seconde personne, et le Noir à la troisième » (PHILIDOR, 1821, xxvi). Philidor occupe le devant de la scène, il commente les combinaisons illustrées dans son traité. Il utilise trois personnages : lui-même, celui qui sait, le lecteur, le Blanc, celui qui doit apprendre, et l’adversaire, le Noir, qui, pour être battu, doit d’abord être compris. Il s’adresse directement à ses lecteurs en utilisant la deuxième personne pour leur expliquer la façon sinon de battre leur adversaire du moins de comprendre leur stratégie. La discussion se concentre sur le Noir, Philidor en parle toujours à la troisième personne. Tous les mouvements du Noir sont analysés, commentés et critiqués ; c’est exactement la même organisation ternaire qui structure Rousseau juge de Jean-Jacques. Le lecteur – ou le Blanc – est remplacé par le Français qui doit apprendre à lire, à penser par lui-même et à apprécier Jean-Jacques tel qu’il est réellement. Jean-Jacques – ou le Noir – est le personnage public de Jean-Jacques Rousseau. Il est l’autre, l’adversaire que le lecteur doit comprendre. Rousseau, lui, est son propre personnage – Rousseau – il conduit les débats et joue un rôle similaire à celui de Philidor dans son traité. Il analyse son image publique : Jean-Jacques. Il est la figure d’autorité qui dirige l’attention du Français, c’est-à-dire du lecteur, sur les faiblesses du complot contre Jean-Jacques. Les deux voix du dialogue sont le Français et Rousseau ; Jean-Jacques ne parle jamais. Rousseau est le juge intègre qui dément « les assertions bruyantes des gens passionnés » et dénonce les injustices que Jean-Jacques est forcé d’endurer (ROUSSEAU, 1817, 7:97).
3. Un espace échiquéen trifonctionnel.
La structure ternaire sert trois fonctions essentielles : la première est de créer une arène linguistique où Rousseau va pouvoir enfin briser le silence dans lequel il est cloîtré ; la deuxième est d’enseigner au public la façon dont il doit lire et comprendre l’œuvre, la pensée et le cœur de Rousseau ; la troisième enfin est pour lui de se mettre dans la tête de ses ennemis, de débattre avec eux, de démasquer leurs supercheries et de répondre à leurs attaques.
Lorsqu’il écrit ses Dialogues, Rousseau vit à Paris dans « une solitude plus affreuse que les cavernes et les bois, où il ne trouve au milieu des hommes, ni communication, ni consolation, ni conseil, ni lumières, ni rien de tout ce qui pourrait lui aider à se conduire, un labyrinthe immense où l’on ne lui laisse apercevoir dans les ténèbres que de fausses routes qui l’égarent de plus en plus » (ROUSSEAU, 1817, 7:38). Aussi lui faut-il briser l’isolement, réintégrer la société humaine, ouvrir des voies de communication, de dialogues, pour modifier l’image que l’opinion publique a de lui et sortir du silence où « on s’amuse à l’enterrer tout vivant » (ROUSSEAU, 1817, 7:60). Il accuse les encyclopédistes, ces messieurs, de l’avoir isolé du monde et traité comme un paria. Coupé des cercles intellectuels parisiens, il n’a aucun recours pour endiguer le flot continu de diffamations dont il est victime, il ne reçoit « jamais aucune explication qui le mette à portée de répondre et de se défendre » (ROUSSEAU, 1817, 7:28-29). Il n’y a aucune accusation directe, pas de mots, seulement des signes qui ne lui laissent pas la possibilité de parler. Cette machination a ceci d’efficace qu’elle n’a ni nom ni forme et qu’elle peut à tout moment transformer une rumeur en vérité. Rousseau va alors imaginer un confident, le Français, avec qui il va « raisonner sur une hypothèse générale qui pût tous les rassembler. » Parmi toutes les suppositions possibles, il va « choisir la pire pour [lui], la meilleure pour [ses] adversaires ; et, dans cette position, ajustée, autant qu’il [lui]’était possible, aux manœuvres dont [il s’est] vu l’objet » (ROUSSEAU, 1817, 7:4). Rousseau retrouve ainsi la parole qu’il a perdue et ouvre « une surface de langage qui n’est jamais close, et où les autres vont pouvoir intervenir par leur acharnement, leur méchanceté, leur décision obstinée de tout altérer » (FOUCAULT, 1962, xii). Cette surface linguistique donne corps à un discours qui suit la logique du traité de Philidor, elle sert d’échiquier philosophique sur lequel les jeux d’imagination de Rousseau vont permettre de distinguer la réalité des apparences en retraçant l’origine des rumeurs colportées par ses persécuteurs et en attaquant leur logique immanente.
La deuxième fonction remplie par la structure ternaire est d’enseigner au public français à lire avec un esprit critique, à former des opinions justes et exactes. Aussi encourage-t-il le Français à juger par lui-même afin de « choisir l’opinion la mieux fondée» et de ne plus voir Jean-Jacques que « par les yeux d’autrui » (ROUSSEAU, 1817, 7:27). Philidor apprend à ses lecteurs à devenir de meilleurs joueurs, Rousseau, lui, souhaite en faire de meilleurs juges, des membres de la société autonomes, indépendants, capables de discerner le vrai du faux. Pour Rousseau, quiconque, même sans avoir lu ses écrits, « examinera par ses propres yeux son naturel, son caractère, ses mœurs, ses penchants, ses plaisirs, ses habitudes et pourra [le] croire un malhonnête homme, est lui-même un homme à étouffer » (ROUSSEAU, 1876, 531). Sa bonté naturelle ne ferait plus aucun doute à la lecture de ses œuvres, au travers desquelles il espère améliorer les hommes en leur donnant l’Héloïse et l’Émile, des traités de morale et de pédagogie. Pour lui, s’il reste incompris par le public, c’est que les gens ne le lisent pas ou qu’ils ne savent pas le lire. Il faut lire Jean-Jacques pour comprendre que son cœur est innocent et qu’il n’est en rien l’hypocrite, le plagiaire et le démon que le public s’imagine. Dans ses Confessions, Rousseau voulait se montrer tel qu’il était, il voulait révéler son cœur et son âme. Dans Rousseau juge de Jean-Jacques, il va aider les lecteurs à mieux le comprendre, leur montrer la meilleure façon de connaître qui il est réellement.
La troisième fonction de la structure ternaire est de faire la lumière sur le discours labyrinthique et obscur de ses ennemis, leurs manigances et leurs tromperies, de démêler les subtilités du complot, coup après coup. La cabale contre Jean-Jacques est si bien organisée qu’un « ange descendrait du ciel pour le défendre sans y pouvoir parvenir ». C’est « un projet médité de longue main, dont l’exécution lente et graduée ne s’opère qu’avec autant de précaution que de méthode, effaçant à mesure qu’elle avance et les traces des routes qu’elle a suivies et les vestiges de la vérité qu’elle a fait disparaître » (ROUSSEAU, 1817, 7:205-206). Rousseau imagine les « raisons dans le parti approuvé et suivi par tout le monde. » Ne pouvant raisonner sur des motifs qui lui étaient inconnus, il entreprend, entre toutes les suppositions possibles, « de choisir la pire pour [lui], la meilleure pour [ses] adversaires ; et, dans cette position, ajustée, autant qu’il [lui] était possible, aux manœuvres dont [il] s’est vu l’objet, aux allures qu’il a entrevues, aux propos mystérieux qu’[il] a pu saisir çà et là d’examiner quelle conduite de leur part eut été la plus raisonnable et la plus juste » (ROUSSEAU, 1817, 7:4). À l’instar d’un joueur d’échecs, il essaye de se mettre pour ainsi dire dans la tête de ses ennemis afin de comprendre leur motivation et de trouver la parade à leur machination : « Le joueur d’échecs est à la fois les blancs et les noirs » (STEINER, 1998,13). Ses « réponses dérivent immédiatement des premiers principes de la justice, des premiers éléments du bon sens », « elles sont applicables à tous les cas possibles d’une situation pareille à celle où il se trouve » (ROUSSEAU, 1817, 7:4). La défense de Jean-Jacques a ceci de stratégique qu’elle tend vers un objectif précis : si Jean-Jacques peut être jugé innocent par le Français, alors le lecteur pourra en faire de même (JONES, 1991,105). Rousseau plaide pour Jean-Jacques, pour sa réputation ; la « composante schizoïde des échecs » (STEINER, 1998, 13) permet à l’auteur de se dédoubler pour convaincre le Français de sa bonne foi et réfuter les allégations contre lui car « il demande une analyse à part et faite uniquement pour lui » (ROUSSEAU, 1817, 7:81). Pour enrayer « la persuasion commencée par la marche clandestine et tortueuse » de ses ennemis, il montre au Français, et à travers lui à tous ses contemporains, comment former une opinion bien fondée et reconnaître l’irrationalité des accusations dont il faisait constamment l’objet. Le complot fomenté depuis des années au moment où il écrit Rousseau juge de Jean-Jacques est quasiment indéchiffrable : « À force de temps, d’intrigue, et d’argent, de quoi la puissance et la ruse ne viennent-elles point à bout, quand personne ne s’oppose à leur manœuvres, quand rien n’arrête et ne contre-mine leurs sourdes opérations » (ROUSSEAU, 1817, 7:76). Persuadé que le réseau d’influence invisible mais extrêmement influent de ses ennemis ne pourrait en aucun cas résister à l’exercice de la raison, et, qu’il ne serait plus la risée de l’opinion, Rousseau transcrit les attaques, il leur donne corps pour mieux les démêler et les démentir. Comme aux échecs où il faut pouvoir se référer avec précision aux différentes parties de l’échiquier et désigner, sans ambiguïté, le déplacement des pièces, le Genevois se réfère rigoureusement aux étapes qui ont provoqué sa disgrâce, aux idées et aux mensonges qu’elles continuent à répandre. Rousseau expose les raisonnements de ses ennemis aux yeux du Français. Il transcrit les détails de la cabale pour mieux en révéler les faiblesses, les stratégies odieuses et malintentionnées de même que pour exposer les erreurs commises par ses ennemis. Il en restitue la logique immanente, les différentes variantes, les formes multiples et complexes. La succession des attaques depuis la première jusqu’aux plus récentes. Il met au jour les mécanismes, les ressorts « qu’on a pu mettre en jeu pour allumer et fomenter cette animosité si vive et si générale dont il est l’objet » et rend non seulement transparent le discours opaque de ses ennemis mais ouvre encore une surface où il dispose leurs arguments à sa guise, contre leurs attaques, organise sa défense afin de révéler plus sûrement au public les fausses calomnies qui ont sali son nom (ROUSSEAU, 1817, 7:165). En retraçant l’origine des intrigues et des diffamations, Rousseau leur donne un visage concret, il peut y répliquer, montrer l’ineptie des attaques dont il fait l’objet, et convaincre le Français, et avec lui tous ses contemporains, de mieux apprécier l’homme et la portée de son œuvre, de sa pensée et de son enseignement.
Dans Rousseau juge de Jean-Jacques, Rousseau, le joueur d’échecs forcené, s’inspire de la structure trifonctionnelle qu’utilise Philidor dans son traité pédagogique sur les échecs afin de se justifier, de contester les arguments avancés contre lui et d’exposer les mensonges du complot aux yeux de ses contemporains. Il théâtralise la persécution dont il se sent la cible et met en scène les principes essentiels de sa pensée systémique, une pensée rationnelle, qu’il articule autour de trois dimensions. La première est une dimension sociale grâce à laquelle il trouve enfin la parade aux manœuvres obscures et embrouillées de ses ennemis. Dénigré, emmuré dans le silence, il fait parler ses ennemis dont le mutisme l’avait muré dans le silence et ouvre un espace de dialogues dans lequel il va rationaliser la haine, le mépris et l’incompréhension qu’il suscite. La deuxième est une dimension temporelle dans laquelle sa situation présente est comprise comme la conséquence de décisions ou d’événements majeurs qui ne lui appartiennent pas, qui lui sont étrangères et hostiles. Il déconstruit la stratégie de ses ennemis pour en révéler les failles et prouver qu’elle ne repose sur aucune preuve tangible. La troisième dimension est une surface plane, un échiquier virtuel sur lequel Rousseau agence l’intégralité des faits et des relations complexes qui ont mené à sa disgrâce publique. Il modélise la forme labyrinthique de sa persécution pour la rendre compréhensible au Français et à tous ses lecteurs, qu’il invite à faire preuve de bons sens, à ne se fier qu’à leur propre jugement, à comprendre les manigances de ceux qui contrôlent l’opinion publique et les conséquences dramatiques que leurs actions ont eues sur son image publique.