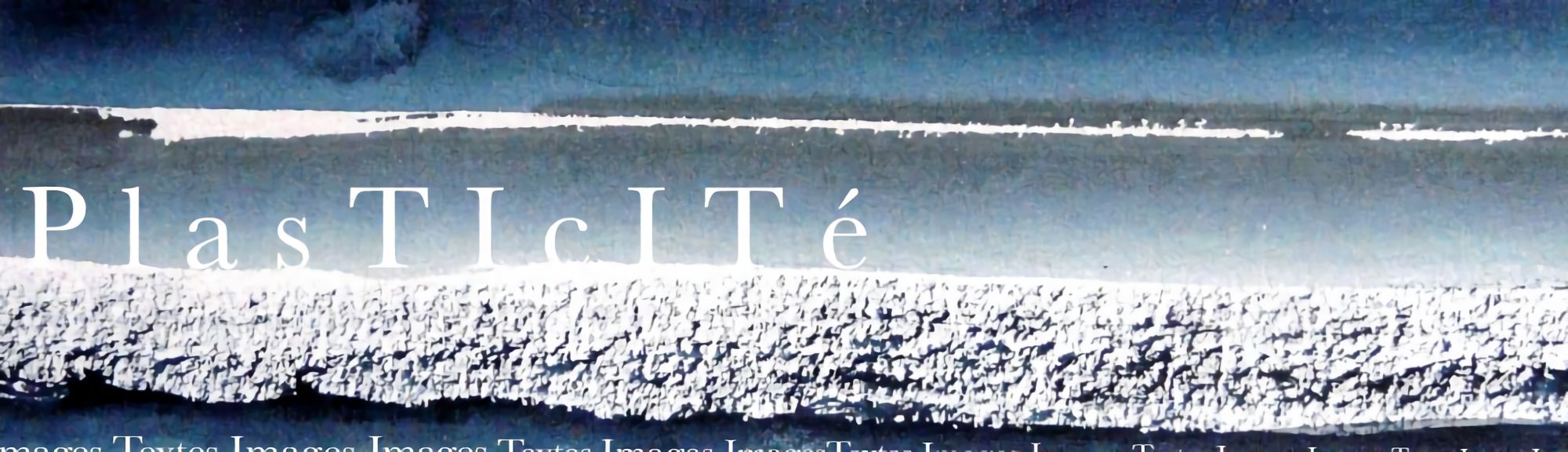Avec les trois volumes de la série de bande dessinée Du plomb dans la tête parus respectivement en France chez Casterman en 2004, 2005 et 2006, le scénariste français Matz (de son vrai nom Alexis Nolent) et le dessinateur néo-zélandais Colin Wilson n’ont pas seulement repris « la plupart des ficelles du polar moderne1 » : ils ont réussi « un brillant exercice de style, notamment grâce à la densité et à la saveur [des] personnages principaux2 ». Série « pleine de rythme et d’action3 », Du plomb dans la tête juxtapose souvent humour savoureux et violence des situations, truculence des dialogues et brutalité des actions. Sa vivacité narrative et son dessin aux « contrastes appuyés4 » en faisaient un matériau idéal pour le cinéma. La productrice américaine Alexandra Milchan ne s’y est pas trompée en soumettant la BD au scénariste Alessandro Camon, dès lors intéressé par le fait de transformer en scènes réelles ce mélange de sensations ainsi que l’intensité générale de l’œuvre. En 2012, c’est le réalisateur étasunien Walter Hill lui-même, maître du film d’action et du film noir hollywoodien moderne, qui a en réalisé la transposition à l’écran (Bullet to the Head en VO), d’après le scénario de Camon et avec la vedette de films d’action Sylvester Stallone dans le rôle principal. Considérant l’autorité dont jouissent encore le réalisateur et producteur, et la « star » aussi bien au sein de l’industrie cinématographique que dans l’univers du « polar d’action » en général, il nous apparaît pertinent de revenir en premier lieu sur les grandes lignes narratives et thématiques de ces deux œuvres, et de dresser un inventaire de leurs points communs significatifs. L’examen permettra bien entendu de distinguer leurs nuances esthétiques et leurs différences frappantes. En deuxième lieu, nous consacrerons notre analyse à deux aspects qui modifient selon nous la donne du matériau initial et pervertissent le processus de transformation médiatique de l’œuvre de Matz et Wilson : d’une part, la désambiguïsation partielle de l’ethos des personnages et même du narrateur ; d’autre part, la primauté de la figure actorielle sur la profondeur psychologique des protagonistes.
Contexte, rapprochements et lignes de fuite
Du plomb dans la tête, la BD, raconte une association improbable entre Jimmy, un tueur à gages poursuivi par ses commanditaires, et Carlisle, un policier lui-même menacé de mort. Le récit cultive dès ses premières pages l’ambiguïté héroïque et morale propre au « polar » en faisant d’un tueur brutal sans principes moraux (ou si peu) le héros principal. Autre attribut spécifique du genre « polaresque » : la métropole de New York où l’histoire se déroule correspond moins, comme l’écrit Marion François au sujet du stéréotype de l’agglomération new-yorkaise dans le roman policier « à une ville réelle qu’à une cité fantasmée, dont le lecteur retrouve les caractéristiques fixes de roman en roman : rues désertes, nuit, fleuves, canaux, terrains vagues, usines désaffectées, hôtels miteux, composent ce paysage littéraire de villes codées5 ». En faisant de ces stéréotypes des vignettes fourmillant de détails – Matz a fourni au dessinateur Colin Wilson quantité de photographies de Brooklyn et des villes où sévissent les protagonistes de l’histoire –, Du plomb dans la tête ne cache ainsi jamais sa filiation avec le roman noir américain, marqué par son réalisme, mais aussi par une forme d’étrangeté et une urbanité inquiétante, ainsi que par « son positionnement politique violent6 ».
En héritière du hard-boiled, la BD Du plomb... met en place une écriture (scénario et dessins, en fait) « traquant l’illusion garante de l’ordre et démystifiant le discours social7 » – notamment par l’évocation d’un complot lié à l’exécution d’un sénateur très en vue surpris en compagnie d’une prostituée mineure –, approche où se fait aussi ressentir « l’influence des techniques narratives cinématographiques8 ». Ce qui ne fait que renforcer a posteriori le potentiel – la légitimité, devrait-on dire – filmique de l’œuvre de Matz et Wilson.
Comme mentionné en introduction, c’est au réalisateur Walter Hill qu’a été confiée l’adaptation filmique de la bande dessinée. Étant donné que Walter Hill attache lui-même une grande importance au « dialogue entre des personnes qui ont un but commun mais des appétits et des besoins très disparates, de sorte qu'il y a toujours une sorte de friction qui circule dans tout le film [traduction libre]9 », il y a lieu ici d’étudier le jeu d’influences mis en place entre le récit papier et le film lui-même.
D’abord, Matz s’est sans doute inspiré de l’esprit des buddy movies policiers de Hill (notamment Le Bagarreur (Hard Times en version originale) (1975), et 48 heures (48 Hours en version originale) (1982), modèle du film du duo « flic / truand » mêlant humour, action, ambiance urbaine et nocturne, pour écrire Du plomb dans la tête. L’adaptation filmée par Hill ne serait alors qu’une sorte de « juste retour des choses » sur le plan de la référentialité. Ce mouvement de « transmission » entre les thèmes et idées de l’univers filmique de Hill et l’univers BD de Matz ne s’arrête pas là cependant, puisque en 2015 Matz a adapté pour le 9e art un scénario de Walter Hill, devenu la BD Balle perdue, dessinée par Jef et publiée aux éditions Rue de Sèvres. Le scénariste a récidivé l’année suivante chez le même éditeur avec Corps et âme, toujours dessiné par Jef et d’après un script de Hill.
Autre point qu’il semble intéressant d’analyser ici : dans le film de Hill, l’action se déroule à La Nouvelle-Orléans (comme Le Bagarreur) – lieu où se sont rencontrés Hill et Matz (ce qui a donné lieu aux collaborations évoquées ci-avant) –, métropole portuaire caractérisée par une densité urbaine importante opposée, comme l’explique le professeur de géographie et enseignant-chercheur Jean-Marc Zaninetti « à un espace rural de très faible densité, ce qui est en partie dû à l’environnement naturel très contraignant de cette région marécageuse10 ».
Pour Hill, transposer toute l’action à la Nouvelle-Orléans (quelques scènes clés s’y déroulaient dans le roman graphique et elle était la ville d’origine des tueurs Louis et Jimmy) lui permet d’explorer (et même de revenir à) un lieu propice à sa créativité. Cette transposition géographique ajoute un climat plus poisseux encore et un cadre davantage chargé d’histoire, de tensions raciales et de métissage.
Deuxièmement, Carlisle, le policier avec lequel le tueur Jimmy (interprété par Sylvester Stallone) se trouve contraint de faire équipe est devenu, sous l’impulsion du producteur Joel Silver qui tenait « à un personnage d’origine étrangère pour toucher un plus large public [traduction libre]11 », le policier Taylor Kwon (incarné par l’acteur étasunien d’origine coréenne Sung Kang). De la case à l’écran, Du plomb dans la tête subit donc de nombreuses hybridations et pour ainsi dire une ethnicisation marquée. L’hybridation formelle, pour en revenir à elle, est de toute façon un procédé qui constitue l’une des caractéristiques du roman noir, « genre labile, forme plastique, [qui] se prête facilement à l’hybridité générique : [...] hybridité avec le roman d’espionnage, le fantastique, le théâtre [...]12 ».
Il apparaît cependant que le scénario du film est beaucoup plus simpliste que celui de la BD. L’intrigue, lors de sa transposition à l’écran, a été réduite à un complot à la tête duquel se trouve un homme d’affaires afro-américain bien en vue des politiciens et de policiers, de Washington à La Nouvelle-Orléans. Dans la BD, Jimmy et son acolyte Louis abattent un sénateur sur ordre d’un commanditaire lui-même haut placé et ce « contrat » aura des répercussions à différents échelons du pouvoir. Dans le film, ils tuent un ancien policier corrompu de la police de Washington qui a aussi été le coéquipier de Taylor Kwon (donc l’agent avec qui le tueur Jimmy va s’associer) mais les ramifications sont moindres et la menace a été restreinte à quelques hommes de main. Somme toute, la bande dessinée utilise à son plein potentiel le sentiment de paranoïa et le caractère inextricable de son intrigue (les personnages ne savent plus à qui se fier) là où le film simplifie le propos et montre surtout comment l’étau se resserre autour du tueur Jimmy et du policier Taylor Kwon.
Par ailleurs, une différence de voix narrative se révèle frappante : la bande dessinée adopte une focalisation externe, tandis que le film est raconté à la première personne du singulier (par Jimmy, donc Stallone). Cependant la focalisation interne fixe ne tient pas (ce qui demeure une licence par rapport aux règles du genre), car nous accédons parfois à l’intériorité d’autres personnages (le « méchant » Keegan interprété par Jason Momoa par exemple) alors que nous serions censés suivre l’histoire depuis la perspective unique de Jimmy (en tout cas si l’on se fie à sa voix off, procédé hérité du film noir américain classique). Dans la bande dessinée, les récitatifs demeurent inexistants ou alors se limitent à une très brève mention du lieu, du temps (x jours plus tard, etc.) ; le ton et le style de voix narrative, de même que la gestion spatio-temporelle se veulent éloignés par exemple encore des récitatifs à la première personne tels que les emploie Frank Miller dans Daredevil et Sin City ou Ed Brubaker dans Fondu au noir.
Bien sûr, les deux récits, l’un papier, l’autre filmique, se rejoignent sur de nombreux points. Dans la BD, le découpage se veut forcément très net, au cordeau, épanoui dans la verticalité, avec profusion de gros plans, de plans poitrine et ou américains, un graphisme dynamique, des teintes sépia et des couleurs désaturées. Walter Hill adopte, pour conserver en quelque sorte l’énergie et la brutalité du graphisme, le procédé des surimpressions – fondus enchaînés – à tout bout de champ (marquant en cela une rupture avec le cinéma du XXIe siècle, qui, d’après Henri-Paul Chevrier, use peu voire n’use plus du tout de ce type d’enchaînement) et des filtres de couleurs sursaturées, en plus d’une ambiance majoritairement nocturne. Ajoutons que Hill reprend maintes situations de la BD, en particulier les scènes de discussion entre le tueur et le policier, qu’il s’agisse de conversations en voiture (importance du discours qui rejoint, sur le papier comme à l’écran, l’univers et l’énergie verbale et discursive du cinéma de Tarantino) ou dans un bar. Walter Hill, nous l’avons vu, considère que la joute verbale correspond à une « circulation de la friction13 » dans le récit, et il s’en donne ici à cœur joie, même si encore une fois comparés à la bande dessinée, les dialogues sont réduits à une suite de punchlines plutôt qu’à des débats quasi philosophiques sur l’amour, le sexe ou les chaussures de luxe. En passant pour ainsi dire du papier à la pellicule, le récit de Du plomb dans la tête subit une schématisation et une atténuation sur les plans esthétique, thématique et figural.
« Désambiguïsation » partielle de l’ethos des personnages et du narrateur, et primauté de la figure actorielle sur la profondeur psychologique
Rappelons qu’à l’origine, le récit se révèle riche en ambiguïtés, en particulier à travers le thème de la corruption qui sévit au sein des services de police et des milieux politiques. Walter Hill pour sa part s’est concentré sur La Nouvelle-Orléans, ville de son premier film Le Bagarreur qu’il revisite à loisir et dont il retranscrit l’ambiance urbaine et festive particulière entre autres à l’aide d’images de voitures de police stationnées devant des bars et des clubs. Hill réutilise aussi comme point de repère la centrale électrique de Market Street, structure abandonnée depuis 1973 et située le long du fleuve Mississippi, juste en amont de Crescent City Connection. Le réalisateur y avait tourné des combats à mains nues pour Le Bagarreur. Dans l’adaptation de la BD de Matz et Wilson, il y revient à la fois pour réactiver la mémoire des lieux de son premier film – La Nouvelle-Orléans représente en soi l’une des thématiques du cinéaste – et s’en servir comme d’un décor labyrinthique à plusieurs étages, délabré et parsemé de graffitis, « parfait pour une scène d’action finale [traduction libre]14 ». Cependant, l’image de la déliquescence ou du délabrement moral ne se résume pas qu’à ce contexte. Le réalisateur inclut aussi la capitale étasunienne (Washington, DC) dans la mécanique de duplicité de ses antagonistes, comme pour illustrer de façon métonymique la corruption systémique américaine. Cela dit, la morale subversive du film s’arrête à ces illustrations. Alors que le lecteur de la BD voyait le tueur Louis abattre un chien (qui avait eu le malheur de faire ses besoins près de ses « pompes à 2000 $ ») ou encore Jimmy tirer sans état d’âme sur des femmes, des jeunes filles ou un motard pourtant bon samaritain qui avait eu la gentillesse de le prendre en stop, le film, sans doute à cause d’une bonne morale hollywoodienne à respecter, accole un code d’honneur au personnage du tueur. Jimmy (via la voix de Stallone) énonce ainsi qu’il s’est fixé des règles : « jamais de femmes ni d’enfants ». Et le spectateur le regarde ne sévir, au bout du compte, qu’à l’endroit des pires criminels. L’ordre se trouve ainsi rétabli et la probité même la moins recommandable demeure sauve dans la mesure où une « bonne » conscience dicte les actes du personnage – Jimmy tirera certes sur Taylor Kwon, mais uniquement pour le blesser et in fine lui fournir l’excuse d’un rapport plausible et susceptible de le blanchir de toute accusation. Cette éthique et caractérisation en vérité emprunte davantage au récit policier traditionnel qu’au roman (et par extension au film) noir, dans lequel il est censé n’y avoir « ni rétablissement de l’ordre, […] ni bons et méchants15 ».
Une question se pose par ailleurs en ce qui concerne l’adaptabilité de l’anti-héros Jimmy à la figure de l’acteur « superstar » Stallone. Il faut reconnaître que ce choix, certes prompt à satisfaire les fans de films d’action (et donc à viabiliser la faisabilité du film), contribue à amoindrir l’ambiguïté axiologique du personnage principal. Avec Stallone en tête d’affiche, Du plomb dans la tête s’engage davantage sur la voie de « l’actioner » viril et volontiers ludique – à la manière des récents succès de l’acteur-réalisateur-producteur, par exemple la série de films Expendables –, ce qui modifie encore une fois la nature initiale du contenu narratif. Sur papier, Louis et Jimmy, les deux tueurs, faisaient figure d’anonymes en quête de légitimité. Le lecteur pouvait s’attacher sans jamais être certain de leur pérennité. Avec le visage, le corps et le vécu cinématographique de Sylvester Stallone, Jimmy acquiert la stature d’un héros que le spectateur sait d’emblée sinon invulnérable, à tout le moins appelé à rester vivant à l’issue de la confrontation finale.
De fait, ce point nous ramène à un désir figural primordial : celui de l’acteur derrière le personnage. Comme l’écrit André Gardies, « pour exister, le personnage doit littéralement prendre corps, celui du comédien-interprète16 ». Le comédien est « appelé à se fondre dans le monde diégétique et à se confondre avec le personnage qu’il interprète17 », ce qui fait des protagonistes du récit filmique des « figures hybrides » :
« personnages parce qu’ils s’inscrivent dans la logique du récit, comédiens parce qu’ils appartiennent au monde filmique et à la nécessaire ‘‘incarnation’’ que celui-ci suppose. L’analyse devra alors prendre en compte cette double ‘‘polarisation’’, liée à la spécificité du matériau cinématographique.18 »
À partir de ce constat, Gardies élabore une « figure complexe » – « la figure actorielle » – « qui résulte de la combinaison non pas de deux mais de quatre composants : l’actant, le rôle, le personnage, le comédien-interprète, chacun relevant d’un système propre19 ». Deux de ces composants semblent particulièrement significatifs à retenir pour développer ce « désir figural initial » évoqué dans le cas de Jimmy / Stallone : le rôle et le comédien-interprète. S’agissant du rôle, rappelons qu’André Gardies écrit qu’il
« serait [...] une sorte de « patron », comme ceux qu’utilisent les tailleurs pour confectionner leurs costumes.
En ce sens, il fournit un ensemble de règles et de contraintes. [...] Pour cela même il est aussi une sorte d’horizon d’attente pour le spectateur. Le comédien devra tenir (ou composer) son rôle en fonction de l’image attendue [...], qu’il veuille répondre à cette attente ou qu’il désire au contraire la surprendre.
[...] Le rôle constituerait [aussi] une sorte d’unité minimale du genre, et c’est en grande partie de lui qu’il tire les règles et contraintes qu’il impose à son tour. Entité culturelle, pré-existante à l’œuvre, il apparaît comme une figure relativement stable, susceptible néanmoins d’accepter des variations mineures [...].
Paradoxalement, le rôle, en dépit des contraintes qu’il impose, est donc un facteur de création : les règles étant respectées, la prestation du comédien est libre.20 »
En ce qui concerne le comédien-interprète, Stallone en jouant Jimmy confère à ce dernier avec l’énergie qu’on lui connaît, les personnalités de tous les autres héros – au moins ceux à succès –qu’il a incarnés. Jimmy n’est donc plus seulement à l’écran le tueur de la Nouvelle-Orléans, mais aussi tous les « durs-à-cuire » stalloniens du 7e art, de Rambo à Rocky en passant par Barney Ross, le chef de l’unité spéciale Expandables. L’aura de l’acteur prend même le dessus sur l’image du personnage interprété : Jimmy a beau apparaître tatoué, cette « chair » que le récit et la caméra créent est celle de l’acteur Stallone, que le spectateur reconnaît comme icône du cinéma d’action musclé, comme boxeur légendaire dans l’univers de Rocky, etc.
Il en résulte une certaine défiguration des actants initiaux du récit voire une reconfiguration héroïque et axiologique : Jimmy le tueur n’est plus une figure clivante dénuée d’empathie, il est le prolongement de son interprète susceptible de « sauver » (épargner, mettre hors de danger) femme, enfant et individus vulnérables que, dans tout film d’action hollywoodien moderne, l’on voit sinon défendus, au moins âprement vengés. En passant du livre au film, Du plomb dans la tête se rachète en quelque sorte une éthique, un code de « bonne conduite », et transforme ses archétypes les plus sombres en figures de rectitude politique – tout au moins celle qui prévaut dans le système hollywoodien. Divertissantes certes, mais moins clivantes qu’à l’origine.
Conclusion
Il est fréquent de penser la bande dessinée comme le matériau de projection idéale pour un film : les pages illustrées feraient ainsi office de scénarimages parfait. Une étude de l’adaptation filmique comme celle que nous venons d’évoquer montre cependant qu’en étant transposé à l’écran, un récit policier adopte des raccourcis, privilégie les ellipses et une relecture éditoriale, voire politique de manière à contenter les attentes industrielles et la « bonne conscience » spectatorielle que les producteurs pensent devoir satisfaire.
Marqué par la personnalité de son réalisateur considéré comme une forte tête du genre, mais atténué par le « politiquement correct » qui sévit toujours au sein de l’usine à rêves hollywoodienne, le film Du plomb dans la tête a transformé la complexité axiologique de son matériau BD original en spectacle sensoriel qui dépasse rarement – cela dit, est-ce un mal en soi ? – le degré premier du divertissement musclé à saveur policière. Phénomène intéressant, cette transposition constitue aussi l’occasion de voir s’opérer concrètement un glissement de genre, en partie grâce à la stature de son interprète principal : d’abord « simple » polar, l’œuvre vire au film d’action guerrier. Loin des cases de BD de Matz et Wilson, le propos du long-métrage n’est plus tant un complot politique et les exécutions qui en seraient les conséquences, que les confrontations physique barbares, thèmes chers à la filmographie de Walter Hill. Lequel y met à la fois toute la sophistication requise (voir à cet égard les nombreux effets de filtre et les surimpressions) et la brutalité formelle attendue.Stéphane Ledien2023-01-30T12:40:00SL