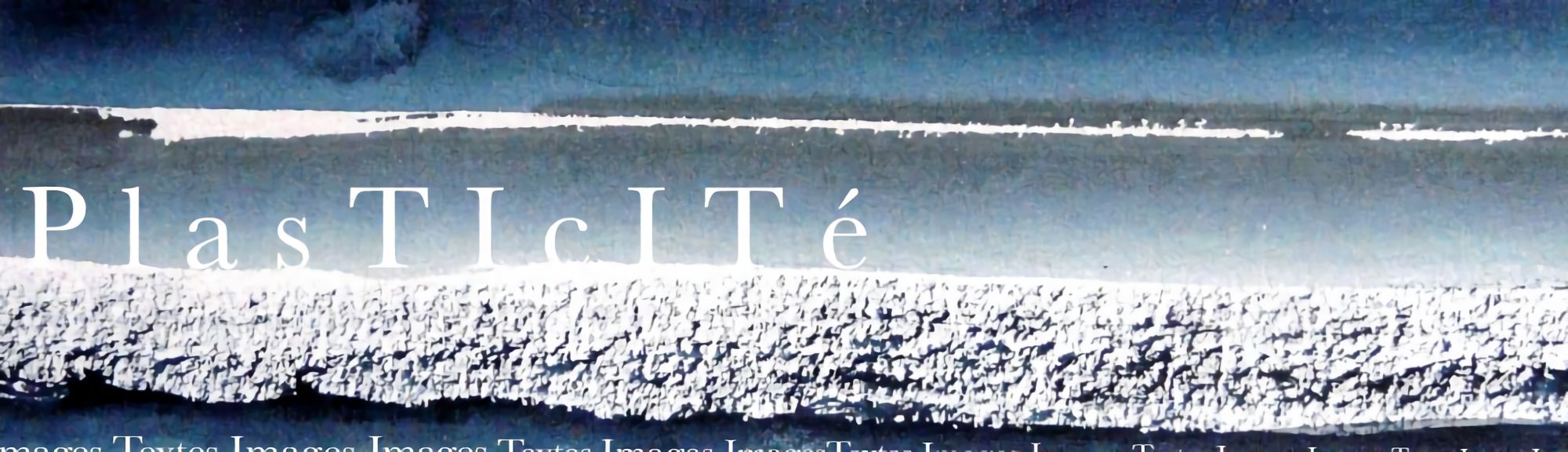Envisager la bande dessinée sous l’angle de la rhétorique, c’est poser la question d’une définition du sujet du discours et du sujet de sa réception. C’est-à-dire d’une position (le sujet est une position dans le champ du discours) là où l’intermédialité intéresse plutôt les relations, interactions, échanges et opérations (de transposition, d’influence, d’appropriation etc.) entre les différents médiums et langages de l’art. Y a-t-il un lieu du sujet, et un lieu pour le sujet, dans les relations intermédiales ? Dans le volume sur les théories du dispositif dirigé par Philippe Ortel, Michèle Bocquillon, à propos du dispositif (mais cela me semble valoir aussi pour l’intermédialité) évoque un « concept de l’entre-deux » qui permettrait de « dépasser les dichotomies binaires sujet-objet, extérieur-intérieur, technique-symbolique) pour faire place à un espace de médiation1». En prenant le contrepied de cette affirmation, j’interrogerai la manière dont le sujet (l’auteur, qu’il soit individuel ou collectif) dans le genre intersémiotique (sinon intermédial) qu’est la bande dessinée procède à mise en forme des sentiments (affects, passions, dans la rhétorique antique) en vertu d’une dialectique de l’ethos et du pathos, en d’autres termes de l’épanchement affectif (pôle pathique, ou pathétique, du pathos) et de la mesure éthique (pôle de l’ethos).
La bande dessinée n’a pas attendu la révolution numérique pour entrer dans le champ de l’intermédialité au sens où on peut l’entendre d’une intégration, dans le dispositif éditorial d’un média donné, d’énoncés exogènes provenant d’un média second. Si l’on pense aux montages visuels de Fred pour Philémon dans les années soixante-dix, de Marc Antoine Mathieu pour Julius Corentin Acquefacques dans les années quatre-vingt-dix ou des trois tomes du Photographe de Guibert, Lefèvre et Lemercier, on convient que ces albums relèvent de l’intermédialité au sens où ils intègrent des pratiques artistiques exogènes – gravure pour le premier, photographie pour les deux autres. Ce que mettent en œuvre ces trois exemples, selon des procédures diverses, c’est moins la rencontre d’énoncés hétérogènes que le travail dialectique de leur synthèse formelle dans la structure de la planche et de l’album de bande dessinée.
Si la bande dessinée se prête particulièrement à ces jeux d’intégration ou de télescopage intermédiatique, elle le doit à sa nature « d’objet mixte », combinaison intersémiotique de texte et d’image, ainsi que Töpffer définit ses histoires en estampes dans sa notice sur L’Histoire de M. Jabot, en 1837 :
« Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose d’une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d’une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose »2.
Relation de complémentarité intersémiotique entre texte et image, donc. Deux siècles plus tard, ou peu s’en faut, Alison Bechdel, à propos de son œuvre autobiographique, ajoute à la dimension sémiotique de la définition de Töpffer l’exigence éthique de vérité :
Dans l’articulation du verbal et de l’iconique se joue la prétention de la bande dessinée à dire une vérité dont le sujet – l’auteur – soit le garant. On comprend ainsi que la bande dessinée autobiographique soit le lieu privilégié d’un questionnement sur le sujet de l’énonciation, et de ce que la rhétorique ancienne nommait l’ethos – c’est-à-dire le caractère de l’orateur tel qu’il se dégage du discours. Le Journal de Fabrice Neaud ou Maus de Spiegelman prouvent si besoin en était que l’on n’en a pas fini avec la rhétorique du sujet. La question, comme nous allons le voir, ne se limite pas au seul champ de la bande dessinée autobiographique.
Bande dessinée et émotions
Parler de rhétorique des émotions et de construction rhétorique du sujet ne va pas de soi à propos de la bande dessinée. Peut-on parler de sujet individuel à propos des personnages de Töpffer ? M. Vieux Bois ou M. Cryptogame sont plutôt des personnages types, dans la tradition de la caricature de mœurs romantique (Grandville, Daumier, ou leurs prédécesseurs anglais Cruickshank ou Rowlandson), à moins qu’ils ne soient plus justement conçus comme des programmes graphiques, le personnage n’étant que le support et le vecteur d’expériences formelles nées, comme l’écrit Töpffer, d’un « bond de plume ».
La publication dans la presse écrite, au cours du XIXe siècle, a accusé cette vacuité subjective des personnages de comics. Thierry Smolderen a montré comment la bande dessinée autour de 1900 était poreuse aux dispositifs communicationnels et de divertissement contemporains – la bulle de paroles au moment du phonographe, les constructions chronophotographiques de Muybridge et le kinétoscope d’Edison dans la restitution du mouvement, voire les nouvelles expériences corporelles suscitées par les parcs d’attraction et Luna Park dans Little Nemo in Slumberland3. Le Petit Sammy Sneeze de Winsor Mc Cay est ainsi une pure mécanique du gag, que le lecteur remonte chaque semaine, pendant deux ans (depuis le 24 juillet 1904), dans le supplément du dimanche du New York Herald, pour générer par des moyens immuables d’une semaine sur l’autre des phénomènes chromatiques et graphiques spectaculaires et inédits4. Support d’expériences graphiques et plastiques, le personnage de la bande dessinée burlesque des années 1890-1900 est littéralement un personnage sans histoire et sans passé ; l’éternel présent recommencé des aventures de Sammy (son éternuement) épouse la temporalité périodique de la presse.
Ceci était déjà en germe dans les albums de Töpffer : les personnages de Töpffer sont à la fois pris dans l’emballement d’une action graphique et plastique qui métaphorise celle du progrès absurde, de ce « vent du progrès » selon les termes de l’auteur dans le petit essai incisif qu’il lui a consacré5, et comme vierges de passé et de mémoire, disponibles à chaque case pour une nouvelle expérience graphique. Cette saccade de l’emballement mécanique et de la répétition produit cette syncope particulière aux aventures de Töpffer. Elle explique aussi, autant qu’elle en est la conséquence, cette spécificité du récitatif töpfferien, sur laquelle on a peu insisté : un texte où les noms propres (des personnages) ne connaissent pas la pronominalisation, chaque personnage, clone de lui-même, s’offrant à chaque case disponible pour de nouvelles opérations plastiques.
Est-ce que pour autant ces personnages, ces caractères dé-subjectivés, ne suscitent pas d’émotions ? On ne saurait l’affirmer. Sujets vides, supports de pures expériences graphiques, ils n’en suscitent pas moins une émotion comique qui se déploie dans une polarité entre :
-l’explosion burlesque d’une part : c’est la lignée de Töpffer jusqu’aux burlesques américains F. B. Opper et O. Dirks, via le nonsense de Frost ou de Wilhelm Busch : cette veine correspond au « comique absolu » des caricaturistes anglais dont Baudelaire fait l’éloge6 ; un pôle dionysiaque, bakhtinien, du côté de l’éclat de rire libérateur, du rire convulsif qu’entraine le « grotesque » ;
-la distanciation ironique d’autre part : c’est la lignée de Christophe en France, depuis Cham et Doré, jusqu’au Pinchon de Bécassine, dont le burlesque est toujours tempéré, surveillé, contrôlé par la grammaire du récitatif ; « comique significatif » selon Baudelaire, où le rire est du côté de la sanction des écarts et de la réaffirmation des normes.
Dans cette fiction d’une histoire sans mémoire, sans cesse recommencée, qu’induit la forme courte du gag, produit de la périodicité de la presse écrite, la palette des émotions va de plus en plus se nuancer. En témoigne la poésie de Little Nemo de Mc Cay dès 1905 ou de Gasoline Alley de Frank King à partir de 1918. La chute hebdomadaire de Nemo projeté de son lit dans la célèbre série de Mc Cay, dissocie d’ailleurs l’interruption de l’histoire de la chute du gag : la chute physique coupe court à l’histoire saisie au beau milieu de son mouvement de gradation et d’amplification, sans pour autant préjuger de la poursuite du rêve dans la planche hebdomadaire suivante (les rêves de Little Nemo s’arrangent en de longues séquences qui courent parfois sur plusieurs mois). Avec les années 20 puis 30, l’histoire désormais à suivre (« to be continued ») se fait épopée avec Milton Caniff, Alex Raymond, Hal Foster ou Chester Gould, et c’est le suspense, la peur, le frisson érotique qui s’ajoutent à ce que l’on continue d’appeler des comics (ou funnies) dont la vocation première était le rire. A partir des années soixante-dix, à la suite du Maus de Spiegelman, la bande dessinée s’ouvre au vécu personnel, à l’autobiographie (Jean-Christophe Menu, Edmond Baudoin, Marjane Satrapi), au témoignage (Joe Sacco, Emmanuel Guibert) ou au récit de filiation (Alison Bechdel, Tardi) avec toute la palette d’émotions qui s’y rapportent, dans des configurations et thématiques narratives qui privilégient l’histoire familiale, tragique dans Maus ou L’Ascension du Haut Mal, la maladie comme catalyseur de la refondation de soi (Mattt Konture, Élodie Durand, Julia Wertz), la découverte et l’acceptation de son identité sexuelle (Fabrice Neaud, Alison Bechdel, pour ne citer que quelques noms emblématiques).
La bande dessinée n’est pas seulement un espace d’interactions potentiel, un jeu d’expérimentations graphiques et plastiques. Lorsqu’elle devient transmission d’une expérience, que celle-ci soit réelle, fictionnelle ou médiatisée par la fiction (chez Manu Larcenet par exemple) le sujet–auteur va se positionner comme instance d’expression et de canalisation, de régulation des émotions.
Sémiotique des émotions
La rhétorique des émotions ne se confond pas avec la sémiotique : elle implique la situation d’énonciation du discours, et l’effet de ce discours à la fois sur le sujet de son énonciation et celui de sa réception, principalement à travers les catégories aristotéliciennes de l’ethos et du pathos (nous y revenons plus loin). La bande dessinée fait l’usage d’une signalétique des émotions, fortement codifiée et conventionnelle. Il ne s’agit pas d’identifier tous les procédés visant à représenter une émotion dans la bande dessinée. Tout cela est bien connu. Scott Mc Cloud pose la question avec une fausse ingénuité : « Peut-on représenter les émotions ? » dans la bande dessinée (c’est le titre du chapitre V de L’Art invisible), avant de décrire les graphèmes et procédés constitutifs de ce qu’il nomme le « langage formalisé » des émotions (plaisir, désir, colère, crainte etc.) et des sensations corporelles (froid, chaud, douleur etc.)7. Ces conventions relèvent d’une signalétique des émotions : elles concernent ce que Groensteen, après Mort Walker, appelle les emanata : gouttelettes, spirales et autres étoiles qui « viennent en renfort de l’expression physionomique »8. Les pictogrammes, à la différence des emanata, sont contenus dans des bulles « au même titre qu’une phrase » poursuit Groensteen : ce sont des énoncés purement émotionnels, pourrait-on dire, qui participent du langage propre à la bande dessinée. Le texte lui-même, le lettrage, la police et la taille des caractères, sont porteurs d’expressivité, comme le relève aussi Scott Mc Cloud. C’est également tout un langage du corps, une nomenclature des gestes et des postures comme traduction de l’état intérieur, qui s’exprime dans la bande dessinée mais ne lui est pas propre : Hans Belting rappelle comment le peintre Charles Le Brun, à la fin du XVIIe siècle, théorisait sa « grammaire universelle de l’expression des passions », qu’elles gouvernent le corps ou le visage – Le Brun insistait par exemple sur les sourcils, comme « aiguilles indiquant l’état du mouvement de l’âme »9.
Cette signalétique de l’émotion parait portée à son comble dans le manga, tout au moins au regard des conventions graphiques occidentales : « tout est signe » écrit Jean-Marie Bouissou, pour rendre perceptibles les émotions en vertu d’une rhétorique qui relève d’une « survalorisation de l’empathie »10. C’est ainsi que le manga tend à « hystériser » l’expression de l’émotion par des procédés qui lui sont propres : en particulier la taille des yeux, plus que jamais « miroirs de l’âme » (comme le rappelle Groensteen avec quelque facilité11) et surtout surface réfléchissante dans laquelle le jeune lecteur ou la lectrice des shôjo se projette et se reconnait. Les fameuses « grimaces d’émotions » vont jusqu’à la déformation grotesque du personnage en animal ou marionnette gesticulante et grimaçante. Cette défiguration se fait aux dépens de l’identité graphique du personnage, mais elle n’affecte pas son identité de caractère (psychologique et morale) : le grotesque n’est que la marque de l’irruption passagère de l’émotion dans un caractère dont elle n’altère pas la cohérence. Cette sémiotique des émotions explique la physionomie des visages de personnages qui en réalité, contrairement ce qui est souvent affirmé, ne sont pas occidentalisés : « Les visages minimalistes du shônen et du shôjo manga, écrit Bouissou, ont été conçus afin de faciliter au maximum l’expression graphique des sentiments et des émotions inscrits dans leurs immenses yeux ronds »12.
S’agit-il de représenter les émotions, ou/et de les faire partager par les lecteurs ? Reconnaître une émotion attribuée à un personnage n’implique pas de la ressentir soi-même13. Ainsi, dans cette vignette d’Astérix Légionnaire (Illustration 1) : la peine d’Obélix amoureux de Falbala, qui s’effondre dans les bras de son ami, n’est bien évidemment pas ressentie par le lecteur (même si elle l’est par les personnages, compatissants), elle participe du comique. Comique de répétition : c’est la mécanique de la plainte amoureuse chez Obélix dans tout le début de l’album, jusqu’à son dénouement où cette mécanique se déplace en fin de compte sur Astérix. Comique de dissonance : tomber amoureux ne fait pas partie du « programme comique » porté par Obélix et de son « cahier des charges » narratif (donner des baffes aux Romains et manger du sanglier). Or la gestuelle d’Obélix dans cette scène relève clairement du burlesque. S’il y a dissonance entre le prédicat (tomber amoureux) et le thème (Obélix), cette dissonance est en fin de compte versée au profit du programme comique et iconographique du personnage : Obélix reste ici, en dépit de sa métamorphose amoureuse, on ne peut plus fidèle à lui-même. Astérix plie en effet sous le poids d’Obélix, comme le suggèrent les lignes cinétiques tracées par Uderzo : Obélix est amoureux, certes, mais surtout il est lourd. Le burlesque est porté en partie par l’expressivité du texte : l’onomatopée infantile (le « bouhhouh » infantile du caprice) et la taille de la bulle, à l’aune de celle du personnage. S’il y a bien dissonance entre le sentiment et le personnage, ce sentiment s’exprime graphiquement dans une parfaite conformité avec l’identité graphique de ce personnage et son programme comique : ce deuil amoureux n’est pas « gros », pourrait-on dire avec Obélix, il est seulement « légèrement enveloppé »…
À l’opposé de cette distanciation comique, le lecteur de bande dessinée peut éprouver aussi, par une forme de contagion émotionnelle, une relation de sympathie (au sens étymologique du mot) à l’égard du personnage et ressentir, plus ou moins filtrée par la médiation fictionnelle, le contenu affectif de ce que celui-ci éprouve. Groensteen, dans son Système de la Bande dessinée, étudie ainsi ce qu’il appelle une « rhétorique de l’émotion » à l’œuvre dans les mangas. Cette rhétorique ne réside pas uniquement dans la signalétique évoquée plus haut (les yeux, les pictogrammes et emanata, la fonction expressive du décor souvent minimaliste qui est un marqueur émotionnel), mais également dans la mise en page. Ainsi dans la planche d’un shôjo manga, Peach Girl de Miwa Ueda, qu’analyse Groensteen, c’est toute la structure du multicadre qui est soumise à l’expression de l’émotion : images à fond perdu, incrustations, « perméabilité » des divisions internes du cadre (absent ou franchi). Le débordement du cadre par la figure sert une rhétorique de l’épanchement : au sens physique d’un fluide qui excède le vase qui le contient, et au sens psychologique d’une émotion qui se déverse par effusion. L’effet de cette rhétorique de l’épanchement est celui de la contamination émotionnelle, où la lectrice éprouve la joie (en l’occurrence, la joie d’être aimée) de l’héroïne : « Le monde désigné par la fiction communique avec celui dans lequel vit la lectrice ». Cette rhétorique « invite à la projection dans le monde irréel de l’héroïne et à l’identification avec elle », écrit Groensteen14.
Cette rhétorique des émotions peut s’analyser dans les termes rhétoriques du couple ethos / pathos tel qu’il a été formalisé par Aristote, et dont ont hérité les traités de rhétorique latins (Rhétorique à Herennius, traités de Quintilien et Cicéron). Cette polarité, qui on l’aura remarqué évince ce qui était le troisième élément de la triade des preuves technique du discours, le logos, parait fructueuse pour rendre compte de l’utilisation des émotions dans ce souci de justesse dont parlait Alison Bechdel.
Ethos / pathos : la balance des émotions dans la bande dessinée
Rappelons brièvement ce dont il s’agit lorsque nous évoquons les catégories rhétoriques de l’ethos et du pathos. Aristote (Rhétorique, II, 2-4) distingue trois catégories de preuves mobilisées par l’orateur pour convaincre. Ces preuves touchent d’une part au discours lui-même (logos), d’autre part à l’ethos de l’orateur (son caractère tel qu’il se manifeste à travers le discours) et aux émotions qu’il inspire aux auditeurs – le pathos15. L’ethos de l’orateur donne crédit à son discours, produit la figure d’un caractère moral, digne de confiance ; le pathos vise l’auditoire, ses dispositions morales et psychologiques, dont l’orateur joue pour créer et mesurer ses effets.
Chez Cicéron, puis à sa suite chez Quintilien, la balance ethos / pathos, qui recoupe chez Aristote le couple orateur / auditeur, en vient à définir une différence de degrés sur l’échelle des « passions » (c’est-à-dire des émotions). Quintilien (Institution Oratoire, VI, 2) range sous l’ethos (mores, selon la traduction latine), les émotions calmes et mesurées (lenes), la douceur et la bienveillance, un état affectif continu et stable ; à l’opposé, le pathos (adfectus) recouvre les émotions vives (vehementes), un état trouble et violent, une irruption momentanée et soudaine de l’émotion. L’ethos est du côté de la mesure, le pathos de l’excès. Selon Cicéron, l’orateur doit se garder tout autant de l’épanchement pathétique (où risque de se perdre la technique de l’art), que de la froideur impavide pour viser à une alliance des deux, un pathos tempéré par l’ethos. Comme l’écrit Perrine Galand-Hallyn, « Pour Cicéron, l’orateur n’est jamais si émouvant que lorsqu’il réussit à tempérer la force oratoire du pathos au moyen d’un ethos fait de dignité, de vertu civique et d’humanité (celle du bonus vir) qui lui confère toute garantie morale »16.
Cette polarité structure durablement le discours sur l’art dramatique, les arts figuratifs et la littérature. Le Paradoxe sur le Comédien de Diderot plaide pour une forme de détachement technique du comédien par rapport à son rôle et aux sentiments qu’il exprime. Au XXe siècle, la méthode Stanislavski sera du côté du pathos, la distanciation brechtienne du côté de l’ethos. La réflexion de Lessing sur le groupe statuaire du Laocoon (1766) à la suite de Winckelmann, y voit un admirable exemple de pathos contenu. Pour Lessing, le sculpteur s’est « volontairement limité » : il s’agit de « soumettre l’expression à la première des lois de l’esthétique, celle de la Beauté » et de « rester mesuré dans l’expression de la douleur »17. Le Laocoon réalise en somme l’idéal classique d’une passion dont l’expression est canalisée, limitée, tempérée par la mesure et la raison18. Cette dialectique de l’ethos et du pathos peut être analysée à l’œuvre, parmi les arts figuratifs, dans le champ de la bande dessinée.
La ligne claire d’Hergé se situe indubitablement du côté du pôle éthique. Le reproche couramment fait à Hergé par ses détracteurs est celui d’une froideur tant graphique qu’émotionnelle. Hergé lui-même recourt à une métaphore calorimétrique pour expliquer le passage du crayonné au dessin final, à ce qu’il est convenu d’appeler la « ligne claire »19 :
« Quand je crois avec toute la spontanéité, toute l’irréflexion nécessaire, et toute l’inconscience possible, être parvenu à un bon résultat, je refroidis alors mon dessin par un calque et je reprends les traits qui me semblent les meilleurs, et qui me paraissent donner le plus de mouvement, d’expressivité, de lisibilité, de clarté. Rien n’est réfléchi au départ mais tout est refroidi après ».
La ligne claire, écrit très justement Jan Baetens, est chez Hergé un effort « pour domestiquer un graphisme à l’origine très mouvementé et incertain » alors que chez ses imitateurs il s’agit de « fixer encore davantage une image déjà immobile »20. La comparaison utilisée par Hergé ne concerne pas uniquement le mouvement et la saisie de l’« instant prégnant » sur la courbe du mouvement, elle a aussi à voir, Hergé le suggère lui-même, avec l’humeur et la passion que l’on tempère. Hergé au terme de son travail parvient à un dessin « de sang-froid » pourrait-on dire. Pour reprendre les catégories de la rhétorique, l’ethos canalise et tempère la vigueur expressive du dessin, son pathos. Nul épanchement chez Hergé, à l’exception des vignettes célèbres de Tintin au Tibet (planche 35), suffisamment rares pour toucher durablement l’esprit et la mémoire du lecteur.
On pourra situer, parmi bien d’autres, Craig Thompson (Blankets, 2003) à l’opposé d’Hergé, sur le pôle pathique de l’expression des émotions. Compte non tenu des différences génériques (une autobiographie dessinée pour Thompson, une mise à distance du moi chez Hergé), les effets pathétiques très maîtrisés chez Thompson ne relèvent pas du classicisme hergéen. Ainsi, dans cette planche où Raina téléphone depuis une cabine du Michigan et dit à Craig combien elle souffre de son absence (illustration 2)21. Le fond de nuit noire expressif (le lieu, attribut de la figure, exprime sa solitude), la suppression de la subdivision interne du cadre entre la première et la seconde image, les figures de mots abondantes (aposiopèse, anacoluthe, polysyndète), le langage du corps et le décrochement expressif de la vignette finale qui matérialise à la fois la séparation et l’acmé émotionnel de la confession amoureuse : autant de procédés spectaculaires qui participent de la rhétorique (presque maniériste) d’un épanchement qui concerne, tout autant que l’émotion du personnage représenté, celle que le dessinateur jadis destinataire de l’appel éprouva et éprouve encore en la dessinant.
Cette dialectique de l’ethos et du pathos permet de repenser à nouveaux frais le rapport de complémentarité chez Edgar P. Jacobs entre l’image et le texte très abondant, que ce soit dans les bulles de paroles ou les récitatifs. Jacobs on le sait est un auteur particulièrement bavard, ce qui peut décourager le jeune lecteur (ou moins jeune) : cette prolixité verbale est une signature de son art dès le Secret de l’Espadon22. La redondance du texte et de l’image chez l’auteur de Blake et Mortimer est souvent perçue comme une lourdeur et une maladresse : si le texte joue chez Jacobs pleinement sa fonction de relais, au sens défini par Barthes (la prise en charge par le texte de ce que l’image ne peut signifier à elle seule), il paraît parfois pauvre en contenu informationnel. À l’instar du commentaire sportif, il ne fait que confirmer ce que l’image suffit souvent à désigner. La lutte de Blake contre Olrik et ses complices dans SOS Météores, dans l’appartement du faux professeur Labrousse (p. 44) est commentée par un récitatif continu qui épouse le découpage séquentiel de l’action : « Le bandit recule en titubant et heurte une table basse qui bascule… » (strip 1, case 3), « …Et l’entraîne, le faisant s’écrouler de toute sa masse sur le parquet ! » (strip 2, case 1). L’intérêt informationnel de ce récitatif est nul.
Mais sa fonction est ailleurs. Plastique et chromatique d’une part (la couleur du cartouche bleu sur le fond jaune pâle des murs du salon et son passage au jaune puis à l’orange scande les continuités et les ruptures de l’action tout en contribuant à l’équilibre esthétique de la planche), émotionnelle d’autre part. Le rapport de complémentarité entre texte et image joue dans les deux sens : le texte, dans les moments d’action, parait insuffler une énergie que l’image peine à restituer – dans cette même scène de SOS Météores la balourdise de Jacobs est patente dans le rendu expressif du mouvement, si on le compare entre autres à Hergé. Ailleurs, le texte du récitatif vient au contraire tempérer et contenir la violence de l’image. Ainsi dans Le Piège diabolique, la représentation panoramique des ravages de la guerre atomique sur les bords de la Seine « en ce sombre XXIe siècle » est commentée, dit le récitatif, par « la voix impassible d’un speaker », à la manière ici aussi d’un reporter sportif qui représente le narrateur au sein même de la fiction (p. 37, strips 2 et 3)23. Le texte du récitatif semble d’abord enchérir sur cette violence (réprimée à l’époque par les censeurs qui interdisent la parution de l’album en France en vertu des lois de juillet 1949 régulant les publications à destination de la jeunesse) :
« … Et soudainement surgit autour d’eux, en une vue apocalyptique, le site de la Roche Guyon en proie aux convulsions d’une gigantesque bataille !... Environnés de fulgurantes déflagrations, chars monstrueux et avions robots s’affrontent en un combat sans merci […] Mais la scène change, brusquement remplacée par une vue intérieure de la cité. Vomissant de longs jets incandescents, une énorme machine s’avance pesamment le long des galeries qu’elle nettoie méthodiquement !!! » (strip 2, strip 3 case 2).
Mais le « combat sans merci » ou les « vaillantes troupes » évoquées par le speaker rattachent la scène apocalyptique au registre de l’épopée. L’accumulation des adjectifs et adverbes longs, les participes présents et passés en apposition, l’élision des déterminants (« chars monstrueux et avions robots »), ou ne serait-ce que la longueur des phrases et des propositions, atypique dans une bande dessinée, annexent l’image à une configuration discursive globale qui en atténue la charge violente. La violence de l’image est en partie médiatisée par la syntaxe discursive qui impose un ordre au chaos. Elle l’est également par le découpage de la planche et les effets de symétrie axiale qui contiennent visuellement le pathos de la guerre. Texte et découpage participent d’une poétique du pathos tempéré et canalisé par un ethos du conteur, dont la photographie de l’auteur en 4e de couverture des albums donne une image chic et désuète, sagement composée24, à l’époque où la production d’un Stan Lee ou d’un Jack Kirby par exemple construisent un tout autre ethos du dessinateur de bande dessinée…
La question de la maîtrise des passions est un point central dans la bande dessinée autobiographique. Le branchement direct de l’écriture (graphique et verbale) sur l’émotion, le travail brut de la matière émotionnelle (pensons aux dessins bouleversants, réalisés du fond de la maladie même, qu’Elodie Durand insère dans La Parenthèse), lorsque celle-ci est particulièrement intense, appelle une configuration formelle propre à la contenir, ce que Proust nommait dans Le Temps retrouvé « les anneaux nécessaires d’un beau style ». Cette dialectique de l’émotion et de la mise en forme est au cœur de Maus : les souris, Spiegelman s’en est expliqué dans MetaMaus (qui ouvre les coulisses de la création de son chef-d’œuvre), incarnent la nécessaire médiation du passé, vécu par le père déporté à Auschwitz, par la fiction. Elles permettent à la fois une distance nécessaire et vitale par rapport à l’horreur, et la possibilité, le pathos ainsi conjuré, de s’approcher au plus près du témoignage paternel et de la douleur vécue. « Ces masques d’animaux, explique Spiegelman, m’ont permis d’approcher de choses sinon indicibles […]; paradoxalement, si les souris permettaient une distanciation par rapport aux horreurs décrites, elles permettaient simultanément à moi et aux autres d’aller plus loin dans le matériau »25.
Les souris conjurent l’invasion pathique dont Spiegelman avait été victime au moment du suicide de sa mère Anja en 1968, crise psychique et existentielle dont témoignent dans Maus les planches de Bienvenue sur la planète Enfer et le premier essai de Maus dans Funny Animals en 1972. La violence expressionniste de ces premiers essais autobiographiques plus ou moins assumés, dévaluée par ses excès mêmes, va ensuite être canalisée progressivement au cours d’une longue gestation du projet qui aboutira aux deux tomes de Maus. Cette canalisation de l’émotion par la fiction qui la contient – la fiction est un contenant psychique et formel – comme chez Hergé mais avec des enjeux existentiels semble-t-il plus cruciaux, est le résultat d’un processus de saisie de la violence du réel – tel qu’elle est transmise à Art par son père Vladeck – par une discipline graphique et des choix formels propres à l’exprimer. La troisième partie de Metamaus (« Pourquoi la bande dessinée ? ») expose de nombreux dessins préparatoires des vignettes et planches de Maus, du premier état de la représentation, dessin hérissé de l’esquisse aux crayons de couleurs violemment hachuré, à sa mise en forme finale au feutre noir. Un travail de décantation de la matière brute du réel, déjà médiatisée par le récit paternel ; un « dessin refroidi », dirait Hergé, mais qui garde la vibration brûlante de la sensation première.
L’Arabe du futur de Riad Sattouf26 présente un autre exemple remarquable de cette canalisation du pathos par l’ethos. Chez Sattouf, un peu comme chez Spiegelman ou encore Marjane Satrapi, le contraste est remarquable entre la placidité stratégique prétendument enfantine du dessin et la violence du contenu émotionnel rapporté. Cette tension s’observe dans les autres séries de l’auteur, de Pascal Brutal à La Vie secrète des jeunes, voire sur un mode plus léger dans les Cahiers d’Esther (qui restitue avec une crudité comique très juste le langage des pré-ados d’aujourd’hui). À l’instar de Maus, la densité de ce qui est vécu par l’enfant Riad fait l’objet d’une mise en forme graphique qui la contient et permet en effet d’aller très loin, sans concession, dans la représentation de la violence. La scène située à la fin du chapitre 3 du premier tome est à cet égard remarquable27 (voir illustrations 3-4-5). Le petit Riad, âgé alors de six ans, en Syrie, malade, le front brûlant et suant, observe par la fenêtre de sa maison les enfants jouer avec un chiot. Le jeu d’abord innocent tourne à la séance de torture. Le chiot se fait empaler sur une fourche, puis décapiter d’un coup de pelle. La scène est dure, traumatisante pour l’enfant dont on comprend bien qu’il en ait gardé le souvenir, restituée dans sa brutalité difficilement soutenable. La simple narration séquentielle des faits consigne l’action dans sa montée en puissance : le jeu tout d’abord avec le chien, le chien pris ensuite comme objet de jeu (un ballon), puis le jeu devient cruel (le chien est lancé en l’air), cette cruauté est celle d’un bourreau (l’empalement du chien), jusqu’à la mise à mort sous les rires du groupe assemblé. La mère, d’abord spectatrice elle aussi depuis la fenêtre, porte seule le sentiment d’indignation pendant la scène ; elle descend ensuite dans la rue pour intervenir, en vain, et la décapitation de l’animal la plonge dans une « crise de nerfs » à laquelle l’enfant ne peut qu’assister depuis son poste d’observation, interdit et impuissant (p. 145, Strip 1, Case 3). C’est aussi quelque chose comme une blessure infligée à l’image maternelle qui se joue dans cet épisode autobiographique.
La narration de l’action, qui s’ancre dans l’expérience jadis vécue par l’auteur, se fait ici dans la mise à distance formelle de tout pathos : le dessin ne se départit pas de la stylisation comique des personnages, la colère de la mère est exprimée par les moyens conventionnels de la bande dessinée (bulle hérissée de colère, spirale du mouvement, onomatopées), et le trouble du petit Riad est aussi bien porté sur le compte de la fièvre que de l’émotion (le front brûlant, la distorsion de l’espace qui ondule littéralement sous les pas de l’enfant qui tient à peine debout). Le récit reprend sans pause, la scène traumatisante semble un maillon de plus dans le quotidien des Sattouf au lieu de constituer une coda ou un point d’orgue dramatique – il y a en effet en BD tout une syntaxe du pathétique comme de son évitement. Le style prétendument enfantin du dessinateur (qui consonne d’ailleurs avec sa personne, son physique et la voix fluette dont il joue dans les médias) est en réalité la marque d’un ethos vigoureusement campé et défini qui constitue sa grande force : ses albums (voir aussi Esther) sont un observatoire implacable de la vie contemporaine, imperméable aux édulcorations et aux négoces prudents du politiquement et moralement corrects.
La plupart des exemples choisis ici (Hergé, Jacobs, Spiegelman, Sattouf) se situent sur le pôle éthique de la balance rhétorique : c’est une singularité dans un art aujourd’hui où prédomine le pathos, que ce soit dans le registre sentimentaliste du shôjo manga ou de la violence complaisante des comics mainstream du type Marvel (musculature surdimensionnée des héros machiniques, couleurs agressives, cadrages et points de vue hystérisés). D’autres exemples pourraient être évoqués. Je pense à la poétique des émotions à l’œuvre chez Chester Brown ou Nick Drnaso : chez l’un et l’autre, avec des décisions formelles certes bien différentes, la mise à distance apparente de l’émotion – par le choix du gaufrier, le point de vue en plongée et les plans moyens chez Brown, le découpage, les couleurs en aplats, l’inexpressivité des visages chez Drnaso28 – est en fait un moyen tout aussi efficace de suggérer l’émotion que la gesticulation pathétique, car non suspect de complaisance. Le silence et l’étirement temporel, en particulier, disent, sur le mode de la prétérition et de la litote et non plus de l’hyperbole et de la surenchère, la violence d’une émotion qui excède toute convention rhétorique. Le modèle, s’il fallait en trouver un, remonterait au tableau mythique du peintre grec Timanthe, rival de Parrhasios, Le Sacrifice d’Iphigénie, évoqué d’abord par Cicéron et Pline29 – puis abondamment de Montaigne à Lessing : renonçant à montrer par les moyens de la peinture la douleur incommensurable du père, Agamemnon, le peintre choisit de voiler son visage. Les masques impassibles de Drnaso, dans Sabrina notamment, sont les voiles d’une émotion qui anesthésie les facultés d’expression corporelle des personnages, et ce dans un art très maîtrisé. On rejoint ici le pathos mais par les procédés même de la mesure.
La question de l’équilibre entre effusion pathique et mesure éthique se pose également pour des œuvres à plus proprement parler « intermédiales », dont l’hétérogénéité formelle dépasse la simple nature mixte, iconotextuelle, de la bande dessinée traditionnelle. La dialectique de l’ethos du pathos opère dans des formes qui intègrent le montage photographique tels le Shooting War d’Anthony Lappé et Dan Goldman30 et le Photographe de Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier, dont Philippe Marion a proposé des analyses comparées éclairantes31. Shooting War relate, en adoptant la perspective d’un caméraman, Jimmy Burns, l’occupation de l’Irak par les troupes américaines sous la présidence de John Mc Cain. Dans cette uchronie, œuvre de fiction qui joue au maximum sur l’effet de réel, les procédés spectaculaires utilisés vont dans le sens d’un pathos de la violence : agressivité des couleurs, expression de la douleur sur les visages, sentiment permanent d’un chaos suscité par le montage graphique, pictural et photographique. L’ethos qui se dégage du Photographe est à l’opposé de cette esthétique : une justesse (une vérité, disait Bechdel) dans la restitution (le témoignage) de la réalité vécue par le photographe, Didier Lefèvre, alors qu’il accompagnait une équipe de Médecins du Monde en Afghanistan pendant la guerre contre l’URSS. Le regard du photographe, sa juste distance par rapport aux êtres qu’il photographie et dont il restitue la dignité, la sobriété hergéenne du dessin (dans la palette graphique et chromatique), le montage créé à partir de l’hétérogène (l’hybride texte / dessin / photographie) aboutissent, par-delà la nature collaborative de l’œuvre soulignée à juste titre par Marion, à une synthèse éthique de l’hybridité formelle qui rend justice à l’expérience vécue, celle des Afghans en temps de guerre comme celle de la mission de médecins sans frontières et du photographe qui les a suivis, et ce sans complaisance ou surenchère, sans émotions parasites, sans « bruit émotionnel ». Du côté de Shooting War, un ethos (un sujet du discours) immergé dans une violence frénétique, d’où le jeu immersif de l’hybridation au sein d’une même case et dans toutes les cases, ce « métissage tapageur » dont parle Philippe Marion32 ; de l’autre, dans Le Photographe, un ethos qui assume une position proprement éthique, une mise en perspective à la fois temporelle (la rétrospection narrative s’oppose au présent continu de Shooting War, et la photographie noir et blanc a valeur d’archive d’un vécu) et éthique de l’expérience et une conscience aiguë de la valeur des images33.
Il s’agit donc, à partir d’une pratique intermédiale comme celle de la bande dessinée, de penser les conditions d’une représentation et d’une construction du sujet du discours, dans cette balance entre mesure éthique et effusion pathique. Ce sujet, Le Photographe le montre, est une position à la fois discursive (un point de vue sur le récit) et éthique (au sens rhétorique et moral). Il ne se confond pas avec l’auteur et avec le sujet empirique de l’énonciation : il est une construction du discours de l’œuvre.