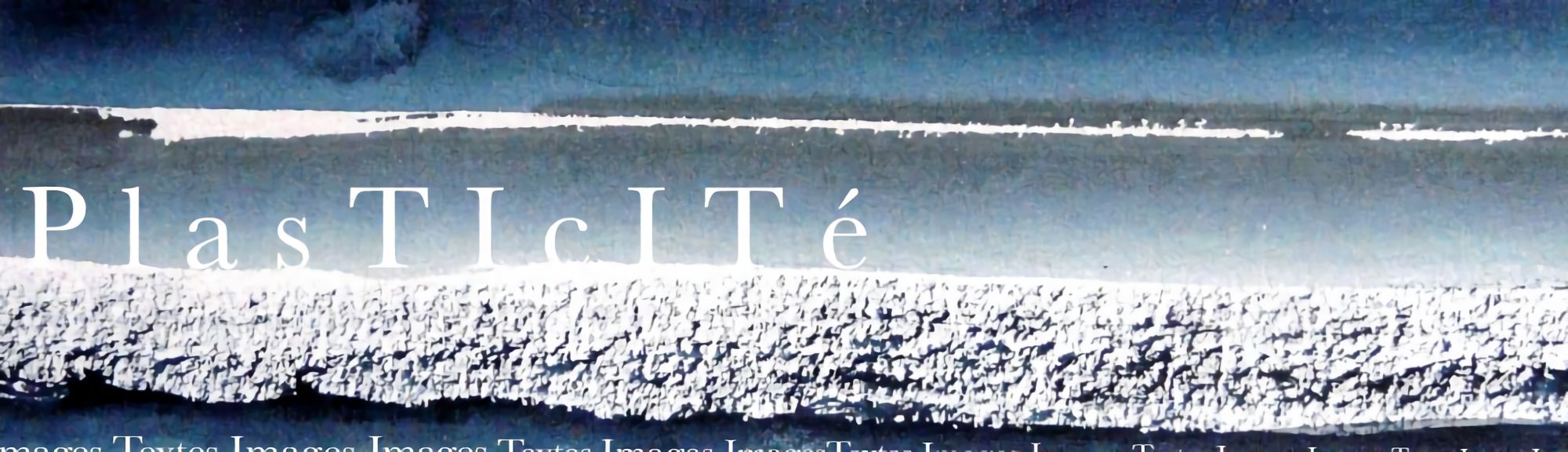Comment comprendre le rapport entre écriture et lecture, écrivain et lecteur ? Afin de donner (ou plutôt de reprendre) quelques directions de réponse à cette question, nous jouerons sur la plasticité de l’expression proposée pour thème de ce numéro : « Faites vos je(ux) ». On remarquera d’abord que l’énoncé se donne comme un ordre. Nous prendrons alors pour premier symbole du rapport entre écriture et lecture, un jeu dont la règle dicte de retrouver un ordre, ou plus exactement l’ordre, la seule combinaison permettant de recomposer un ensemble mis en pièces : le puzzle. Georges Perec, dans son « Préambule » à La Vie mode d’emploi, utilise le puzzle comme métaphore du rapport entre écrivain et lecteur. En opposant le puzzle en bois au vulgaire puzzle en carton (découpé aléatoirement à la machine), il montre combien ce jeu noue ses deux acteurs – son artisanal fabricant et le joueur. Le faiseur de puzzle pourrait dire « faites vos je(ux) » au(x) poseur(s) de puzzle ; mais il dirait par là : « refaites mon jeu » tel que je l’ai conçu. On devrait alors convenir que le puzzle comme métaphore laisse peu de jeu au lecteur – le jeu qu’il lui laisse est joué d’avance, prévu par un faiseur-écrivain omniscient. Il faut néanmoins creuser cette métaphore : le texte, avant d’en être un pour le lecteur, n’est-il pas un puzzle pour l’écrivain lui-même, qui cherche à composer un ordre nécessaire entre des éléments dans le complexe réseau virtuel de compossibilités et d’incompossibilités que lui offre son langage ? Ce serait le langage lui-même qui dirait aux écrivains « faites vos je(ux) », avec un sous-entendu narcissique similaire à celui de l’énoncé du faiseur de puzzle – et sous l’expression trompeuse il faudrait entendre que l’écrivain fait le jeu du langage, se plie à son ordre caché, en pensant exprimer sa propre personnalité. Jouer pleinement ce jeu, avec acharnement, ce serait finalement reconnaître au langage sa supériorité, au rapport entre écrivain et lecteur sa secondarité, et du je reconnaître la défaite. Une comparaison entre les Poésies de Mallarmé et son étrange poème final, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, permet d’entrevoir une nouvelle direction de pensée. L’expression prend sa tournure temporelle : « faites vos je(ux) » avant que les dés ne s’arrêtent, avant que le destin ne soit décidé. Le poème maintient la lecture dans ce temps où les jeux se font, où les possibilités sont ouvertes : il ne se propose pas comme une œuvre achevée, il replonge son lecteur dans la tourmente du jeu en train de se jouer, du destin continuant à se possibiliser, de l’identité à soi toujours différée. À première vue pourtant ce poème est encore plus coercitif que les textes-puzzles, en ce qu’il dicte à ses lecteurs plus qu’un ordre à reconstruire, il prétend régir la manière dont le lecteur dit le texte, son rythme et son volume sonore, quand bien même le texte ne serait pas lu à haute voix. Poème-partition qui laisse très peu de place à l’interprétation. Toutefois, la préface lance un appel mystérieux au lecteur : il ne s’agit pas simplement d’exécuter la partition, mais d’apercevoir qu’en ce texte peut être lu davantage qu’un texte – « presque un art » (MALLARMÉ, 1945, 455) pourrait en émerger. Il y aurait, « à côté du chant personnel » (Ibid.), un « genre » à faire, une innombrable quantité de poèmes à écrire dans la lignée de ce poème où se lit une nouvelle poétique. « Faites vos je(ux) », ce serait dire « faites des œuvres qui soient vôtres » par le travail opéré sur la diction, grâce à ce nouveau style d’orchestration. Mais encore, suivant Mallarmé comme inspirateur plus que comme maître, faites vos œuvres telles qu’on puisse y lire autre chose qu’un simple texte – un art nouveau, une création de virtuel : créez de nouvelles règles pour élargir la part du jeu.
1. Métaphore du puzzle et prédétermination : Refaites le jeu que j’ai conçu
La métaphore du puzzle est utilisée par Perec afin de corriger la conception supposée commune selon laquelle l’activité de lecture est une pratique solitaire, détachée des autres. Redonnant à ce jeu ses lettres de noblesse en présentant les mérites du puzzle de bois découpé à la main par rapport à celui en carton découpé aléatoirement à la machine, Perec montre que le faiseur de puzzle – comprenons qu’il en va de même pour le vrai écrivain – pense à l’avance les gestes du poseur – du lecteur ; ne laissant rien au hasard, il prédétermine toutes les « combinaisons plausibles » (PEREC, 1978, 17). Selon une métaphore métareprésentative que Bernard Magné (MAGNÉ, 1986, 85) nous permet de concevoir comme ayant à la fois une fonction métatextuelle générale (sur l’art de l’écrivain) et macrométatextuelle (sur l’art de l’écrivain qui a conçu cette œuvre qu’on s’apprête à lire), l’auteur construit une petite théorie du rapport entre écriture et lecture, théorie que l’on pourrait qualifier de prédéterministe, en précisant qu’il s’agit d’un prédéterminisme scriptural, par contraste avec un prédéterminisme ante-scriptural, que nous présenterons ensuite.
Le texte lie, très nettement, une version basique de la doctrine structuraliste – « l’objet visé… n’est pas une somme d’éléments qu’il faudrait d’abord isoler et analyser, mais un ensemble, c’est-à-dire une forme, une structure : l’élément ne préexiste pas à l’ensemble » (PEREC, 1978, 17) – à une conception baroque de l’écriture comme prédétermination du virtuel de la lecture. Ce virtuel est conçu comme multiplicité de combinaisons et cette multiplicité comme entièrement déterminée par l’écrivain. Celui-ci a épuisé à l’avance le virtuel de son texte en le « concevant », en le pro-grammant. Conception ou programmation d’un ingénieur, qui laisse place à la sensibilité, mais seulement dans la mesure où il en prédétermine « les opérations ».
Que l’intérêt de la lecture d’un texte soit plus grand quand l’écriture a été pratiquée dans l’intention de ne pas laisser le lecteur aux prises avec le seul hasard, cela, seuls les surréalistes les plus bretoniens ne seraient pas enclins à l’admettrei. Le premier type de puzzles constituerait la métaphore d’un certain type d’écrits auxquels l’appellation de textes ne paraît pas convenir. Il faudrait même formuler des réticences à décerner à ces x le statut d’écrits : on ne peut concevoir une écriture qui serait une « découpe aléatoire » du langage, précisément parce que le langage est prédécoupé en éléments (phonématiques et morphématiques) ; ici l’assemblage d’éléments discrets suppose un prédécoupage non-hasardeux. Les écoliers qui découpent des bouts de papier où sont inscrits des lettres ou des mots savent ou apprennent qu’il faut respecter l’intégrité de ces éléments pour pouvoir composer des mots ou des phrases en les collant les uns à la suite des autres. Ils savent ou apprennent aussi que certaines associations de lettres ou de mots sont plus ou moins fréquentes, probables, et que certaines sont ou semblent impossiblesii. Le « faiseur de puzzles », quand il a affaire au langage en tant qu’écrivain, ne peut opérer aussi aléatoirement qu’une machine, qu’une « presse coupante » (PEREC, 1978, 18) ; il doit respecter les contours de ce paysage virtuel, pour qu’un paysage actuel (fût-il abstrait, non-représentatif) puisse apparaître. Si maintenant l’aléatoire est compris comme caractérisant la liaison des éléments (qui peuvent être de plus grande échelle : paragraphe, chapitre, lexies), l’absence de mise en œuvre donnant cohérence à l’« écrit » induit à parler d’inscription plutôt que d’écrit.
Par écriture, nous le savons, il faut entendre au moins deux activités distinctes. L’une peut s’appeler inscription : avec elle se trouvent tracées certaines suites de caractères sur telle manière de support. L’autre peut garder le nom d’écriture : avec elle se voient mises en œuvre diverses opérations capables de rendre l’écrit plus complexe, c’est-à-dire d’accroître les relations qui le composent. Son résultat, nous l’appellerons le texte. (RICARDOU, 1982, 9)
Le second type de puzzles serait la métaphore d’un texte absolu(tiste), ou du Texte, en un sens très différent de celui dans lequel Barthes utilise ce terme. Il est classique que la réception soit pensée comme pro-grammée par l’écrivain ou le théoricien de la littérature : l’écriture prédétermine un sens ou une multiplicité de sens que la lecture doit ou devrait actualiser. On pourrait qualifier de baroque une conception dans laquelle la réception est pensée comme pro-grammée jusque dans ses hypothèses de lecture pour des « sens » ou liaisons qui resteront virtuels, inactualisables parce qu’incompossiblesiii. C’est exactement jusqu’où Perec entend mener son entreprise littéraire : une écriture qui préfigure les virtuels chemins qui ne mènent nulle part, ayant un degré de perfection moindre que celui permettant de donner une parfaite cohérence au divers.
Ce structuralisme baroque est certainement un monstre. Il n’est pas critique, il ne fait pas la critique des limites du concept de structure. Comme l’explique Etienne Balibar, « c’est parce que le structuralisme n’est pas une école mais une rencontre divergente, c’est parce qu’il réside autant et plus dans l’épreuve des limites de la catégorie qui lui donne son nom que dans la construction de sa consistance, qu’il a représenté un moment unique et incontournable » (BALIBAR, 2005, 8)iv. Ce qui caractérise cette théorie (le prédéterminisme scriptural « baroque ») est en effet sa très forte tendance doctrinale : elle cherche à établir que le texte – de façon générale, tout « vrai » texte (« l’ultime vérité du puzzle » (PEREC, 1978, 20)), qui deviendrait un modèle par un tel accomplissement – prédétermine non seulement une lecture adéquate, mais le multivers d’inadéquations (de mauvais gestes de lecture) autour de cette lecture.
Cette doctrine distille plusieurs effets euphorisants : la lecture – qui serait produite suivant (en accord avec) cette doctrine – d’une œuvre ainsi agencée, donne non seulement au lecteur un sentiment de proximité avec l’écrivain, puisque ses gestes de lecture lui paraissent accompagnés parce qu’ils ont été prémédités (et prédéterminés) ; elle lui donne aussi une sensation de puissance et de contrôle du virtuel : le virtuel est ressenti, mais ressenti comme maîtrisable et maîtrisé. Ce sentiment de maîtrise tient à la visée d’une synchronie, que le puzzle figure : quand bien même sa recomposition prend du temps, le puzzle repose sur la possibilité d’une coexistence (synchrone) de tous les élémentsv. Mais plus largement, le pouvoir que l’écrivain se donne sur le virtuel du texte – d’un texte conçu comme son propre textevi – est permis par une stratégie de prédétermination qui annihile le virtuel en le réduisant à du potentiel. La distinction entre potentiel et virtuel est précisément ce que le courant oulipien (auquel appartenait Perec) a toujours manqué d’établir, en appuyant ses recherches sur la logique combinatoire, comme l’illustre son chef-d’œuvre, Cent mille milliards de poèmesvii. Les récents travaux de Pierre Lévy nous aident à saisir cette précieuse distinction.
[…] En interprétant, en donnant sens au texte ici et maintenant, le lecteur poursuit cette cascade d’actualisations. Je parle bien d’actualisation au sujet de la lecture, et non de la réalisation qu’eût été une sélection parmi des possibles préétablis. […] Le virtuel n’éclot qu’avec l’entrée de la subjectivité humaine dans la boucle, lorsque surgissent du même mouvement l’indétermination du sens et la propension du texte à signifier, tension qu’une actualisation, c’est-à-dire une interprétation, résoudra dans la lecture. (LÉVY, 2007, non paginé)
La définition que Lévy donne de l’actualisation fait ressortir les limitations théoriques de la conception exprimée par Perec :
L’actualisation apparaît alors comme la solution d’un problème, une solution qui n’était pas contenue à l’avance dans l’énoncé. L’actualisation est création, invention d’une forme à partir d’une configuration dynamique de forces et de finalités. Il s’y passe autre chose que la dotation de réalité à un possible ou qu’un choix parmi un ensemble prédéterminé : une production de qualités nouvelles, une transformation des idées, un véritable devenir qui alimente le virtuel en retour. (Ibid.)
Cette conception de l’actualisation différenciée de la réalisation tient compte de la critique bergsonienne de l’opinion courante sur le rapport entre réel et possible. C’est une telle critique qu’il nous faut maintenant examiner afin de ne pas nous laisser aveugler par une métaphore trop vite acceptée – celle du puzzle ; cependant nous allons voir que l’opinion en question est aussi sous-jacente à la logique de la partition.
2. Logique de la partition et pronostic : Les jeux ne sont pas faits
Les gestes de lecture sont-ils prédictibles du fait que l’objet littéraire, et plus généralement tout texte, a été conçu par un auteur ? Pour développer cette question et tenter d’y répondre, nous allons faire communiquer un texte de Bergson, « Le réel et le possibleviii », un texte de Derrida apparemment très bergsonien, « Force et signification », et un texte de Barthes intitulé « Jeunes chercheurs ». La question qui se pose peut se résumer d’un mot dans le champ sémantique du jeu : le pronostic. Derrida utilise le terme préformisme, qui appartient à un autre champ, celui de la biologie. Mais les deux notions ne sont pas sans liens : on parle en médecine de « pronostic vital » ; et l’idée qu’un pronostic puisse être sûr repose sur une logique préformiste. Derrida opère une critique de ce qu’il considère constituer un préformisme en critique littéraire. L’auctorialité artistique est diagnostiquée comme son implicite justification.
Par préformisme, nous entendons bien préformisme : doctrine biologique bien connue, opposée à un épigénétisme, et selon laquelle la totalité des caractères héréditaires serait enveloppée dans le germe, en acte et sous des dimensions réduites qui respecteraient néanmoins les formes et les proportions de l’adulte futur. La théorie de l’emboîtement était au centre de ce préformisme qui fait aujourd’hui sourire. Mais de quoi sourit-on ? de l’adulte en miniature, sans doute, mais aussi de voir prêter à la vie naturelle plus que la finalité : la providence en acte et l’art conscient de ses œuvres. Mais quand il s’agit d’un art qui n’imite pas la nature, quand l’artiste est un homme et quand c’est la conscience qui engendre, le préformisme ne fait plus sourire. (DERRIDA, 1979, 39)
Parmi un grand nombre de similarités, telle est la première différence – la plus mince – entre le texte de Bergson et celui de Derrida : Bergson nous faisait reconnaître que malgré leur défaut de caractère artistique, les situations du quotidien sont tout de même des actualisations originales, qui ne sont que schématiquement prévisiblesix ; Derrida souligne au contraire que c’est le caractère artistique de l’œuvre d’art qui nous fait adopter une conception préformiste pour celle-ci alors que cette conception nous paraît ridicule pour ce qui est de la nature. En revanche, les deux textes défendent l’importance de la durée, souvent lésée au profit d’un géométrisme (seulement spatial) reposant sur la possibilité d’une perception simultanée du divers (textuel). Citant l’ouvrage de Rousset (Forme et Signification, Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel) qui fait l’objet de sa critique, Derrida commente :
Un poète ne fait guère que développer un dessein préétabli » (p.172) Cette esthétique qui neutralise la durée et la force, comme différence entre le gland et le chêne, n’est pas autonome chez Proust et chez Claudel. Elle traduit une métaphysique. Le « temps à l’état pur », Proust l’appelle aussi l’« intemporel » ou l’« éternel ». La vérité du temps n’est pas temporelle. De façon analogue (analogue seulement), le temps comme succession irréversible n’est, selon Claudel, que le phénomène, l’épiderme, l’image en surface de la vérité essentielle de l’Univers tel qu’il est pensé et créé par Dieu. Cette vérité, c’est la simultanéité absolue. Comme Dieu, Claudel, créateur et compositeur, a « le goût des choses qui existent ensemble. (DERRIDA, 1979, 40)
Nous devons tenir compte de cette critique pour aborder la partition comme métaphore du texte : nous touchons déjà ici à une limite de cette métaphore. Non pas au sens où le texte ne serait pas (comme) une partition, mais en ce que la notion de partition favorise une conception simultanéiste de l’appréhension du texte : s’il est vrai que le texte requiert du temps pour être lu, comme il est vrai que la partition en requiert pour être exécutée, l’image de la partition diminue l’aspect temporel au profit d’une représentation simultanée. Une telle représentation du texte implique une certaine conception de la lecture et du rapport entre écriture et lecture. La lecture ne serait temporelle que temporairement et par défaut ; une lecture approfondie de l’œuvre finirait par donner une vision instantanée de sa totalité : elle pourrait se passer du jeu et réduire à l’inessentiel son faire. En des pages célèbres de La Pensée et le mouvantx, Bergson critique cette conception en utilisant un exemple à première vue antinomique par rapport à son argument : le cinéma. L’expérience du film cinématographique est en effet une expérience de lecture qui prend du temps, qui se fait dans et par la durée – ce qui est moins évidemment le cas pour la lecture d’un tableau ou d’une photographie. Cependant c’est une lecture au cours de laquelle le lecteur-spectateur est astreint à recevoir les informations sans pouvoir changer l’ordre ou accélérer la succession des images. Bien entendu avec une lecture du film dans un format vidéo et certaines technologies, ces manipulations sont rendues possibles. Bergson anticipe ces possibilités, et manipule par l’esprit son exemple afin d’envisager non pas la réception phénoménologique première du film, mais l’idée que le film en tant que dispositif technique nous incite à nous faire du temps : le futur préexiste, il est préinscrit sur la pellicule, aucune opération que nous puissions faire sur le film, en tant que récepteurs plus ou moins actifs, ne saurait rien changer à ce qui doit arriverxi. Nous retrouvons donc ici la logique de la partition, qui est aussi celle du livre. Souvenons-nous de ce que disait Barthes du support :
Soulignons, sans être en mesure de l’approfondir, le fait capital de toute l’histoire des supports d’écriture : le passage (probablement accompli au IIIe siècle après J.-C.) du rouleau (de papyrus) au cahier (de parchemin). Les conséquences en sont multiples, indécidables, se propageant comme des ondes jusqu’au plus profond des mentalités ; avec le rotulus, l’écrit se déroule, la main descend le fleuve tracé, elle ne peut choisir sa lecture sans partir de l’origine du rouleau, l’écriture peut difficilement s’ajouter à l’écriture ; avec le codex au contraire (cahier ou livre), l’écrit se feuillette, la main choisit la page, devenue subrepticement une unité de pensée, la base d’un empilement de commentaires. (BARTHES, 2000, 76)
Le passage du film cinématographique au film vidéo facilite certainement l’incursion d’une nouvelle écriture au sein du film : facilitation du montage, du mixage, etc. Néanmoins la vraie révolution apparaît au moment où l’on propose une nouvelle conception de la partition, une nouvelle conception du livre ou du film, plus exactement : au moment où la partition fait proliférer le jeu. Eco propose plusieurs exemples de renouvellement du concept de partition qui vont dans ce sens en exergue à L’Œuvre ouverte. Une telle prolifération est ce que le concept de textualité, ou plus largement la théorie du texte, en particulier dans sa jonction avec la problématisation du virtuel, permet d’envisager, et dans une certaine mesure de concevoir. Nous faisons montre d’une certaine précaution parce qu’en effet concevoir ne devrait pas ici être compris comme une prédétermination de ce que cette ouverture pro-voque. L’acte théorique doit prendre en compte, signaler, rendre sensible ses propres limitations – ce que Barthes et Derrida font fréquemment. A défaut de cela, nous commettrions à nouveau une réduction de la durée – en l’occurrence de la durée de l’écriture. En conclusion d’un article présentant un numéro de revue regroupant des textes de jeunes chercheurs sur le Texte, Barthes écrivait :
Il ne faut pas penser que ces « prospects » divers contribuent à cerner le Texte ; c’est plutôt à l’éployer que tout le numéro travaille. Il faut donc résister à vouloir organiser, programmer ces études, dont l’écriture reste très diverse (c’est à regret que j’en suis venu à admettre la nécessité de présenter ce numéro, risquant ainsi de lui donner une unité dans laquelle tous les contributeurs ne se reconnaîtraient pas, et de prêter à chacun d’eux une voix qui n’est peut-être pas tout à fait la sienne : toute présentation, par son intention de synthèse, est d’une certaine manière de concession au discours passé). (BARTHES, 1993, 103)
Le danger qu’il y aurait à « programmer » des études en prédéterminant ce que serait leur champ est clairement perçu ; de plus, est perçu et énoncé le danger de l’illusion rétroactive qui consiste à penser que ce qui a été fait était prévisible, et donc que ce qui sera fait est prévisible. L’inattendu doit être préservé, le futur maintenu dans son indétermination, et donc le discours qui traite de ce qui a été fait ne doit pas perdre de vue que cette indétermination existait. Nous désirons souvent lire le futur comme s’il s’agissait d’un passé, alors que nous devrions redonner aux moments du passé l’indétermination de leur futur. C’est ce que l’anecdotexii rapportée par Bergson dans « Le réel et le possible » nous donne à envisager : on ne peut pas pronostiquer « la grande œuvre dramatique de demain » parce que celle-ci n’est pas encore possible ; sa possibilité naîtra avec sa fabrication. Ce n’est qu’en concevant les choses ainsi qu’on peut penser la création. Avec l’antécédence du possible sur le réel, il n’y aurait jamais à proprement parler de création, il n’y aurait que des coups au sein d’un jeu dont toutes les possibilités existent d’avance virtuellement ; un entendement assez puissant pourrait pronostiquer le coup suivant en fonction de la situation historique présente, comme au cours d’une partie d’échecs.
Il faut donc s’apercevoir que la prédétermination du futur est une dénaturation du futur en ce qu’on réduit son virtuel à de l’actuel qui n’est pas encore, qui va venir ou est à venir – le mot avenir est symptomatique de cette dénaturation. Et il faut faire un effort de pensée pour concevoir le passé tel qu’il fut, c’est-à-dire dans l’indétermination entre des virtualités restant en grande partie imprévisibles : imprévisibles au-delà et en-deçà des catégories (des possibles) que la poétique parvient à discerner. Pour nous diriger dans le présent, nous sommes bien obligés de prévoir au moins à titre hypothétique quelque(s) futur(s) ; nous y sommes obligés dans la mesure où la lecture des informations que nous recevons construit du sens en anticipant des hypothèses. « L’anticipation ou la précipitation (risque de précipice et de chute) est une structure irréductible de la lecture. » (DERRIDA, 1974, 7) De plus, l’écriture elle-même construit son texte en prenant en compte les anticipations du lecteur. De telles procédures d’anticipation sont exemplairement analysées par Barthes dans son article « Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe » et par Eco dans son Lector in fabula. Cependant l’anticipation et la prise en compte de l’anticipation – l’anticipation de l’anticipation, si l’on veut – « accepte[nt] des données imprécises, ambiguës, qui ne semblent pas sélectionnées selon un code ou une capacité de lecture préétablis » (LYOTARD, 1988, 24), autrement dit acceptent de prédéterminer le virtuel du futur tout en préservant sa part d’inattendu, d’indétermination, d’imprévisibilité – ce que n’acceptait pas Perec dans sa conception du texte comme puzzle. La préservation de l’indétermination du virtuel est au cœur de nombreux textes de Derrida, et notamment de « Force et signification », où l’on peut lire :
Cette vacance comme situation de la littérature, c’est ce que la critique doit reconnaître comme la spécificité de son objet, autour de laquelle on parle toujours. Son objet propre, puisque le rien n’est pas objet, c’est plutôt la façon dont ce rien lui-même se détermine en se perdant. […] Si l’angoisse de l’écriture n’est pas, ne doit pas être un pathos déterminé, c’est qu’elle n’est pas essentiellement une modification ou un affect empiriques de l’écrivain, mais la responsabilité de cette angustia, de ce passage nécessairement resserré de la parole contre lequel se poussent et s’entr’empêchent les significations possibles. S’entr’empêchent mais s’appellent, se provoquent aussi, imprévisiblement et comme malgré moi, en une sorte de sur-compossibilité autonome des significations, puissance d’équivocité pure au regard de laquelle la créativité du Dieu classique paraît encore trop pauvre. Dieu, le Dieu de Leibniz, puisque nous venons d’en parler, ne connaissait pas l’angoisse du choix entre les possibles : c’est en acte qu’il pensait les possibles et en disposait comme tels dans son Entendement ou Logos; c’est le « meilleur » que, dans tous les cas, favorise l’étroitesse d’un passage qui est Volonté. […] Il n’y a donc pas ici de tragédie du livre. […] Ecrire ce n’est pas seulement savoir que par l’écriture, par la pointe du style, il n’est pas nécessaire que le meilleur passe, comme le pensait Leibniz de la création divine, ni que ce passage soit de volonté, ni que le consigné exprime infiniment l’univers, lui ressemble et le rassemble toujours. C’est aussi ne pouvoir faire précéder absolument l’écrire par son sens : faire descendre ainsi le sens mais élever du même coup l’inscription. (DERRIDA, 1967, 17)
Le possible ne précède pas le réel, insistait Bergson ; on ne peut faire précéder absolument l’écrire par son sens, insiste Derrida. Du sens émerge à partir de l’inscription, la détermination du sens est encore incomplète précédemment à l’inscription. Mais, selon ce passage du texte de Derrida, l’inscription est ce moment où l’écrivain ressent « l’angoisse du choix entre les possibles » ; il semble qu’on en revienne donc à une conception pré-bergsonienne du rapport entre le réel et le possible. La « tragédie du livre » suppose une antériorité du possible sur le réel.
3. Comparaison de la partition aux « puzzles musicaux » et prospective : Les jeux restent à faire
Il semble bien que quand un écrivain écrit il ait le choix entre plusieurs possibilités : prenons l’exemple apparemment le plus simple, celui du choix entre deux mots « possibles » – pourquoi glaïeul plutôt que rose ? Nous pouvons remarquer qu’à la fin du poème « Prose » de Mallarmé le seul mot possible est glaïeul, parce que d’une part il est le seul nom de fleur qui rime avec aïeul, et que d’autre part les idées évoquées dans le poème sont décrites selon une métaphore florale instituée dès son commencement – avec le mot herbiers à la deuxième strophe, voire avec le premier mot du poème, Hyperbole, puisqu’une telle figure est aussi dite une « fleur de rhétorique ». Un lecteur-joueur auquel on aurait caché le dernier mot du poème aurait pu parier sans risque sur celui-ci. Et l’on pourrait donner raison à une lecture préformiste du texte en arguant que les trois derniers mots étaient contenus dans le premier.
Hyperbole ! de ma mémoire
Triomphalement ne sais-tu
Te lever, aujourd’hui grimoire
Dans un livre de fer vêtu :
Car j’installe, par la science,
L’hymne des cœurs spirituels
En l’œuvre de ma patience Atlas,
herbiers et rituels.[…]
Avant qu’un sépulcre ne rie
Sous aucun climat, son aïeul,
De porter ce nom : Pulchérie !
Caché par le trop grand glaïeul. (MALLARMÉ, 1989, 83)
Le mot glaïeul n’est plus un mot possible parmi d’autres au moment de son inscription, mais le mot nécessaire, qui, à l’image de « l’unique Nombre » évoqué dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, « ne peut être un autre » (MALLARMÉ, 1945, 462). En ce sens, ce n’est plus l’écrivain qui choisit le mot, mais le mot qui trouve sa place. Néanmoins cette impression de naturel n’a elle-même été rendue possible qu’au long d’une « installation » opérée par un je et « par la science » « en l’œuvre de [s]a patience ». Mallarmé élève l’inscription en l’égalant à un acte qui accomplit la perfection. Pour que l’inscription du dernier mot accomplisse la perfection du poème, il a fallu que le texte ne soit pas produit par une simple succession d’inscriptions (de mots), mais comme un tout dont chaque partie est pensée en fonction du tout – comme un système. La systématicité peut non seulement être considérée comme un équivalent de la beautéxiii, elle est ici conçue également comme la condition de sa perfection et de sa survie : il s’agit de sauver Pulchérie du sépulcre, et pour assurer son éternité autant qu’on le puisse dans ce jeu de hasard qu’est une langue, est créé un texte qui aurait la perfection non du monde terrestre, mais de l’Univers, ordonné avec la précision des mathématiques.
J’ai pris ce sujet d’un sonnet nul et se réfléchissant de toutes les façons, parce que mon œuvre est si bien préparé et hiérarchisé, représentant comme il le peut l’Univers, que je n’aurai su, sans endommager quelqu’une de mes impressions étagées, rien en enlever (MALLARMÉ, 1995, 392)
S’agissant de « Prose », la correspondance de Mallarmé ne nous révèle pas si le dernier mot a été installé en premier ou à un certain stade de l’élaboration du poème permettant de prédéterminer chaque élément du parcours vers celui-cixiv. Il faut noter cet étrange présent : « Car j’installe », suggérant, entre autres sens, que le travail s’accomplit sur tout le poème, peut-être pas simultanément, mais d’une telle façon qu’à l’antécédence graphique d’un mot sur la page, et donc à son antécédence temporelle lors d’une lecture cursive, ne correspond pas nécessairement une antécédence temporelle lors de l’écriture. L’écrivain n’en prend pas moins en compte l’antécédence temporelle correspondant à la lecture cursive. Cependant sur la partition l’antécédence graphique, tributaire des conventions culturelles qui placent le haut de la page avant le bas et la gauche avant la droite, est aussi simultanéité visuelle. La partition en tant que telle, en tant qu’elle n’est pas jouée, en tant qu’elle est visuellement perçue, a donc en commun avec le puzzle la synchronicité des éléments qui la composent. En revient-on alors à l’art du poseur de puzzle tel que décrit par Perec ? L’insistance de Mallarmé sur l’interprétation au sens musical du texte comme partition nous invite à en distinguer la logique.
Ajouter que de cet emploi à nu de la pensée avec retraits, prolongements, fuites, ou son dessin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. La différence des caractères d’imprimerie entre le motif prépondérant, un secondaire et d’adjacents, dicte son importance à l’émission orale et la portée, moyenne, en haut, en bas de page, notera que monte ou descend l’intonation. (MALLARMÉ, 1945, 455)
Chaque détail est soigneusement pensé afin de dicter au lecteur la manière dont il faut lire le texte. Tout est prédéterminé, y compris l’émission et l’intonation. Il y a bien ici interprétation en un sens autre que celui de l’intellection d’une signification possible de l’œuvre (ou concrétisation d’une potentialité sémantique) ; il s’agit de l’interprétation dans son acception musicale : au lecteur est donné le rôle d’interprète vocalxv. Il devient ainsi co-responsable de la texture du poème à travers une lecture spirituellexvi. Mallarmé va plus loin ici qu’avec ses autres poèmes : il prédétermine par le texte, ce que la littérature laissait traditionnellement au lecteur comme sa part de liberté. Il fait de cet espace de jeu (d’indétermination) un espace de jeu musical (surdéterminé). Perec utilise lui aussi différents styles typographiques et tailles de caractères dans La Vie mode d’emploi, mais si ces modulations affectent l’intonation du lecteur (y compris pour la lecture en voix intérieure), il ne va pas jusqu’à essayer de moduler l’émission orale. Mallarmé irait ainsi plus loin dans la voie d’un prédéterminisme scriptural. Or, à bien y regarder, le modèle de la partition qu’il présente est conçu à partir d’un triple prédéterminisme ante-scriptural : d’une part c’est moins l’écrivain qui dicte au lecteur comment il doit lire, que l’Idée dictant à l’écrivain comment il doit écrirexvii ; d’autre part l’écrivain doit opérer à partir de ce que les pratiques de son temps lui permettent de faire, sa liberté dans la création textuelle s’exerce en prenant en compte le poids de la tradition et ses limitationsxviii ; enfin l’écriture poétique se reconnaît une « influence étrangère » : « la Musique entendue au concert », qui a été l’élément déclencheur, l’occasion pour l’écriture verbale de se repenser comme pratique dans sa différence avec un autre artxix.
Mallarmé sait que sa propre action demeure restreinte, mais il faut comprendre que cette action restreinte n’est en rien une restriction du virtuel, au contraire : « Aujourd’hui ou sans présumer de l’avenir qui sortira d’ici, rien ou presque un art […] » (MALLARMÉ, 1945, 456). En évoquant les procédés par lesquels il compte diriger la lecture, l’écrivain insiste sur le fait que ses directions s’insèrent dans une histoire culturelle qui en prédétermine le virtuel champ d’action. Ses directives visent à transformer le lecteur en automate spirituel, mais on peut dire, en suivant une terminologie utilisée par Bernard Stiegler, que cette automatisation est paradoxalement conçue pour produire une « désautomatisation » (STIEGLER, 2014). La définition de nouvelles règles du jeu (liant la lecture à l’écriture) ouvre l’espace textuel. Depuis l’expérience de lecture proposée par Mallarmé avec Un coup de dés…, l’écriture telle que nous la concevons habituellement apparaît dans ses limitations. Les principes typographiques identifiés par McLuhan : l’uniformité, la continuité et la linéarité (au sens le plus restreint du terme) (MCLUHAN, 1966, 28), apparaissent comme des restrictions principielles du jeu. Si l’on reconnaît, avec Michel Murat, « le caractère approximatif et insuffisant de l’analogie » entre texte et partition (MURAT, 2005, 162), et avec Marie-José Fourtanier que la « dimension concrète de la métaphore suscite plus d’interrogations et de doutes que de certitudes » (FOURTANIER, 2013, 3), on doit aussi reconnaître que ce serait une erreur de « faire basculer le poème dans une dimension purement visuelle » (MURAT, 171). C’est précisément la tension entre une lecture globale qui suspend le temps, éternise le poème dans la contemplation de sa forme (la constellation), et une lecture cursive qui expérimente le texte dans sa durée, que nous devons maintenir, nous lecteurs, pour jouer le double-jeu que propose ici Mallarmé.
Les règles d’Un coup de dés… que nous déduisons de ce coup même – selon la logique décrite par Wittgenstein, qui nous fait remonter du coup à la grammaire du jeuxx – ont pour effets d’illuminer le ciel de l’écriturexxi, de déployer le jeu à sa surface et dans sa profondeur. Les dimensions de la double-page, ces quatre dimensions – puisqu’il faut aussi considérer le volume que compose leur attachement en feuillets, et le temps impliqué par leur parcours – prennent part au jeu. Cela a été remarqué par plusieurs générations de commentateurs, mais déjà Mallarmé mettait son lecteur sur la voie. Comme Eco le remarque :
prévoir son Lecteur Modèle ne signifie pas uniquement « espérer » qu’il existe, cela signifie aussi agir de façon à le construire. Un texte repose donc sur une compétence mais, de plus, il contribue à la produire. Peut-on dire alors qu’un texte est moins paresseux qu’il n’y paraît, que sa demande coopérative est moins libérale que ce qu’il veut bien laisser entendre ? A quoi ressemble-t-il le plus ? A une de ces boîtes en « kit », contenant des éléments préfabriqués, que l’usager utilise pour obtenir un seul et unique type de produit fini, sans aucune latitude quant au montage, la moindre erreur étant fatale, ou bien à un Lego qui permet de construire toutes sortes de formes, au choix ? N’est-il qu’un puzzle complet qui, une fois reconstitué, donnera toujours la Joconde, ou n’est-il vraiment rien d’autre qu’une boîte de pastels ? (ECO, 1989, 69)
Bien qu’apparemment ressemblant, le modèle de la partition (tel que proposé par Mallarmé) est donc très différent, voire même opposé au modèle du puzzle (tel que proposé par Perec). Cette « tentative » (MALLARMÉ, 1945, 456) prospective n’est pas même, comme Mallarmé le remarque, similaire dans sa conception à ses autres œuvres poétiques : ses Poésies sont en effet construites sur un modèle qui n’est pas celui de la partition, bien que la mélodie du poème lui importe plus que son sensxxii. Nous proposerions pour ses poèmes de la maturité le concept hybride de puzzle musical. De tels puzzles sont les héritiers d’une, voire de plusieurs, tradition(s) que Bernardo Schiavetta nous rappelle, celles des sonnets d’artifice et des nugae difficilis, où l’écrivain détermine les règles de son propre jeu (son œuvre) à l’intérieur d’un jeu dont les règles sont déjà difficiles à satisfaire, en établissant une ou des sur-contrainte(s).
Comme on le sait, les deux rimes des quatrains sont en –ix (ou –yx) et –ore ; celles des deux tercets en –or et en –ixe. Ainsi, les rimes masculines deviennent féminines et vice versa. Le poème s’inscrit dans une longue tradition, celle des sonnets d’artifice. On peut les définir comme des sonnets où quelque procédé formel (une sur-contrainte) se superpose ou s’ajoute aux règles prosodiques qui définissent le sonnet proprement dit. Cette tradition fait partie d’une autre plus ancienne, ces nugæ difficiles dont la pratique est attestée quasiment à toutes les époques de la poésie occidentale, avec des alternances de crédit et de discrédit liées aux changements du goût et de l’éthique littéraire. (SCHIAVETTA, 2006, 73)
Ce rappel nous permet de mieux percevoir la dimension historique de la prédétermination ante-scripturale. Schiavetta revient sur l’énoncé de Mallarmé à propos de son « Sonnet en –yx » (« Il est inverse, je veux dire que le sens, s’il en a un, […] est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. ») : « A mon avis, donc, le sens dont parle Mallarmé ne peut être autre que celui qui apparaît peu à peu, à partir des rimes, pendant la composition du poème. » (Op. Cit., 76). Rattachant cette idée à la Philosophy of Composition de Poe, il rappelle cette déclaration de Mallarmé : « tout hasard doit être banni de l’œuvre moderne, et n’y peut être que feint » (MALLARMÉ, 1945, 230). La mise en œuvre suppose une certaine détermination du rapport entre réel et possible : le possible est prédéterminé de telle sorte que les choix d’écriture obéissent à la nécessité. Une telle construction s’échafaude à partir des nécessités existantes (prédéterminisme ante-scriptural), c’est-à-dire en prenant en compte les diverses normes en vigueur : les normes liées à la grammaire, aux genres littéraires, à la présentation graphique du texte. Ces normes prédéterminent la capacité de lecture, et par rétroaction, les virtualités d’écriture. L’écriture passe par une savante gestion de leurs conflits. Jean Cohen note que :
Il faut tenir compte en effet de l’incidence sur l’ordre des mots des nécessités de la versification. Obligé de sacrifier à la fois à la rime et au mètre, le poète ne peut disposer les mots à sa guise. Signalons, d’ailleurs, une réalisation qui paraît propre aux symbolistes : la postposition d’adjectifs normalement antéposés, tels que doux, beau, etc. Par exemple :
O le bruit doux de la pluie (Verlaine)
Victorieusement fui le suicide beau (Mallarmé) (COHEN, 1999, 182)
Le second exemple ici proposé est bienvenu pour nous sensibiliser au travail du puzzle musical : le suicide beau rime avec mon absent tombeau qui ferme le premier quatrain ; pour ce faire il a donc fallu deux inversions de l’épithète (par rapport aux normes grammaticales). Le mot tombeau a sans doute inspiré – devrait-on dire déterminé ? – le choix de l’épithète ; mais pour qu’une telle rime fût possible, il fallait que le poète opérât ces deux inversions. Ou plus exactement : la rime et le fait que beau était inscrit de tout temps dans tombeau donnent la juste impression, à la lecture, que cette double inversion n’est pas le fruit d’une fantaisie de l’écrivain, mais le résultat nécessaire de la mise en rapport des différents éléments en fonction des différentes lois qui pèsent sur la production de l’objet textuel. Enfantée à l’issue de ce conflit invisible (virtuel), la rime est la note juste qui tinte comme le glas d’une vie consacrée à ce travail, mais aussi l’écho ou le heurt silencieux par lequel les mots se font scintiller réciproquement – leur or, points lumineux des constellations, apparaît.
Cependant le poème du coup de dés, comme nous l’avons dit, ne suit pas les règles des nugæ difficilis. Mallarmé place le jeu de dés au cœur de la tourmente (du hasard). Le hasard y est certes feint et Mallarmé prétend que « le genre, que c’en devienne un […], laisse intact l’antique vers » (MALLARMÉ, 1945, 455). Il le laisse intact dans la mesure où il se place « à côté du chant personnel ». Mais si on le lit dans la continuité du travail poétique précédent, son opération « hors d’anciens calculs » (Op. Cit., 463) déjoue, voire détruit, non seulement la métrique traditionnelle, mais aussi le point de vue personnel. On peut reconstituer ici et là quelques alexandrins, mais la parfaite structure du poème-navire n’est plus qu’une épave dont on retrouve des débris. La perfection classique n’assurant plus à la beauté son éternité, on en vient à douter que le jeu littéraire et ses acteurs aient eu lieu. Le « maître » ne s’exprime plus à la première personne (en un « j’écris donc je suis (celui qui écrit (je)) »), il n’est plus qu’un virtuel acteur à l’intérieur d’une scolie illustrant par un scénario optimal l’axiome du motif prépondérant, énoncé de façon asubjective (UN COUP DE DÉS…). Si nous ne reconnaissons plus la poésie dans le texte éparpillé sous nos yeux, c’est parce qu’elle a délaissé son vieux jouet narcissique – le versxxiii –, pour en construire un autre par lequel elle ne se ferait plus le reflet d’elle-même, mais celui d’une Idée – supérieure à l’ordre à la fois hasardeux et arbitraire du je et de sa langue, commandant un nouvel ordre (celui de la nécessité absolue), un nouvel art de la distribution des éléments. Que les éléments soient désormais – à partir et pour ce poème au moins – les mots et non les syllabes est à la fois prouvé et douteuxxxiv. Il n’est pas douteux en revanche que Mallarmé ait lancé par ce poème un jeu nouveau, permettant de repenser le lien entre écriture et lecture – leur lieu et le positionnement de ses acteurs. Ce jeu relance la musica practica, que Barthes regrettaitxxv, sur un nouveau terrain : le livre et ses feuillets de pages blanches. De même qu’avec Beethoven, « l’idée d’un faire intimiste ou familial est détruite » (BARTHES, 1982, 233). Mallarmé se projette en chef d’orchestre du blanc et requiert de son lecteur de devenir interprète musical. Cependant la composition du poème ne fait pas du lecteur un simple automate spirituel ; elle lui donne à percevoir en la poésie un faire : une création qui fait apparaître du virtuel et renouvelle l’espace de jeu – où les jeux restent à faire.
.>