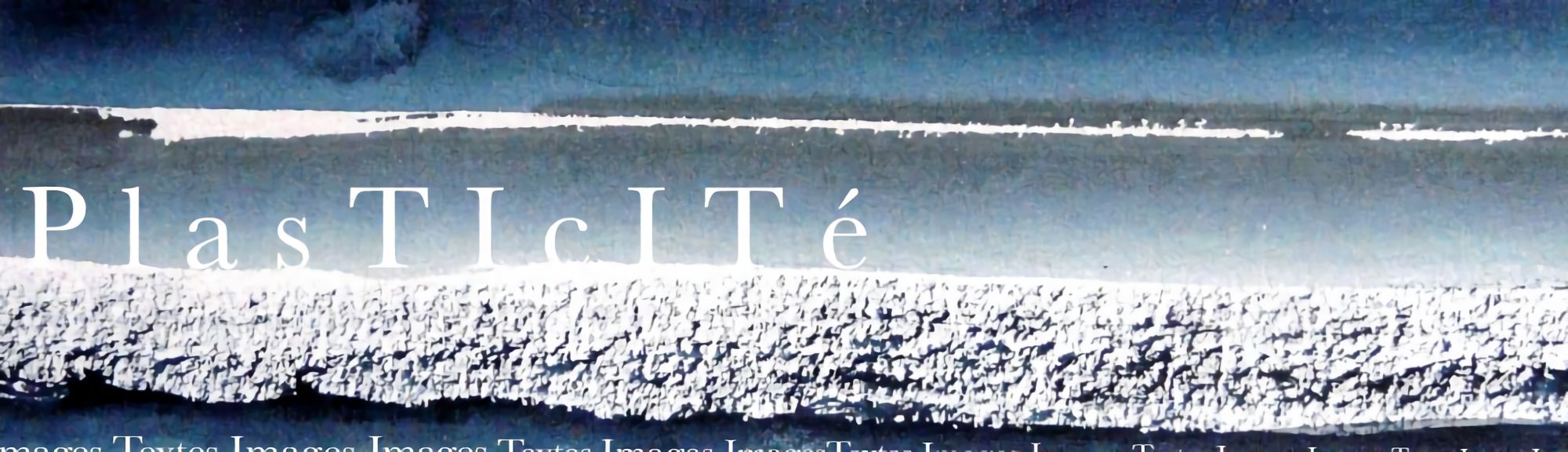La politique […] ce n’est pas l’exercice du pouvoir et la lutte pour le pouvoir. C’est la configuration d’un espace spécifique, le découpage d’une sphère particulière d’expérience, d’objets posés comme communs et relevant d’une décision commune, de sujets capables de désigner ces objets et d’argumenter à leur sujet.
Jacques Rancière1
Ils sont cinq. En manteaux. Bonnets, capuches, écharpes dissimulent en partie leur visage. C’est vrai qu’on est en décembre et que dehors il fait très froid. Ils flânent sur le plateau dans une semi-obscurité. Parfois rassemblés. Ou non. De temps à autres, leur regard s’attarde sur la salle. En off, on entend un échange animé, des voix enregistrées. Puis les flâneurs se débarrassent de leurs épaisseurs de vêtements, avec maladresse ou agacement, selon. Ils sont cinq. Trois femmes et deux hommes. Ainsi commence De(s)faire # 1, le premier des deux « moments dansés » présentés les 9 et 10 décembre 2014 sur la scène de La Fabrique à Toulouse « sur une proposition de Patricia Ferrara2 », comme l’indique la feuille de salle. À ce « moment dansé3 » succède un temps d’échange avec le public, mais, détail important, ce temps est annoncé comme partie intégrante de la rencontre et non comme un simple « bord de scène ». Du reste, la plupart des spectateurs restent pour y participer. D’un jour à l’autre, ceux et celles qui assistent aux deux propositions successives ont néanmoins la surprise de ne pas revivre la même expérience, non seulement parce que chaque « moment » semble faire la part belle à l’improvisation, mais parce que, d’un jour à l’autre, quelque chose s’est ouvert, créant un espace commun entre ceux qui occupent la scène et ceux qui regardent, engendrant les conditions d’un véritable débat autour de la proposition artistique. Or c’est peut-être dans cette béance qui troue le moment dansé que la proposition de Patricia Ferrara prend tout son sens et que devient sensible le processus dynamique de De(s)faire # 1 dont les deux spectacles présentés ne constituent ni l’aboutissement, ni la clôture.
Inventer de nouvelles règles du jeu
Comme l’explique Patricia Ferrara, De(s)faire # 1 est le « module de base » d’un projet plus vaste consistant à interroger les modalités de production d’une œuvre chorégraphique, à briser « les maillons de la chaîne qui nous relie à des modes de faire préétablis qui conditionnent et norment le geste artistique » (FERRARA, N.I., 2014). En vue de créer les conditions de cette expérimentation, elle établit un protocole visant à mettre en lumière les rouages du processus de création par déconstruction et démontage. Comment essayer « de nouveaux découpages », « bousculer les hiérarchies de la représentation », « [sortir] du confinement de chacun à une place déterminée » (FERRARA, N.I., 2014) ? Comment faire advenir un nouveau « partage du sensible4 » entre artistes et spectateurs ? Aux mots que Patricia Ferrara pose sur son projet, on comprend qu’il est fondé sur deux enjeux d’égale importance : un enjeu poétique et un enjeu politique. Véritable « matrice d’interactions potentielles » (ORTEL, 2008, 6), le dispositif de De(s)faire tente d’ouvrir le processus au hasard, à la contingence à toutes les étapes de la création, ce qui va bien au-delà du seul recours à l’improvisation au cours du spectacle – une pratique, du reste, courante dans la danse contemporaine. À travers le parti-pris d’une sorte de démaîtrise productive, De(s)faire s’attache à faire émerger de nouvelles modalités de création, mais aussi à découvrir, c’est-à-dire à inventer et à rendre visible, la politique à l’œuvre dans tout processus créatif - a fortiori quand il s’agit de créer à plusieurs. Ici, la démarche artistique se politise par la prise en compte effective de cet « espace-qui-est-entre-les hommes » à l’intérieur duquel la politique prend naissance et « se constitue comme relation » (ARENDT, 1995, 42). En pleine crise des démocraties occidentales, une telle démarche est le fait d’une artiste « en situation » qui s’interroge sur la possible contribution de l’art à l’invention d’un monde plus juste, vivable pour tous : on peut y déceler le désir de remettre en question les déterminismes qui assignent à chacun une place et une part au sein de la société, le désir de bousculer le « partage des espaces, des temps et des formes d’activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à participation et dont les uns et les autres ont part à ce partage » (RANCIÈRE, 2000, 12). À toutes les étapes de De(s)faire, il s’agit donc de se demander « ce qu’on voit et ce qu’on peut en dire », mais aussi « qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire » (RANCIÈRE, 2000, 12) : de l’artiste ou de celui qui ne l’est pas, du chorégraphe ou de l’interprète, du danseur ou du spectateur.
Afin d’ouvrir cet espace à la pluralité et au dissensus, Patricia Ferrara commence par remettre en question la position d’autorité traditionnellement assignée au chorégraphe. Et elle choisit de le faire de manière radicale, en prenant le parti de s’absenter, de déléguer le processus décisionnel et de laisser place au hasard. Comme elle le dit elle-même, pour De(s)faire, elle « pense », rien de plus. Cette « pensée » s’actualise sous la forme de « cadres d’interprétation » susceptibles de « faire émerger de nouveaux modes de faire » (FERRARA, F.S., 2014) sans pour autant que ces « cadres » fassent système ou puissent se réduire à une formule réitérable risquant de modéliser un processus. En effet, pour chaque module de De(s)faire, ces « cadres » doivent en principe être repensés, « quatre constantes [pouvant être] revisitées ou non à chaque fois » (FERRARA, N.I., 2014) : le lieu d’ancrage du projet, la durée du processus, la qualité et le nombre de personnes impliquées, les instances décisionnelles, par exemple. Cependant, d’un module à l’autre, ces « cadres » constituent toujours les modalités particulières d’une mise en relation entre des personnes issues d’horizons différents réunies autour d’un même objectif : la création d’un moment dansé.
Mettre des joueurs en présence
Pour De(s)faire # 1, l’expérimentation commence par le choix d’un lieu, la Fabrique, vaste bâtiment situé à l’entrée du campus de l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès et qui abrite des bureaux, des salles de travail pour les étudiant.es, des espaces d’exposition et une salle de diffusion accueillant une centaine de spectacles chaque année. In situ, De(s)faire se propose de « traverser un lieu, de saisir son actualité, de la transformer5 ». Cependant, dans ce projet, la Fabrique ne constitue pas seulement un espace à investir dont la configuration informerait l’œuvre à venir ; elle est plus fondamentalement la matrice du projet au sens où elle abrite une microsociété où cohabitent et se croisent toutes sortes de gens. Au sein de cette microsociété (qui dans une certaine mesure s’ignore comme telle puisque nombre de gens fréquentent l’endroit sans nécessairement se connaître), Patricia Ferrara choisit de rencontrer douze personnes avec lesquelles elle mène des entretiens individuels. Ces personnes sont étudiant.e, professeur.e, régisseur, artiste, personnel administratif, spectatrice ou spectateur. Selon un protocole préétabli, deux questions leur sont posées qui doivent leur permettre d’exprimer ce qu’elles ressentent à la place qui est la leur : « Comment habitez-vous la Fabrique ? » et « Qu’est-ce qui vous touche dans la société d’aujourd’hui ? ». Comme nous allons le voir, ces entretiens constituent la première étape d’une série de relais où la parole joue un rôle fondamental.
Comme l’explique Patricia Ferrara, « De(s)faire nous engage sur la voie du débat, de l’écoute et de l’échange » (FERRARA, N.I., 2014) et ce, à toutes les étapes de la création. Cependant, le but de ces échanges n’est pas, selon nous, de réparer un lien social distendu ou abîmé – et le mal-être, les tensions, existent à la Fabrique ; le but n’est pas non plus de proposer « la redisposition des objets et des images qui forment le monde commun déjà donné, ou la création de situations propres à modifier nos regards et nos attitudes à l’égard de cet environnement collectif » (RANCIÈRE, 2004, 33-34). Selon le philosophe Jacques Rancière, cette « attitude » est plutôt le fait d’artistes qui, tout en n’ayant pas renoncé à réaffirmer « la fonction « communautaire » de l’art » (RANCIÈRE, 2004, 35), n’en ont pas moins renoncé à la croyance en sa capacité à transformer le monde. Non. L’enjeu de De(s)faire est moins social ou « relationnel6 » que politique : il s’agit de créer les conditions d’un nouveau « partage du sensible » en donnant une voix aux « sans-voix » de la création, et ce, au sein même d’un lieu dédié à l’art. À la manière de la « forme ouverte » théorisée par l’architecte polonais Oskar Hansen7, De(s)faire se fonde sur le principe de la « communication entre des participants initiés et non-initiés ou provenant de champs de compétence différents réunis autour d’un but commun » (BAL-BLANC, 2012, 35). Ainsi, à partir des entretiens individuels menés avec les gens de la Fabrique, Patricia Ferrara récolte une constellation de paroles qui lui semblent représentatives, soit de la personne qui les a prononcées, soit d’un sentiment plus général. À partir de ce corpus, elle réunit les douze personnes qu’elle a rencontrées afin qu’elles élaborent un argument destiné aux artistes. Sorte de condensé des échanges qui ont eu lieu en amont, cet argument doit être transmis aux cinq danseuses et danseurs chorégraphes quelques jours avant qu’ils ne se retrouvent pour une courte résidence de création de trois jours : charge à eux de prendre le relais et de transformer cet argument en proposition artistique.
Or, ces danseuses et danseurs ne se sont jamais rencontrés ; plus étonnant encore, quatre d’entre eux n’ont jamais travaillé avec Patricia Ferrara et la connaissent à peine. Bien entendu, c’est elle qui a choisi de les impliquer dans De(s)faire # 1 et ce choix ne s’est pas fait complètement au hasard : l’intuition y a sa part, notamment celle que ces cinq personnes sont ouvertes à l’expérimentation et sensibles à sa dimension politique8. En fait, pour De(s)faire # 1, le choix semble s’attacher davantage à des individus qu’à des artistes, la chorégraphe faisant le pari d’une rencontre féconde entre eux – une prise de risque indéniable tant sur le plan humain qu’artistique. Cela dit, Mathilde, Laurence, Raphaël, Émilie et Thomas9 sont tous des professionnels et, comme les gens de la Fabrique, ils viennent d’horizons différents : Laurence a une expérience de performeuse plasticienne. Thomas vient du cirque et des arts de la rue. Raphaël est devenu danseur suite à une reconversion professionnelle et consacre l’essentiel de son temps à une activité de pédagogue dans les conservatoires de région. Seules Émilie et Mathilde se sont engagées précocement dans une carrière d’interprètes et de chorégraphes. Leur rencontre est prévue le jour de la première séance de travail, le 7 décembre 2014, à la Fabrique. Pas question, donc, de compter sur de vieilles complicités susceptibles de reconduire les artistes sur des chemins déjà tracés. Et pas question non plus de compter sur la présence de la chorégraphe pour fédérer le groupe. Le 7 décembre et les jours suivants, Patricia Ferrara ne sera pas là. En maître du jeu, elle a désigné les joueurs. À eux de jouer. Et, en l’absence de règles imposées, ils sont libres de s’organiser pour construire un projet commun, libres de déterminer les termes du « contrat social » sur lequel se fondera le fonctionnement du groupe, libres de choisir leur place dans le processus de travail.
De surcroît, une sixième personne doit être présente pendant les trois jours de résidence à la Fabrique et assister aux deux moments dansés des 9 et 10 décembre. Patricia Ferrara l’a choisie comme un ultime relais, non pour lui déléguer son autorité, mais pour poser son « regard » sur le processus à l’œuvre et en témoigner. Cette personne, c’est moi. Comme Laurence, Thomas, Raphaël et Émilie, au moment où commence De(s)faire, je connais à peine Patricia Ferrara. « Hasard objectif », nous nous rencontrons lors d’une réunion au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse, juste après que vient de tomber l’affligeante nouvelle que « la Cité de la Danse n’est plus d’actualité10 ». La chorégraphe est alors à la recherche d’un chercheur pour De(s)faire # 1. Je suis chercheuse en arts du spectacle à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Le campus du Mirail, c’est un peu chez moi. Je connais la Fabrique pour y avoir déjà travaillé. J’y ai vu des spectacles, des expositions. Et, encore un hasard, la thèse de doctorat que je prépare porte sur les relations entre esthétique et politique dans la danse contemporaine. Très vite, nous nous accordons. Je m’engage à assister à la réunion des gens de la Fabrique puis à suivre le reste du processus. À être dépositaire de cette expérience. À la fois dedans et dehors, mais plutôt dehors que dedans. Or, comme je vais vite m’en rendre compte, il n’est pas facile de rester à l’extérieur d’un processus dont on est l’unique témoin, l’unique dépositaire. Pas facile non plus de quitter la place du témoin pour celle de l’analyste qui est la mienne dans ces pages. Car De(s)faire interroge aussi la position du chercheur vis-à-vis de son objet et, par extension, sa place dans la société : quelle distance adopter ? En quoi sa seule présence influe-t-elle sur le processus observé ? Qu’est-ce qui fonde la légitimité de sa parole par rapport à celle de l’artiste ? Comment cette parole participe-t-elle de la polyphonie du monde, d’une meilleure compréhension de celui-ci ? À quelles conditions est-elle audible ? Etc. Ainsi, De(s)faire conduit le chercheur, à l’instar des autres « joueurs », à réfléchir à sa place dans le « jeu » artistique et social.
Ouvrir l’art sur le « dehors »
Parce qu’il s’ancre dans un lieu et s’ouvre à d’autres acteurs que les seuls artistes, De(s)faire # 1 se caractérise par sa porosité au « dehors », un « dehors » qui ouvre la création à une part irréductible de contingence. Et c’est bien cette ouverture que semble rechercher Patricia Ferrara dans un refus de toute sanctuarisation de l’art au profit d’une « politique [de son] devenir-vie » (RANCIÈRE, 2004, 57) ayant pour finalité « la construction de nouvelles formes de la vie commune, donc son autosuppression comme réalité séparée » (RANCIÈRE, 2004, 62). Selon une telle « politique », l’œuvre tend à disparaître en tant que forme sensible hétérogène pour se constituer en acte, en geste s’inscrivant au cœur de la vie, dont la valeur se mesure davantage à l’aune du politique que de l’esthétique. Cette « politique de l’esthétique » est du reste déjà à l’œuvre dans les projets antérieurs de la chorégraphe. Dans Gestes de terre, mené sous sa direction entre mars et octobre 2013, quatre danseuses ont travaillé en résidence dans des fermes du Tarn où elles ont partagé pendant une semaine la vie des agriculteurs avant de présenter une improvisation publique11 in situ. De même, dans De(s)faire, l’enjeu est de relier l’art et la vie, de remettre l’expérience artistique au cœur de l’expérience quotidienne, en un mot, de considérer que l’art, « ça regarde tout le monde », et d’en tirer toutes les conséquences.
Pour autant, cela n’a pas pour effet la mise en œuvre d’une forme d’activisme12 ou d’interventionnisme artistiques. En fait, dans De(s)faire # 1, les artistes semblent d’abord adopter une position de retrait. Au cours du processus, la chorégraphe puis les danseurs se mettent à l’écoute du bruissement du monde, tentant de capter ce que la Fabrique et les gens qui l’« habitent » ont à dire. Or, en décembre 2014 à Toulouse, le monde bruisse sacrément. Une grève a commencé depuis plusieurs semaines à l’Université Jean Jaurès pour dénoncer les violences policières, les coupes budgétaires, la précarisation des personnels, la fragilisation de certaines filières victimes d’une logique de nivellement par le bas. Étudiant.es et personnels manifestent. Certains menacent de bloquer l’université. En même temps, suite aux violents affrontements qui se sont produits fin octobre sur le site de Sivens et à la mort du militant écologiste Rémi Fraisse, une ZIC (« Zone d’Interpellation Chaleureuse ») s’est installée sur le campus de l’université. Sur ses pelouses, juste en face de la Fabrique, un campement s’est monté semblable à une île au milieu des bâtiments universitaires, avec ses tentes, ses cabanes, son feu de bois, son four en terre, son jardin. Les « zicistes », pour la plupart de très jeunes gens, y organisent des temps d’échange et des activités, proposent de la nourriture à tous ceux et celles qui sont intéressés. Au moment où se met en place De(s)faire # 1, l’heure est plus que jamais au dissensus et au politique.
Par ailleurs, comme Patricia Ferrara le découvre au cours des entretiens qu’elle mène en novembre 2014, les tensions sont fortes à la Fabrique. Si les points de vue convergent sur le diagnostic à poser sur la société, les positions sont en revanche très différentes concernant la vie au sein du bâtiment. Le 18 novembre, au cours de la réunion destinée à la formulation de l’argument, la mésentente est telle qu’au bout d’une heure et demie les participant.es se trouvent dans l’incapacité d’exprimer un désir commun et de proposer un texte aux danseurs. Finalement, la délégation n’ayant pas fonctionné, c’est Patricia et moi qui faisons un montage des paroles, selon nous, les plus significatives. Nous l’appelons « le Haïku de la Fabrique » :
Perturbations permanentes ou le Sanctuaire Impossible
La Fabrique, c’est là où il y a le chien
Une fois, je suis passée, ils étaient tellement affairés qu’ils ne m’ont pas vue
L’invisible est plus fort que le visible, c’est ce qui nous lie
Deux jours avant le début de la résidence de création, ce texte est transmis aux artistes chorégraphes, accompagné d’une photographie13 et d’une référence musicale proposée au cours de la réunion plénière : The Wall des Pink Floyd. Tout un programme... Et pour que les paroles et les voix des gens de la Fabrique ne se réduisent pas à quelques phrases énigmatiques, la chorégraphe met aussi à la disposition des danseurs la bande-son de l’enregistrement qui a été fait au cours de la réunion du 18 novembre.
Cette matière sonore où s’entremêlent des voix inconnues joue un rôle important dans l’élaboration du moment dansé. Avec l’argument, la photographie et la musique, la bande-son constitue un relais primordial qui lie des individualités à d’autres individualités, crée de l’en-commun. Dès le premier jour de travail puis les jours suivants, les danseurs l’écoutent, s’en imprègnent, font connaissance par ce biais avec les gens de la Fabrique et découvrent d’autres aspects du lieu qu’ils « habitent » eux aussi, à ce moment-là. D’emblée, ils donnent une grande importance à l’enregistrement et se sentent les dépositaires des paroles qui s’y échangent. Après l’avoir écouté, tous s’accordent à dire qu’il est « intéressant de commencer par des voix du dehors » et que « les voix font résonance et ont donné une couleur ». Finalement, après discussions, le groupe décide d’en faire entendre une partie pendant le moment dansé, parce que (c’est Laurence qui argumente) « c’est dommage que le public ne l’entende pas car ça a vraiment du sens ». À quoi elle ajoute : « Moi, ces témoignages-là, j’aime leur dimension brute, réelle, comme ce sol ».
Cette porosité au dehors, Mathilde, Thomas, Émilie, Raphaël et Laurence, en font rapidement un principe de travail. Comme Patricia Ferrara, mais sans qu’aucune consigne n’ait été donnée, ils souhaitent « traverser le lieu », « saisir son actualité ». Dès l’après-midi du premier jour, Mathilde propose de sortir de la salle de spectacle pour visiter la Fabrique et le campus de l’université. Ensemble, le groupe fixe les modalités de cette sortie : une « marche sensorielle » silencieuse de trois quarts d’heure pour « s’imprégner de l’atmosphère du dehors ». Nous voilà donc dans le froid, emmitouflés dans nos manteaux, bonnets, capuches, écharpes. Nous flânons sur le campus presque désert, le regard mobile, le nez en l’air - on est dimanche et les étudiant.es ne sont pas là. L’université est en pleine reconstruction et, entre les bâtiments démolis, les palissades, les préfabriqués, elle semble inhabitable et désolée. On y voit des tiges à béton, des trous béants, des pans de murs, de vieux ordinateurs qui traînent. Ici et là, de jeunes arbres tout juste plantés pointent leur tronc fragile vers le ciel. Rapidement, les occupant.es de la ZIC nous repèrent. La discussion finit par s’engager. Ils nous font visiter leur campement, nous présentent leur programme. Au final, le temps manquant, le groupe termine la balade par une visite éclair de la Fabrique.
Comme la bande-son et ses « voix du dehors », la balade et la rencontre à laquelle elle donne lieu ont un impact très important sur la suite du processus de travail. C’est qu’elles font naître des sentiments très différents chez les uns et les autres ; le projet de société incarné par les militant.es de la ZIC suscite le débat. Le dimanche après-midi, de retour dans la salle de spectacle, il est question d’« autogestion », de « liberté », d’« alternative », de « collectif », d’« utopie », de « lutte », de « marge » et de « centre », mais aussi de « jeunesse », d’« enthousiasme », de « sincérité » et de « souffrance ». Comme en écho aux gens de la Fabrique, les danseuses et les danseurs finissent par exprimer « ce qui les touche dans la société d’aujourd’hui ». Quant au projet de création, il s’ouvre à un « dehors » plus vaste : la ZIC, le campus, la société tout entière. À la fin de la première journée de travail, tous sont conscients des résonances entre le projet De(s)faire et les circonstances particulières, politiquement chargées, dans lesquelles il s’actualise. C’est pourquoi la marche sensorielle du premier jour, en plus de nourrir l’imaginaire du moment dansé, détermine en grande partie, selon nous, les modalités d’organisation que le groupe finit par adopter.
« Faire affleurer le processus14 »
En effet, passées la première rencontre et l’incertitude provoquée par l’absence de la chorégraphe15, passés les premiers échanges autour de l’argument, l’écoute de l’enregistrement, la promenade sensorielle, les cinq artistes chorégraphes choisissent dès le deuxième jour de s’organiser en « collectif ». Ce mode d’organisation a pour effet de prolonger la mise en débat de toutes les décisions relatives à l’organisation du travail et aux choix esthétiques : pendant trois jours – ce qui, en soi, constitue un temps de création très court –, les cinq danseurs et danseuses consacrent l’essentiel de leur temps à des discussions et à des négociations. Quant au temps d’expérimentation sur le plateau, il se limite le plus souvent à une improvisation d’une quarantaine de minutes par demi-journée à laquelle tous participent. Outre l’impression profonde laissée par la visite du campus le premier jour, je perçois dans ce choix d’organisation un effet indirect de ma présence qui s’impose progressivement comme un « regard extérieur » au travail du groupe, regard qui se substitue au moins partiellement à celui de la chorégraphe. Parce que je suis « dehors » à faire office de premier spectateur, il leur est plus facile de rester tous « dedans ». Aussi, une fois que la confiance s’est installée entre eux et moi, les danseurs sollicitent-ils mon avis, remettant en question la nature de mon implication dans De(s)faire et brouillant insensiblement la frontière qui sépare a priori la recherche de la création artistique.
Le fonctionnement en collectif a également pour effet la recherche d’un consensus, c’est-à-dire d’un « plus petit dénominateur commun » entre tous les membres de l’équipe. C’est ainsi que la création se resserre autour de l’expérience vécue au cours de la promenade sensorielle, mais aussi autour d’un sentiment partagé de responsabilité à l’égard des gens de la Fabrique. En fait, loin de se sentir libres de faire ce qu’ils veulent, les danseurs tentent de définir ensemble les contraintes qui sont les leurs dans De(s)faire, parmi lesquelles celle de restituer dans la proposition artistique une part du « réel » dont l’argument et l’enregistrement sont la trace. Dans l’ensemble de leur approche, on sent le désir (le besoin ?) de réduire la part du hasard pour découvrir la nécessité propre du projet avec, au premier chef, celle de relayer en corps les paroles et les sentiments exprimés en amont du temps de résidence – autrement dit, la nécessité de ne pas briser totalement « les maillons de la chaîne » de création malgré la dissémination des instances décisionnelles. Tout cela tisse la « matière » du moment dansé qui s’organise progressivement en cinq séquences successives, en partie improvisées : une marche silencieuse, en manteaux, avec l’enregistrement pour fond sonore ; la « perturbation » des corps ; la séquence dite du « Mur » sur un morceau célèbre des Pink Floyd ; la construction d’une barricade ; la chaîne humaine. Comme on le voit, dans De(s)faire # 1, la politisation du processus se trouve redoublée par la thématisation du politique au sein de la proposition artistique, ce que l’argument à lui seul ne laissait pas nécessairement présager.
En même temps, l’autonomisation des danseurs et la mise en débat des décisions relatives à la création finissent par provoquer une forme de conflictualité productive qui contamine la forme elle-même, une forme qui va progressivement se trouer, se défaire. Le matin du troisième jour, alors que la présentation publique doit avoir lieu le soir même, le consensus vole en éclat. Est-ce la proximité de la rencontre avec le public qui accule chacun à une position plus tranchée ? En tout cas, pour la première fois, le désaccord est sensible et une solution négociée semble difficile à trouver. La discorde porte sur l’utilisation de la musique des Pink Floyd. Émilie, « par qui le scandale arrive », trouve que c’est une musique très connue, très puissante et que la proposition du groupe est beaucoup trop fragile pour lui résister. Elle s’inquiète du « résultat ». Dans une large mesure, Mathilde partage l’avis d’Émilie au sens où elle attache de l’importance à la forme proposée, contrairement à Thomas, Laurence et Raphaël pour qui ce n’est pas l’essentiel dans ce projet. Ainsi, Laurence souhaite que « l’on montre le processus » et pense qu’il faudrait plutôt se demander « comment il va transpirer ». Alors que débat se prolonge, Thomas finit par proposer une solution qui s’impose à tous comme la plus pertinente : pourquoi ne pas mettre cette question en débat avec le public et lui demander de trancher ? Thomas – selon moi, en toute conscience – vient de briser un nouveau « maillon de la chaîne » en ouvrant le processus de création à de nouveaux partenaires : les spectateurs.
Il n’en reste pas moins que le premier moment dansé présenté au soir du 9 décembre s’avère assez conventionnel. D’abord, parce que De(s)faire # 1 est donné sur la Scène de la Fabrique dans les conditions d’un « vrai » spectacle ; ensuite, parce qu’une conduite son et lumière esthétise et structure la proposition. Le mardi après-midi, les danseurs ont transmis des consignes précises à Karine, la régisseuse de la compagnie : semi-obscurité pour la marche silencieuse ; découpe lumineuse sur le fond de scène pour la séquence du Mur ; noir final. Au cours du spectacle, le public est attentif. Patricia Ferrara est dans la salle ; elle vient découvrir ce que ces cinq-là ont fabriqué en son absence. Quant à moi, je reconnais au fur et à mesure les cinq séquences qui structurent l’improvisation et donnent à voir une écriture lisible, porteuse d’un propos assez transparent. Je trouve aussi les cinq danseurs très concentrés, très « pros » : ils se sont naturellement mis en situation de représentation plus que de présentation d’un processus de travail, s’attachant davantage à garantir une « forme » qu’à continuer à la faire évoluer. Ainsi, même le débat provoqué autour du choix de la musique ne réduit pas, ce soir-là, la distance entre les artistes et les spectateurs : le célèbre morceau des Pink Floyd a commencé. Émilie, Thomas et Laurence sont collés au mur du fond de la scène et y dessinent des figures grotesques, cul par-dessus tête. Devant eux, Raphaël et Mathilde se désarticulent, comme s’ils étaient victimes d’une étrange perturbation intérieure. Tout à coup, Thomas s’avance, demande à Karine de couper le son et chacun, à tour de rôle, expose « le problème » au public. Un court échange a lieu puis on décide d’un vote à main levée. Et, bien que certains spectateurs dans la salle aient exposé des réserves, le « oui » l’emporte largement. La séquence dite du « Mur » se fait donc en musique. Après le noir final, le public est invité à rester pour échanger avec les artistes. Sur le plateau, assis en demi-cercle : Laurence, Émilie, Mathilde, Raphaël, Thomas, Patricia et moi. Parmi les spectateurs et spectatrices présents, peu viennent nous rejoindre. De façon générale, la proposition ne semble pas susciter de réelle surprise. Anne Hébraud, enseignante ayant participé à la construction de l'argument, dit avoir eu l’impression de reconnaître des gens de la Fabrique dans le spectacle. Il y a aussi ce jeune militant de la ZIC : il est venu voir le spectacle pour se changer les idées et, surprise, il découvre sur la scène le reflet exact de ce qu’il y a dehors, sur le campus. Au final, l’échange ne dure pas très longtemps et se concentre plutôt sur la parole des artistes. Pour moi, et bien qu’il ait été annoncé au public comme un moment à part entière du projet, il ressemble à un simple « bord de scène ».
Néanmoins, entre le mardi et le mercredi, quelque chose continue de se « défaire ». La présentation du second moment dansé étant prévue en fin de matinée, l’équipe se retrouve à dix heures pour une ultime séance de travail – soit un ultime temps d’échange. Patricia Ferrara est là et prend la parole. Apparemment, le moment qui l’a le plus intéressée est celui où les danseurs font intervenir le public. Mais pour elle, cette rupture n’est pas suffisante telle quelle. Elle revient sur ses intentions dans De(s)faire : comment « briser un maillon dans le spectacle et accepter qu’il soit ouvert » ? « Est-ce qu’on pourrait accepter de ne pas savoir, de ne rien prévoir ? ». La chorégraphe remet aussi en question les modalités du débat avec le public tel qu’il s’est déroulé la veille : elle aurait aimé « donner la parole aux minoritaires » et « répondre à la question du choix autrement que par la validation du plus grand nombre ». Une discussion s’engage sur la relation entre les artistes et les spectateurs : comment interroger cette relation au même titre que les autres paramètres de production de l’œuvre sans tomber dans le spectacle « participatif », sans jouer les « animateurs » ? Laurence suggère que les danseurs entrent en même temps que le public plutôt que d’être déjà dans la salle ; Patricia propose de supprimer le noir final… autant de solutions qui ne sont pas sans rappeler les processus de distanciation préconisés par Brecht pour un théâtre politique. Elle rappelle aussi que, d’après elle, seule la parole peut « faire affleurer le processus ». Aiguillonnés par ces remarques, les cinq danseurs réfléchissent aux moyens de créer une plus grande porosité entre eux et le public, aux moyens d’ouvrir des espaces de débat. Ils tombent d’accord sur quelques principes : ne pas remettre en question la trame d’ensemble de la proposition mais en « détendre la structure, ouvrir des fenêtres ».
Second moment dansé. Cette fois, le plateau est vide. Les cinq danseurs se sont mêlés aux spectateurs dans le hall, en manteaux, bonnets, écharpes et entrent dans la salle en même temps qu’eux. Le spectacle commence. Comme prévu, on entend les voix des gens de la Fabrique qui résonnent en off et se superposent à l’image de ces cinq-là, qui flânent. Maintenant qu’ils sont les seuls à rester debout, le public devine que ce ne sont pas de « simples spectateurs ». Au cours de la discussion du matin, il a été décidé de supprimer tout effet de lumière. Le spectacle présenté est donc beaucoup plus sobre que celui de la veille. Il est aussi beaucoup, beaucoup plus ouvert. D’ailleurs, est-ce encore un spectacle ? Au bout d’un quart d’heure, Thomas s’adresse aux spectateurs. Musique ou pas musique ? Cette fois, le débat se prolonge. Le public souhaite écouter la musique avant de se décider. Au bout d’une dizaine de minutes, une spectatrice propose de tirer au sort. Une fois de plus, le processus s’ouvre au hasard. À ce moment précis, je pense aux citoyens de la vieille Athènes qui faisaient du tirage au sort un outil politique au service de la démocratie. Pile ou face ? Le sort décide en faveur de la musique. Le spectacle reprend mais ne se referme pas pour autant : une porosité s’est créée entre les spectateurs et les artistes qui continue de trouer la représentation. Ainsi, au cours de la dernière séquence d’improvisation, l’échange reprend naturellement. Entre le moment dansé et la discussion qui doit suivre, la frontière n’est plus nette. Quelque chose a commencé qui ne demande qu’à se prolonger. Les conditions d’un débat sont réunies. Il va durer longtemps, cette fois.
Une assemblée se forme qui réunit toutes les personnes présentes, à égalité de parole, à égalité d’importance. D’ailleurs, les spectateurs et spectatrices sont beaucoup plus nombreux que la veille à s’exprimer, plus nombreux aussi à venir s’asseoir sur le plateau aux côtés des artistes. En cela, cette rencontre constitue un véritable moment politique et non un simple « bord de scène ». Ce glissement est sensible aussi à la teneur de l’échange : la discussion roule beaucoup moins que la veille sur l’expérience des danseurs au sein du processus. Au-delà du sentiment de chacun, ce qui se joue entre toutes les personnes présentes est le partage d’une compréhension. Or, la proposition ne fait pas consensus. Pour certains, elle est intéressante parce qu’elle remet en cause la place traditionnellement assignée aux artistes et aux spectateurs, les premiers « [sachant a priori] à peu près où ils vont » et les seconds « [venant] voir ceux qui savent ça ». Quand les artistes « sont dans le doute » et « partagent ce doute » avec le public, « ça bouscule ». Pour d’autres, l’intérêt de la proposition tient au fait que le spectateur est « mis en position d’actif » sans pour autant que sa participation soit nécessaire. Une partie du public est plus critique et renvoie aux artistes qu’une telle proposition peut engendrer des frustrations, que De(s)faire # 1, « ce n’est pas un spectacle. Ce n’est pas de la danse ». Un jeune homme visiblement agacé lance aux danseurs : « Vous n’êtes plus des artistes, on n’est plus un public ». Un autre spectateur, plus serein, explique que De(s)faire pose autant la question du pouvoir que celle du plaisir : comment Patricia Ferrara trouve-t-elle son plaisir dans cette expérience ? Et quel plaisir le spectateur peut-il en tirer, lui ? Le plaisir de l’étonnement, du questionnement suffit-il ?
Politiser le processus : vers une « autosuppression de l’œuvre comme réalité séparée16 »
Ainsi, qu’ils s’en réjouissent ou le déplorent, les spectateurs ont bien remarqué que De(s)faire # 1 tend à remettre en question l’existence même de l’œuvre à travers la politisation du processus de création. Ne sommes-nous pas ici confrontés à la limite du « devenir-vie de l’art », à la suppression de « l’hétérogénéité sensible qui fondait la promesse esthétique » (RANCIÈRE, 2004, 57) ? Plus précisément, De(s)faire # 1 hésite, selon nous, entre deux voies possibles d’une politisation de l’art, ici mises en tension : dans les images assez conventionnelles proposées par les danseurs (la barricade, la chaîne humaine, par exemple), nous reconnaissons un modèle fondé sur la médiation représentative faisant le pari d’une sorte d’efficacité « pédagogique » de l’art. À cet égard, la proposition formelle peut sembler très littérale, insuffisamment autonome, à la limite du cliché, sans parler du fait qu’elle se fonde plus ou moins consciemment sur le présupposé que l’œuvre constitue un « message » à déchiffrer et non un élément tiers se tenant entre les artistes et les spectateurs. Du reste, les cinq danseurs sont parfaitement conscients des limites esthético-politiques de leur proposition, certains assumant mieux que d’autres, nous l’avons vu, une forme de naïveté et de littéralité qu’ils auraient tenté de dépasser dans le cadre d’un processus de création plus long et plus approfondi. On peut se demander, du reste, si du fait qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés, les danseurs étaient réellement en mesure de dépasser le stade de la rencontre interpersonnelle et artistique au profit d’une organisation différentielle du travail potentiellement plus efficace : parce qu’ils ne connaissaient pas leurs partenaires, aucun n’a pris la décision de mener le projet – une décision qui aurait pu paraître arbitraire en plus d’être contraire à « l’esprit » de De(s)faire, apparemment fondé sur des valeurs démocratiques. De même, Patricia Ferrara fait le constat a posteriori des limites de son entreprise. Lors de la réunion-bilan de De(s)faire # 1 en janvier 2015, elle avoue que le moment dansé l’a surprise par son caractère conventionnel. Plus tard, en aparté, elle me dira aussi s’être sentie prise dans une « aporie », tiraillée entre deux exigences : celle de faire émerger de nouveaux « modes de faire » et celle de créer une œuvre intéressante sur le plan chorégraphique. Dans De(s)faire comme dans Gestes de terre, elle a trouvé la proposition esthétiquement « ratée », ce qui a engendré chez elle une grande frustration. Mais en renonçant à diriger ses projets autrement que par l’invention de « cadres d’interprétation », en ouvrant le processus à la pluralité et au hasard, n’a-t-elle pas renoncé à son statut d’auteure – d’une forme, d’une écriture ? N’a-t-elle pas pris le risque de substituer l’acte à l’œuvre, ou plutôt de faire de l’acte l’œuvre ?
En effet, la politisation du processus de création en déplace profondément les enjeux dans la mesure où c’est le processus en lui-même qui est ici l’objet d’une expérimentation fondée sur l’écart, la contingence, la remise en cause d’évidences sensibles. Aussi De(s)faire tend-il vers ce que Jacques Rancière appelle un « modèle archi-éthique » d’efficacité de l’art : celui d’un « art sans représentation, [d’un] art qui ne sépare pas la scène de la performance artistique et celle de la vie collective » (RANCIÈRE, 2008, 61). Et, de fait, dans De(s)faire #1, l’attention portée à la qualité des échanges, à la mise en œuvre de relais aux différentes étapes de la création finit par prendre le pas sur la recherche d’une forme inédite susceptible de provoquer un écart esthétique. C’est la relation qui est expérimentée, non la forme qui découlera du processus : relation entre des personnes et un lieu ; relation entre la chorégraphe et les danseurs ; relation des artistes chorégraphes entre eux ; relation entre les artistes et ceux qui ne le sont pas ; relation entre l’art et la vie. Bien sûr, de ce strict point de vue, De(s)faire constitue, selon nous, une expérimentation réussie et le démontage du processus de création a une réelle portée émancipatrice en permettant de faire émerger des « capacités nouvelles, en rupture avec l’ancienne configuration du possible » (RANCIÈRE, 2008, 70). Dans le cas de De(s)faire # 1, il s’agit de formes nouvelles de circulation de la parole et, jusqu’à un certain point, de nouvelles capacités d’agir. En ouvrant des espaces de dissensus au sein de la chaîne de création chorégraphique, en créant des « voisinages risqués », en refusant d’anticiper les effets de l’expérience sur ceux et celles qui y sont impliqués, De(s)faire fait advenir des sujets politiques. À l’heure où nombre d’artistes se résignent à une « politisation de l’impuissance » (MICHAUD, 2003, 14), cette ouverture de nouveaux espaces politiques dans le champ de l’art est certes intéressante. Mais, corrélativement, nous constatons que le « voisinage risqué » entre les différents acteurs du processus réduit la prise de risque esthétique, par un étrange effet de compensation. Ainsi, le politique menace à tout moment d’absorber l’art qui peine à se maintenir comme champ autonome. S’il y a mise en jeu – ici au sens de mise à l’essai, d’expérimentation –, elle est davantage politique qu’esthétique. Est-ce pour ces raisons que Patricia Ferrara réfléchit à modifier les règles du jeu du prochain « module » de De(s)faire ? Et qu’elle a d’ores et déjà pris la décision de repenser sa place dans le processus de création, autrement dit, comme elle le dit elle-même, de « moins s’absenter » ?