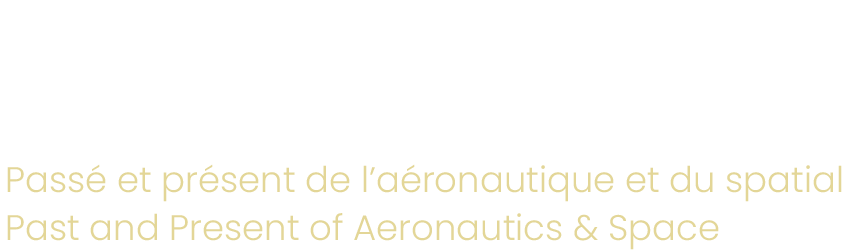1957 et le premier Spoutnik ont achevé de faire rentrer l’espace, son utilisation et sa perception par les sociétés humaines dans un nouveau paradigme. Dès lors, il n’était plus seulement observé par l’astronome, imaginé par l’écrivain ou le lecteur de science-fiction1 et quelquefois très brièvement approché, mais ouvert sur un large champ de possibilités que son exploitation, son exploration et sa perception entretiennent encore aujourd’hui. L’histoire de l’intervention de l’homme dans l’espace, qu’elle soit celle de l’humain ou de ses substituts mécaniques, est riche. Cette présence a pourtant ses limites, surtout lorsqu’il est donné d’observer les activités dans les vastes régions qui s’étendent au-delà de la Lune. Ce qui a pu se construire et se réaliser tout autour de la Terre en moins d’une soixantaine d’années n’est plus alors que missions ponctuelles, majoritairement exploratoires.
Cet essai se propose d’étudier les pratiques qui structurent l’histoire des activités humaines dans cette région lointaine : pratiques in situ, indirectes ou réflexions théoriques. Notamment, nous proposons un outil/cadre, celui de l’espace « lointain », susceptible de répondre aux enjeux que posent la perception, la visite, l’occupation et l’appropriation de cette région spatiale. S’il s’agira d’en donner une définition efficace, nous nous intéresserons également aux atouts et faiblesses de cette notion. Enfin, nous montrerons comment se matérialise aujourd’hui cet espace « lointain » dans la bibliographie de l’espace.
1. Comment définir l’espace « lointain » ?
Cerner l’espace lointain demande en préalable de penser la nature cosmographique2 de l’espace. Quel que soit le support3, l’ouvrage ou le discours observé4, le cadre que l’on donne à l’espace est souvent résumé en une seule et simple phrase : « un milieu situé au-delà de l’atmosphère terrestre et dans lequel évoluent les corps célestes5. » Même si débat il y a quant à la cohérence entre limite légale du domaine spatial et limites physiques de l’atmosphère, l’espace est aujourd’hui cerné par une définition qui semble fermement intériorisée par tous les publics.
La chose se complique lorsque l’on ne s’intéresse plus à l’espace comme prolongement de la Terre, mais à l’espace lui-même. Plusieurs frontières ont pu être données par l’homme aux régions qui le constituent. Les plus opérantes, bien que parfois fluctuantes dans leur précision ou dans les objets qu’elles sélectionnent, sont probablement celles forgées par la communauté des astronomes et réinvesties dans les travaux de vulgarisation. Elles peuvent être variées et s’appuient le plus souvent sur les conditions naturelles et physiques du milieu spatial. On parle alors du système solaire interne, externe, de milieu interplanétaire, de milieu interstellaire6… D’autres frontières peuvent cependant apparaître lorsque la discipline ou le propos s’intéressent non aux seules questions d’observation, mais également à des aspects techniques, historiques, juridiques ou géopolitiques. Sans s’affranchir totalement des premières, ces nouvelles frontières apportent alors précisions ou nuances dans un jeu cosmographique que les activités humaines rendent particulièrement complexe.
Alain Dupas propose ainsi une limite précise à l’espace proche qui permet d’identifier les prémices d’un espace plus lointain : « Avec les risques provoqués par la multiplication des débris, les menaces de destructions par des missiles antisatellites […] le proche cosmos, jusqu’à un millier de kilomètres au-dessus de la surface terrestre, n’est-il pas en train de devenir une zone dangereuse pour les engins spatiaux7 ? » André Lebeau suggère quant à lui une lecture de l’espace par l’accès : « Deep Space, l’espace profond, c’est ainsi que la NASA qualifie ceux de ses programmes qui sont tournés vers l’exploration des régions lointaines de la zone inaccessible : planètes, astéroïdes, comètes, espace interplanétaire8. » Une définition par l’accès est également mise en œuvre par Serge Grouard dans La guerre en orbite, et renforcée par la question des enjeux, notamment stratégiques :
L’Univers lointain ne peut être l’un de ces enjeux du simple fait de son inaccessibilité. Notre espace solaire, trop vaste, trop éloigné, dont les planètes sont trop hostiles pour y envoyer autre chose que des sondes automatiques à faible durée de vie, ne peut faire l’objet que de quelques incursions temporaires ; à ce titre, il ne saurait davantage être un réel enjeu9.
Enfin, on peut citer la définition plus complète encore d’Everett Dolman qui explique que :
Legal descriptions and universal agreements were established despite the absence of a working definition of the limits of space. Like the sea, outer space can be divided into subregions, usually defined by their distance from the earth. These distinctions, described in astropolitical terms, include near-Earth and geostationary space, cislunar and translunar space, deep space, etc., and are usually put forward by military or nationalist supporters who wish to derive maximum control of the commons for the benefit of their constituencies10.
Chaque sujet, chaque lecture de l’espace peut apporter une variation suivant le postulat ou les besoins de l’étude. Il ne semble pas exister aujourd’hui de répartition précise et parfaitement unifiée, partagée par tous, capable de délimiter les régions qui organisent l’espace. Pour chacune de ces interprétations, néanmoins, il est à remarquer que deux grandes zones finissent souvent par apparaître. Une première zone, celle d’un espace proche, et souvent liée aux habitudes et nécessités quotidiennes des sociétés : c’est un espace que l’on qualifie le plus souvent d’utile, où se retrouvent télécommunications, télédétections, positionnements par satellite, observations météorologiques... Une seconde région, celle d’un espace plus lointain, aujourd’hui presque exclusivement tournée vers les pratiques de l’exploration : il s’agit d’un espace moins utile en termes de bénéfices immédiats pour les sociétés, mais hautement scientifique, dont l’étude et l’occupation ponctuelle sont présentées comme déterminante pour la civilisation humaine11.
Cette distinction, bien que très large, semble justifiée pour expliquer certaines des activités spatiales du second XXe siècle. Elle présente aussi l’intérêt d’introduire la notion d’espace lointain. Pour comprendre à quoi correspond cet espace lointain, attachons-nous à lui donner une définition par la limite. On peut ainsi distinguer trois caractéristiques qui le séparent de l’espace proche.
1.1 Une limite géographique et technique
Une première limite peut se matérialiser sous la forme d’une cosmographie spatiale profondément structurante, bien que prise sans calcul kilométrique précis. L’espace lointain diffère en premier lieu de l’espace proche par le lien qui unit capacités technologiques, distances, temps de parcours et environnement du milieu. Si l’occupation et la mise en économie des quelques milliers de kilomètres qui entourent la Terre sont désormais actées, rendues accessibles par une distance faible12 et un environnement relativement favorable, le milieu spatial peut devenir rapidement difficile à franchir, à traverser et à occuper. Passé la Lune13, atteindre un astéroïde, Mars, a fortiori Jupiter, Saturne ou Pluton, requiert des capitaux scientifiques et techniques considérables pour des missions automatiques, et bien plus encore pour d’hypothétiques vols habités. Et plus les distances se font importantes, plus l’environnement à atteindre se fait complexe, plus les missions se font délicates, longues et exigeantes. En somme, « l’espace a les dimensions de nos techniques14. »
Une précision s’impose : chaque nation peut prétendre à sa propre définition du lointain, certaines puissances spatiales étant plus avancées que d’autres et ayant, à un certain nombre de reprises, déjà exploré Mars Vénus ou Jupiter. C’est le cas aujourd’hui des États-Unis ou de l’Agence spatiale européenne. Leur compréhension du milieu, l’adaptation d’une partie de leur technologie spatiale et la formation de leur personnel scientifique et technique aux enjeux du lointain se sont déjà réalisées. Leurs situations, bien que différentes, ne sont donc nullement comparables aux pays qui se lancent dans l’exploration de l’espace, et dont les premiers pas peuvent s’avérer balbutiants. « Prendre Mars » par l’envoi d’une sonde est un exercice difficile auquel peu de nations se sont essayées directement et indirectement15. Le lointain est aussi lointain, car rares sont ceux qui peuvent prétendre à son accès malgré une certaine démocratisation16 des expéditions qui y sont conduites.
Dans le cadre d’une pratique générale de l’exploration, la visite et l’étude du milieu spatial demeurent jusqu’à aujourd’hui répétitives, sans rupture technologique véritable17, malgré les recherches menées en ce sens18. Pour ceux qui font la majorité des missions in situ (les États-Unis et l’Europe principalement), une réussite ou sa réplication ne suffisent pas à modifier ce tracé. Et si les orbiteurs, rovers ou atterrisseurs s’accumulent, les technologies permettant la concrétisation des premiers vols habités vers Mars ou au-delà ne sont pas encore arrivées à maturité. Nonobstant une fréquentation en hausse, l’espace lointain n’a toujours pas reculé ses frontières, et les a parfois même avancées à la faveur des échecs, des changements de politique spatiale et de la perte de certains savoir-faire19. La Lune, après le succès des missions Apollo a ainsi été rendue à l’espace lointain pour ce qui a trait à son exploration humaine.
Cependant, si les défis posés par la cosmographie participent à expliquer la différence entre espace proche et espace lointain, les caractéristiques du milieu spatial rendent l’argument de la distance parfois inopérant. L’éloignement physique peut certes être synonyme de lointain, mais l’environnement peut se montrer en certaines régions éloignées particulièrement favorable à des missions traditionnellement dévolues à l’espace utile. C’est le cas pour les points de Lagrange qui, bien que situés au-delà de la Lune sont parfois présentés comme des zones d’occupation stratégiques futures20, d’accès et d’occupation facilités. Une définition par la seule cosmographie n’est donc guère suffisante.
1.2 Un usage déterminant
Une seconde caractéristique de l’espace lointain est à trouver dans les usages qui sont faits du spatial. On peut en effet constater que la majorité des activités qui se déroulent dans l’espace proche est naturellement tournée vers la Terre. Positionnement par satellite, télécommunications, observation militaire ou civile de la planète… cette architecture, qui se construit et se renouvelle depuis de longues décennies, est d’une grande importance pour le fonctionnement des sociétés humaines. L’espace lointain tourne quant à lui son regard au-delà des orbites utiles. Et au contraire de la banlieue terrestre, les conséquences de sa visite correspondent principalement à l’amélioration des connaissances plus qu’à une perspective d’exploitation économique directe ou d’occupation à long terme.
Certes, l’exploration in situ de l’espace lointain n’est pas sans ambitions politiques, économiques ou diplomatiques. Elle n’est pas également sans enjeux pratiques et scientifiques. Si les régions reculées de l’espace apparaissent comme un lieu à l’usage profondément pacifique, elles n’en demeurent pas neutres pour autant. La course au système solaire, les débats sur l’organisation de cette exploration (sur la place de l’homme dans l’exploration spatiale par exemple21), l’organisation des réseaux scientifiques, les relations parfois compliquées dans la collaboration internationale, les échanges technologiques entre exploration interplanétaire et occupation de l’espace circumterrestre, la force normative et culturelle des découvertes, les stratégies de communication encouragées par chaque agence spatiale, enfin tout ce qui compose ou pourrait composer les pratiques d’exploration du lointain, contribuent à faire de l’espace lointain un lieu et un objet de tension. Cet espace n’est pas qu’un enjeu de culture ou de civilisation, placé à plus ou moins long terme. Il est également un enjeu de société, de pouvoir et de puissance. À ce titre, la question des objectifs n’est pas sans poser une nouvelle difficulté à une potentielle limite par la cosmographie. Ainsi, trouve-t-on des programmes d’exploration dans l’espace lointain in situ (Cassini-Huygens, Vénus Express, Rosetta), mais également sur le territoire de l’espace proche (CoRoT22, IBEX23), voire sur Terre, passant par les réseaux de télescopes, ou encore pour partie par les études menées sur les vols habités, préparatifs au voyage vers Mars (Mars50024).
1.3 Des ambitions spécifiques
Enfin, une troisième caractéristique se retrouve dans les enjeux socio-économiques et les perceptions sociétales et culturelles du phénomène spatial. L’espace lointain correspond à un espace visité, mais rendu difficilement accessible politiquement, socialement et économiquement par l’absence d’enjeux et d’ambitions réalistes pour son occupation et son exploitation. Au-delà des quelques missions qui y sont conduites et des objectifs scientifiques qui y sont fixés, il apparaît comme l’horizon de l’avenir spatial, où les intentions tiennent avant tout d’un discours de conviction plus que de probables réalisations in situ à court et moyen termes. Il est le lieu de prédilection de nombreux projets hypothétiques25, comme l’installation de colonies à la surface de Mars ou l’exploration automatique (et humaine) de l’espace interstellaire. Des projets qui aujourd’hui encore relèvent d’une prospective inaccessible. Certes, ce statut est fluctuant suivant les périodes et les publics. Mais après bientôt soixante ans d’espace in situ, il demeure constant, malgré une certaine banalisation de sa visite, de sa communication, et de sa présence dans les imaginaires collectifs. Bien que l’espace lointain soit en permanence exploité par la communication des agences spatiales (notamment la NASA), il n’intéresse le quotidien des sociétés que très ponctuellement. Il n’en reste pas moins une figure tutélaire qui échappe à la Terre et demeure encore aujourd’hui un puissant moteur pour le domaine de l’imagination et de ses concrétisations pratiques (littérature de science-fiction, jeux vidéo, cinéma).
Ces trois caractéristiques (cosmographie/technologies, activités/objectifs, ambitions/discours) sont intimement liées les unes aux autres et forment une séparation distinguant le « lointain » du « proche ». Une frontière stable au début du XXIe siècle, mais dont l’histoire a déjà provoqué des fluctuations26.
2. Histoire de l’espace lointain ou Histoire de l’exploration spatiale ?
Au-delà de la définition, la notion d’espace lointain pose la question de son emploi, notamment en Histoire de l’espace. Pourquoi l’utiliser comme cadre ? Faut-il faire une histoire de l’exploration ou une histoire de l’espace lointain pour les régions situées au-delà de la Lune ? Large, vaste et fourmillant de liens avec les autres pratiques de l’espace (dans l’espace proche, sur les aspects économiques, politiques…), l’histoire de l’exploration spatiale comme cadre d’étude a de grands avantages. L’exploration est en effet au centre de bien des leitmotivs qui ont pu justifier la présence de l’homme dans le cosmos. Son histoire est celle des premiers pas de l’homme dans l’espace27, de la conquête lunaire, des grandes expéditions dans le système solaire externe (Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2), mais aussi des forces politiques à l’œuvre, des réseaux et découvertes scientifiques, des technologies spatiales, des représentations… Son instruction permet donc une analyse englobante de ces activités, et contribue à faire de l’Histoire de l’espace un tout complexe mais solidement interconnecté. Dans les faits, le domaine de l’espace lointain est au cœur des préoccupations de l’histoire de l’exploration spatiale.
Les États-Unis profitent d’un grand nombre de publications concernant cette histoire de l’exploration spatiale, favorisée notamment par les travaux d’historiens comme Roger Launius, Howard McCurdy, ou encore Asif Siddiqi (pour les plus connus d’entre eux). Depuis les années 2000, ceux-ci se sont d’ailleurs livrés à des études historiographiques poussées sur l’histoire de l’espace en général, et sur celle de l’exploration en particulier. « The historical dimension of space exploration : reflections and possibilities28 » de Roger Launius ou les écrits plus récents d’Asif Siddiqi sur une histoire globale de l’exploration spatiale29, sont quelques références incontournables sur la question. Dans cette perspective historiographique, ces historiens décrivent tant les évolutions du corpus littéraire américain, que le tournant positif pris avec la New Aerospace History : une « nouvelle histoire de l’espace » qui privilégie une pratique disciplinaire renouvelée, plus audacieuse, moins axée sur la technique, et dont l’un des objectifs centraux est de privilégier des angles de recherche originaux et transversaux, passant entre les catégories de la grande histoire de l’espace.
Specifically, the New Aerospace History is intrinsically committed to relating the subject to larger issues of society, politics, and culture, taking a more sophisticated view of the science, technology, and individual projects than historians previously held. In the past, many writers on aerospace history held a fascination with the machinery, which has been largely anthropomorphized and often seen as ‘magical’30.
Aux côtés de cette histoire de l’exploration, sur quelle base pourrait exister une histoire de l’espace lointain, et quelle serait son utilité ?
2.1 Une histoire de l’espace lointain
La notion permet en premier lieu d’établir une séparation entre les différents lieux d’action dans l’espace. Il ne s’agit plus de se placer dans le contexte d’une dynamique et d’une chronologie, celle de l’exploration, qui regroupe proche et lointain, mais de concentrer son étude sur un milieu spécifique. En cela, l’utilisation d’un cadre plus géographique est susceptible d’ouvrir des pistes de travail et des problématiques différentes. Prendre le cadre du lointain, c’est aussi chercher à en connaître les spécificités et les singularités. Existe-t-il une technologie, une pratique spatiale ou un discours spécifique ? Ses appréciations politiques, sociales, morales et culturelles sont-elles en rupture avec celles qui prévalent pour l’espace proche ? Mobiliser l’espace lointain, c’est également mettre en lumière des activités que les enjeux de l’espace proche tendent à camoufler.
De même, le vocable « exploration » peut apparaître comme quelque peu limitatif, et pose la question d’une histoire de l’espace que l’on traduit le plus souvent par « histoire des activités humaines depuis les débuts de l’âge spatial jusqu’à aujourd’hui ». Un bornage pertinent, mais qui pousse à cultiver l’étude de l’espace lointain dans le cadre purement contemporain du second XXe siècle et du XXIe siècle. Recourir à un milieu plus qu’à une succession de réalisations in situ serait un atout dans le décloisonnement d’une histoire de l’espace limitée le plus souvent au contemporain. Une autre histoire de l’espace lointain permettrait d’assimiler les périodes plus anciennes et d’étudier le phénomène spatial récent sur un temps plus long, c’est-à-dire hors du cadre strict des pratiques exploratoires.
De plus, et même si l’argument peut être discutable, se ranger à une dynamique plus qu’à un milieu, fait courir le risque d’une double appropriation. En premier lieu, l’appropriation de l’histoire de l’espace par une histoire nationale. Le risque existe ici d’introduire une trop forte distorsion entre nations exploratrices et nations non-exploratrices, subordonnant à un leadership et à un récit, d’autres pratiques liées à l’espace lointain, mais indirectement liées à son exploration. L’espace lointain risquerait alors de servir un discours unique (ou dominant) et son histoire s’assimilerait progressivement à un instrument de puissance. Faire l’histoire de l’exploration in situ après 1957, c’est principalement suivre l’histoire spatiale de l’Europe, des États-Unis et de l’URSS, et passer le lointain par le seul prisme de leurs réalisations.
D’autre part, ce serait encourager l’appropriation de l’espace par la communauté spatiale. L’espace lointain ne serait alors qu’exploration, parce qu’il n’est vécu et distribué que par des professionnels. Certes, l’exploration est un fait d’envergure dont l’étude reste inévitable. Pourtant, sa réalité ne doit pas obérer les autres formes de lien que les civilisations ont pu et peuvent aujourd’hui encore entretenir avec l’espace proche et lointain. Les découvertes ou les pratiques spatiales en partie léguées par l’exploration sont ainsi souvent reconstruites et réappropriées par les désirs culturels, communautaires, religieux, fantasmagoriques qu’entretiennent sociétés et individus.
L’histoire de Mars par l’homme est certes profondément liée aux étapes de son étude astronomique, puis in situ. Pourtant, Mars est également pourvoyeuse d’autres objets ou évènements qui dépassent le cadre exploratoire. De même, la perception du phénomène extraterrestre en appelle souvent à cet espace lointain, dont la difficulté d’accès renforce le mystère, sans s’attacher au seul thème de l’exploration. La prise en compte des « risques cosmiques » participe également à ce mouvement. Même s’il s’agit d’identifier les dangers que l’espace fait peser sur le développement de l’humanité (astéroïdes, comètes, risques climatiques, agricoles et technologiques liés à l’activité solaire), les mesures mises en place par quelques agences spatiales manifestent un certain glissement d’un espace lointain exploré à un espace lointain devenu utile, indirectement.
Le monde des jeux vidéo présente lui aussi un exemple d’actualité intéressant31 : certains jeux en ligne massivement multi-joueurs (MMORPG32) comme EVE Online, baignent bien sûr dans les bénéfices de l’exploration spatiale. Pourtant, ils produisent également leurs propres dynamiques et peuvent rapidement constituer leurs propres récits. Dans ce cas, l’espace hérité est reconstruit, puis mis en fiction par une communauté de joueurs plus ou moins actifs qui proposeront leurs propres systèmes virtuels d’organisations politiques, diplomatiques ou encore économiques33. En conséquence, ces regroupements ludiques deviennent un fait social aux ramifications économiques diverses : ces lieux de sociabilité produisent du chiffre par l’achat de support (le jeu lui-même) ou par l’adhésion des joueurs au modèle économique34 proposé par le jeu, par exemple le Free-to-Play. Le territoire parcouru est donc celui d’un espace lointain réapproprié et transformé, non pas tourné vers l’exploration (bien que la découverte des différentes cartes proposées par les développeurs soit un passage obligé pour chaque joueur) mais vers l’exploitation et l’occupation virtuelles.
Enfin, la communauté scientifique sait aussi questionner les conditions d’une occupation et d’une exploitation économique durable de l’espace lointain, sous un angle bien entendu prospectif. En 1977, le physicien Gérard O’Neill présente ce qu’il pense être une solution viable pour l’expansion de l’humanité dans l’espace35. Il ne s’agit pas ici de donner à quelques élus dévoués ou richissimes l’opportunité de partir. Il est question d’entraîner le destin de l’espèce pour parvenir à l’émergence d’une civilisation spatiale. Ces intentions existent aussi pour les territoires situés au-delà de la Lune, même si les défis s’avèrent plus grands, les technologies plus audacieuses et les enjeux plus philosophiques encore. Ce travail de recherche, mais aussi de vulgarisation a aujourd’hui atteint une taille considérable, sans pour autant que les projets proposés aient fait l’objet d’une quelconque tentative de concrétisation. Comme résultats scientifiques, outils de communication ou projets fédérateurs, producteurs de lien et d’interactions, agrégateurs de laboratoires et de budgets, ces projets ou études sont une succession d’objets d’histoire, coupés partiellement ou en totalité de la notion d’exploration.
2.2 Des limites pour la notion
Si la notion d’espace lointain n’est pas sans pertinence, elle n’en comporte pas moins des limites et des risques. Tout d’abord, le risque de confusion. L’histoire de l’espace est une discipline en construction, où la tradition d’un espace lointain vu par le prisme de l’exploration est déjà bien installée. Un autre cadre d’analyse pourrait donc apparaître comme plus cosmétique que réellement utile. D’autre part, la notion prendrait le risque de brouiller le consensus chronologique en vigueur, en exigeant selon les sujets de dépasser le seul âge spatial36 : à quelle date faire remonter l’histoire de l’espace lointain ? Faut-il s’inscrire dans un âge spatial étendu au grand XXe siècle ? Ou doit-on au contraire remonter plus loin encore, au risque de perdre de vue les objectifs de l’histoire de l’espace telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ?
D’autre part, discerner ce qui correspond aux opérations menées vers l’espace lointain, du reste de l’espace, peut s’avérer difficile dans certaines situations : c’est le cas du vol habité, où les missions relèvent souvent de l’exploration en général, mais dont les intentions et les résultats sont partiellement liés à de plus grandes ambitions. Que penser des recherches menées à bord de la navette spatiale ou sur l’ISS pour mieux comprendre les comportements biologiques et psychologiques en milieu spatial et les adapter aux futurs de l’exploration37 ? Bien que l’espace lointain soit lié à l’exploration, il ne peut s’affranchir totalement de l’espace proche et des activités qui y sont conduites. Quant aux réappropriations de l’espace lointain par les sociétés ou les individus, si les phénomènes précédemment cités existent et peuvent se faire massifs (500.000 joueurs pour EVE Online en 201338), ils sont cependant, pour le moment, marginaux. La production prospectiviste elle-même est loin d’atteindre le niveau d’une recherche plus classique, en nombre de publications. Certes, le développement des ambitions spatiales pourrait permettre un changement de paradigme et tendre de l’exploration vers une certaine forme d’occupation et d’exploitation pour le lointain, encourageant à plus de recherches et à une plus grande pénétration sociale et culturelle. Hautement hypothétique, ce changement gênerait la définition initiale de l’espace lointain et la rendrait partiellement inopérante.
D’autre part, la définition donnée à l’espace lointain dans cet essai est celle d’une époque, qui correspond à un contexte, à des technologies, à des pratiques et à une sensibilité à l’espace. Ce qui apparait comme lointain aujourd’hui, par une accessibilité réduite et des objectifs peu stratégiques, pourrait devenir proche pour une société aux ambitions et aux perceptions différentes, même à technologie égale. Face aux renoncements progressifs qui ont marqué le vol habité au long cours, il est aujourd’hui possible de parler d’un rétrécissement de l’espace proche. Au contraire, les assauts de communication conduits par les agences spatiales et la banalisation de ces vastes espaces que visitent des sondes automatiques n’ont-ils pas déjà fait du système solaire une périphérie palpable pour la plupart des hommes ? Des populations peu sensibles aux sirènes de la colonisation spatiale, mais concernées par la moindre découverte, car connectées aux très nombreux réseaux d’informations…
Aussi, il est nécessaire de ne pas voir l’espace lointain comme une notion susceptible de remplacer celle de l’exploration. L’histoire des opérations conduites dans l’espace lunaire et au-delà (c’est-à-dire l’histoire de leur organisation, de leurs retombées et de leurs effets) est avant tout liée à cette pratique, avant d’être liée à un milieu. De même, l’histoire de l’espace lointain appartient à un ensemble beaucoup trop connecté au reste des activités spatiales pour faire l’objet d’un traitement autonome de l’espace proche. Et si l’espace lointain a ses spécificités, il convient de ne pas en user au profit d’un discours de conviction qui, sans témoigner d’une réalité concrète, porterait haut cette notion et exposerait avant tout un espoir : celui de constater que l’humanité a déjà accompli ses premiers pas sur le chemin d’un avenir spatial qui, sans aucun doute, la conduira à s’installer durablement bien au-delà des frontières de notre monde39. Le risque de subjectivité et de parti pris est donc fort, et recommande une grande prudence dans la mise en œuvre de cette notion.
2.3 Un risque à prendre ?
Enfin, un doute subsiste quant aux capacités à mobiliser l’espace lointain comme champ d’étude pour l’historien. En effet, l’une des particularités des programmes qui y sont conduits40 tient à leur chronologie. Nombreux sont les objets (atterrisseurs…), les sondes qui depuis la fin de leur mission, ont été réduits au rang d’artefact spatial. D’autres missions, comme Cassini-Huygens, ont au contraire profité d’une importante longévité, dépassant le cadre initial qui leur avait été fixé. L’un des records en la matière tient aux succès des sondes Voyager 1 et 2 qui, bien que lancées en 1977, sont toujours considérées comme partiellement opérationnelles et disposent encore d’un soutien et d’un suivi à la NASA. La chronologie de certains programmes, pris dans le dernier quart du XXe siècle, n’est donc pas systématiquement conclue et peut encore prétendre à ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Une question légitime peut alors se poser : un certain recul n’est-il pas nécessaire pour prendre la pleine mesure des interactions espace/société qu’une mission d’exploration, ancienne mais non achevée, peut créer ? Le caractère très contemporain de l’histoire de l’espace telle qu’elle est pratiquée ne présente-il pas le risque de susciter quelques soupçons quant au manque de distance entre l’historien et son objet d’étude41 ? A fortiori quand le sujet d’étude a pour réputation d’être un terrain favorable au militantisme de la cause spatiale ?
On peut également questionner la recherche sur l’espace lointain par l’angle de la crédibilité. Faut-il considérer, comme l’indique Kelvin F. Long pour les voyages interstellaires, qu’une partie de l’espace lointain et son cortège de sujets aventureux puissent être suspects d’un manque de sérieux, voire de rigueur scientifique ?
Unfortunately, there is also a negative side to conducting research in this field – one of credibility. Because many academics do not see interstellar travel as either near possible or relevant to today’s problems, it is considered as a ‘hobby’ and thus much research is done privately and on a volunteer basis. It is a sad fact that the majority of researchers working on interstellar propulsion are doing so as a spin-off from their main research interests, quietly tolerated by their colleagues42.
L’espace lointain in situ, en plus d’être distant, très scientifique, pauvre en activités et retombées humaines immédiatement perceptibles, serait presque coupable en fonction de ses activités. La crédibilité du chercheur, ou du jeune chercheur en sciences humaines, pourrait-elle être remise en question, lorsque celui-ci porte son intérêt sur l’astrobiologie, les SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), les PAN (Phénomènes Spatiaux Non-identifiés), les technologies hypothétiques (terraformation, hyperespace, téléportation…), ou encore l’histoire de la prospective spatiale, dont on ne trouve bien souvent un écho populaire que dans la science-fiction ou dans une presse qui cherche à faire sensation ? Si l’image que donne à ces sujets une partie du discours médiatique ne semble pas devoir aider, cela ne semble cependant pas porter à conséquence et n’interdit nullement le développement de recherches allant en ce sens.
Quant à l’accès aux sources, même s’il doit se heurter à des restrictions incompressibles (secret technologique…) en fonction de l’objet, il est de plus en plus facilité. La grande proximité des sujets en histoire de l’espace permet un rapport privilégié avec les sources orales, témoins ou acteurs qui ont fait l’espace étant pour beaucoup encore accessibles (scientifiques, ingénieurs, politiques, membres de la société civile). Les sources en général sont également très nombreuses, d’une grande variété, facilitent la démarche et encouragent à la transversalité. Enfin, les pratiques historiennes et d’archives de certaines agences spatiales, de musées, mais aussi des « spécialistes engagés de l’espace » que l’on retrouve de l’association au forum spécialisé (parfois très bien renseignés), sont un véritable atout, notamment à l’ère d’Internet.
Bien sûr, l’inflation des sources et la tendance naturelle des sociétés modernes à produire de l’information ne doivent pas noyer le chercheur sous le nombre, ou dévier son attention vers le trivial et l’insignifiant. Il est également nécessaire de bien saisir les enjeux et contextes liés à la production de la source, lorsque l’on interroge des sujets un peu plus exotiques (voyages interstellaires…), autant que lorsque l’on se penche sur des moments plus connus de l’histoire de l’espace. À ce sujet, Jean-Pierre Morin nous enseigne, dans La naissance d’Ariane, sur les risques d’un corpus de sources, rendu vivant et humain par le témoignage, mais qui doit être pris avec précaution : » On dira peut-être que cette vision est subjective. Mais pas plus que ne le sont nombre de documents d’archives sur lesquels se pencheront les historiens, qui ont été écrits, non pour traduire fidèlement une réalité, mais dans l’intention d’exercer une influence, une intention dont la trace est le plus souvent perdue43. »
3. Le traitement de l’espace lointain par la bibliographie spatiale
Faire un état de la recherche en histoire de l’espace n’est pas simple. Les écrits qui s’y intéressent sont nombreux et s’approprient des thématiques variées. Quant aux auteurs, ils sont au même titre que ceux qui alimentent la vaste bibliographie de l’espace, issus de plusieurs horizons, allant du scientifique, acteur ou non d’un programme, au journaliste scientifique, en passant par l’historien, l’archiviste ou l’ethnologue.
Faut-il considérer, dans cet immense réservoir, toutes les productions au même titre ? Une juste prudence nous impose de répondre à cela par la négative. Cette précaution est motivée en partie par les propos et les choix méthodologiques parfois mis en œuvre, qui tendent à confiner certaines productions à un discours justificateur ou à un témoignage amélioré. Si beaucoup de ces écrits se placent dans une perspective historique, peu font en effet l’objet d’un traitement historien, même si les travaux des historiens non-professionnels peuvent parfois se montrer d’une grande qualité, analytique, souvent documentaire. Un constat évident pour une bibliographie américaine solide et diversifiée44, mais cependant plus difficile pour une littérature spatiale française bien moins fournie. Pour l’étude de l’espace, il semble donc judicieux et prudent de se ranger, au moins en partie, à l’avis d’Asif Siddiqi : « In the paper, I do not distinguish between the often false dichotomy of academic versus popular works. Important contributions to space history have come from both ends of the spectrum, and both have had their strengths and weaknesses45. » Sans oublier les préventions de Roger Launius :
Then, of course, there are those mesmerized by the technology and write `nuts and bolts’ history without much attention to the wider questions that influenced the effort. Many of these are aerospace engineers, and most have no more business writing history than historians have in building spacecraft, and their work is too often pedantic, sophomoric, and unabashedly celebratory46.
L’histoire de l’espace lointain n’échappe pas à ces réflexions. Profondément liée à l’histoire de l’exploration, elle en est souvent une extension, à l’autonomie incertaine, mais sans qu’il soit impossible d’en pister la trace dans le vaste catalogue des publications ayant trait à l’espace. Les quelques paragraphes qui suivent n’entendent pas révolutionner les présentations historiographiques qui ont pu être faites de l’histoire de l’espace. Le but est ici d’en donner une lecture actualisée, américaine mais aussi française, qui puisse également correspondre aux objets spécifiques attachés la notion d’espace lointain47.
3.1 L’espace, en général
L’histoire de l’espace lointain est une composante de l’histoire de l’espace. Aussi n’est-il guère étonnant de la retrouver dans les écrits qui font l’histoire de l’espace en général, qu’ils soient ceux de vulgarisateurs, d’historiens vulgarisateurs ou professionnels. Atlas encyclopédiques48, beaux-livres de qualité49 et autres productions sur l’exploration de l’espace ou sur la conquête spatiale en France, comme aux États-Unis, forment donc une première famille.
Dans les écrits de vulgarisation comme La nouvelle conquête spatiale50 ou À la conquête de l’espace, De Spoutnik à l’homme sur Mars51, le traitement de l’exploration des régions lointaines est fait au même titre que celui des évènements actés dans l’espace proche. Force est de constater cependant que si une place importante est laissée à leurs pratiques, une certaine disproportion favorise l’histoire des activités humaines dans la banlieue terrestre. Dans cette littérature, l’espace lointain semble devoir se résumer principalement à quelques réalisations remarquables et projets avortés (pour l’épaisseur historique), ainsi qu’aux enjeux techno-industriels futurs de l’exploitation, surtout économiques, des astres les moins lointains (La Lune et quelques astéroïdes). Colonisant les dernières pages, c’est l’espoir d’un futur martien, interplanétaire, et peut-être interstellaire, pour l’humanité52 qui est abordé.
Les littératures plus académiques (généralistes ou non) prennent un parti quelque peu identique. Sans recourir aux mêmes démonstrations, elles tendent, à travers leurs sujets, à parler de l’espace en général, sans oublier de faire une place à l’histoire de l’exploration, et donc à celle de l’espace lointain. L’histoire des centres spatiaux, approvisionnés par les monographies du NASA History Program53, celle des agences ou des politiques spatiales, l’histoire des lanceurs ou des technologies, l’archéologie spatiale54, le lien espace-société55, l’espace comme phénomène culturel56 sont autant de lectures qui étayent ce choix.
Recensions bibliographiques, corpus de documents, manuels ou essais historiographiques forment un autre registre. La série des NASA Historical Data Book, donne par exemple depuis 197657 une vision d’ensemble détaillée de l’organisation, des finances, des personnels et des programmes ayant eu cours à l’agence spatiale américaine. Les sept volumes58 d’Exploring the Unknow : Selected Documents in the History of the U.S. Civil Space Program, édités par Roger Launius, produisent quant à eux un corpus varié de documents utiles pour comprendre le programme spatial américain. Les volumes cinq et six centrent notamment leurs choix sur l’exploration de l’espace59. Des chronologies annualisées existent également60, avec par exemple la série Astronautics and Aeronautics, A Chronology61 publiée pour les années allant de 1915 à 2010. On retrouve ce travail de chronologie côté français avec Chronologie aéronautique et spatiale62 où Claude Carlier croise les « évènements politiques et militaires » avec les « évènements aérospatiaux » en un long tableau qui court de 1939 à 2009. Seuls les sujets les plus précis, ou qui se lient aux usages terrestres, stratégiques, militaires, informationnels, peuvent faire plus facilement l’abstraction de cet espace lointain, sans pour autant que cela soit systématiquement le cas.
3.2 L’espace lointain in situ
Au-delà de cette première famille très large, ce sont les programmes d’exploration automatique in situ qui permettent la formation d’une deuxième grande catégorie de publications. On peut ici distinguer trois niveaux.
Le premier est celui d’une littérature d’inventaire qui liste l’ensemble des aspects techniques, scientifiques, parfois économiques des missions d’exploration. C’est le cas de Deep Space Chronicle : A Chronology of Deep Space and Planetary Probes (1958–2000)63, d’Assif Siddiqi, ou encore de L’histoire visuelle des sondes spatiales64 de Philippe Séguéla, où les programmes de sondes automatiques, leurs objectifs et leurs réalisations sont décrits, plus ou moins succinctement, dans une présentation encyclopédique et par ordre chronologique. Une référence s’impose particulièrement en la matière, avec les quatre volumes de Robotic Exploration of the Solar System65 coécrits par Paolo Ulivi et David Harland. Chaque tome dresse un panorama (plus de 2000 pages en tout) des missions d’exploration automatique du système solaire, mais sans encapsuler chaque programme dans quelques pages ou chapitres autonomes les uns des autres. Le propos est ici celui d’une narration riche de données (notamment techniques), et se partage entre description exhaustive des missions et des résultats. Malgré leur fonds parfois un peu aride ou démonstratif, de telles publications sont grandement utiles au travail de l’historien. Roger Launius le souligne d’ailleurs dans la préface de Deep Space Chronicle, qu’il conclut par les mots suivants : » a factual reference source that will prove useful to all who are interested in planetary exploration66. »
Le deuxième niveau que l’on peut identifier tient à une bibliographie plus spécifique aux programmes d’exploration in situ pris dans leur singularité. L’espace lointain appelant à de rares et, généralement, très longues expéditions, peu nombreuses sont ces campagnes. Pourtant, les écrits sur une mission ou une planète peuvent se faire abondants (toutes proportions gardées). Le programme Cassini-Huygens en est un bon exemple. Passé les références regroupant des publications en planétologie ou en climatologie67 et les quelques beaux-livres sur Saturne68 ou Titan69, apparaît une littérature très spécialisée70. Le plus souvent, ses auteurs sont eux-mêmes issus du milieu spatial (administrateurs ou scientifiques, ingénieurs) et ont pu participer de près ou de loin à la conduite de la mission. Ils en livrent une lecture riche, pleine de détails, enthousiaste, mais qui se fait fréquemment narrative, programmatique71, et ne privilégie pas nécessairement des angles d’étude originaux. Des références comme Titan Unveiled72 ou Cassini at Saturn, Huygens Results73, font ainsi une description du milieu, une histoire technique et institutionnelle du programme et un compte rendu des résultats. Leur grille de lecture dépasse d’ailleurs généralement la seule mission Cassini-Huygens pour englober les observations et expéditions précédentes (Voyager 1 et 2 notamment). The Titan of Saturn74, de Bram Groen et Charles Hampoen-Turner, compte parmi les rares écrits à ne pas verser dans une chronologie pure de la mission (présentation du milieu, programmatique, construction de la sonde, lancement, arrivée et étude de l’objectif), en privilégiant l’angle des dynamiques politiques et organisationnelles du programme.
Le traitement de Mars est somme toute similaire, à ceci près qu’il apporte un peu plus de variété75. Les raisons sont probablement à chercher dans une planète qui, au-delà de l’objectif privilégié qu’elle représente pour les agences spatiales, a pu et peut encore profiter d’une charge historique, voire émotive et culturelle forte. Encore une fois, on trouve aux côtés des écrits consacrés aux dimensions physiques et astronomiques de Mars76, une part réservée à la description narrative et technique des programmes d’exploration martiens : dans un autre cas77, on a fait par exemple le choix de décrire ce que furent les espoirs et tentatives soviétiques en laissant une place importante à une histoire des technologies passant par la description. Parfois autobiographique78, l’histoire de Mars par l’Homme propose assez souvent, par l’implicite, un récit aux échos hagiographiques.
Des études plus poussées de la question martienne forment, entre autres, le troisième niveau de publications de cette deuxième grande famille : celui qui ne s’intéresse pas seulement aux aspects techniques et organisationnels, mais choisit de croiser les histoires politiques, techniques, scientifiques et parfois culturelles79. David Portree, se place en partie dans cette perspective en livrant en moins d’une centaine de pages une monographie détaillant cinquante ans de planification martienne entre 1950 et 2000. Thor Hogan offre quant à lui une introduction sur les ambitions américaines pour Mars, et décrit par le détail le développement et les errements politiques de la Space Exploration Initiative. Enfin, Henry Lambwright met en perspective les forces à l’œuvre dans la politique martienne des États-Unis.
Certaines de ces références ne se limitent pas seulement à un programme ou un aspect de l’exploration spatiale en particulier. Elles peuvent également se faire plus générales, ou concerner une section plus réduite, mais toujours transversale, de l’exploration spatiale80.
3.3 Prospective ou prescription ?
L’une des caractéristiques de l’espace lointain est, nous l’avons dit, qu’il ne se limite pas à la seule dimension « exploration ». Le lointain n’est pas seulement une réalisation, il est également une culture, un discours et un espoir que certains se sont attelés à réaliser. Une dernière catégorie peut donc être dressée pour étudier la littérature spatiale : celle de la prospective.
L’aspect prospectif est consubstantiel aux activités spatiales en général. Les sociétés en ont besoin pour étendre leur emprise sur l’espace et, en retour, l’occupation du milieu spatial les encourage à une émulation scientifique permanente et toujours plus avancée. Pour l’espace lointain, cette pratique s’avère particulièrement forte, sans nécessairement passer par les mêmes enjeux que ceux qui valent pour l’espace proche : alors que pour ce dernier la prospective s’intéresse à l’occupation et à l’exploitation économique d’un système-Terre, celle de l’espace lointain se tourne plus volontiers vers l’exploration et la dissémination future de la civilisation et de l’espèce humaines.
Les écrits qui constituent cette troisième grande famille correspondent donc aux travaux et études sur les possibles développements de l’aventure spatiale. Il peut s’agir de versions « grand public », comme d’articles de spécialistes dont la destination est celle d’une très restreinte communauté de pairs. Comme pour les deux premières familles déjà cités, cette littérature de la prospective se répartit selon plusieurs niveaux. Nous en distinguerons trois.
Un premier regroupe les écrits de pure prospective : y sont exposées les recherches qui étudient très sérieusement les faisabilités technologiques, mais également sociales, économiques et stratégiques, de l’exploration et de l’occupation du lointain. On y retrouve souvent ce que sont les objectifs principaux pour l’homme dans le système solaire : la Lune81, Mars82 et les astéroïdes qui semblent prometteurs autant que raisonnablement accessibles83. Il ne s’agit pas seulement de convaincre qu’une solution technique est à la portée des puissances spatiales ou d’agiter les cordes d’une sensibilité cosmique. Il s’agit de décrire et d’écrire des scénarios objectifs, théoriquement viables sur les plans techniques et économiques84, et d’envisager avec méthode le futur lointain de l’humanité dans l’espace85.
Le second niveau passe, lui, par la rétrospective. Sans se montrer d’une neutralité absolue, faisant même parfois des recommandations aux éléments de recherche qu’elles étudient, ces références s’essaient à une histoire de la prospective spatiale86. Les projets hypothétiques pour l’espace interstellaire87 peuvent par exemple aligner une abondante série de publications qui, si elles présentent les travaux les plus récents, se réfèrent presque toujours aux projets passés, comme si leur héritage était un passage obligé pour justifier l’originalité de recherches plus contemporaines. D’autre part, l’angle choisi pour aborder la question interstellaire tiens souvent à des préoccupations liées aux domaines des technologies spatiales nouvelles88 et plus précisément à la propulsion89. Sans être totalement absentes, les motivations, la réception et l’impact de ces projets ne viennent souvent qu’en appui à un discours chronologique et très technique.
Enfin, un dernier niveau se retrouve dans l’aspect profondément prescriptif que proposent certaines références90. Dans leur majorité, les auteurs qui écrivent sur la prospective semblent avoir le plus grand mal à cacher leur espoir d’un avenir céleste pour l’humanité. Certains vont au-delà et font de leurs livres et articles de véritables tribunes pour un nouvel âge spatial. Ouvertes sur un très large public, leurs publications sont très attachées à la notion de « civilisation spatiale ». On compte dans leurs rangs des noms connus de la grande communauté spatiale, comme l’ingénieur Robert Zubrin91 ou l’astronome Carl Sagan92.
The plan of the book is roughly this: We first examine the widespread claims made over all of human history that our world and our species are unique, and even central to working and purpose of the Cosmos. We venture through the Solar System in the footsteps of the latest voyages of exploration and discovery, and then assess the reasons commonly offered for sending humans into space. In the last and most speculative part of the book, I trace how I imagine that our long-term future in space will work itself out93.
Ces références ouvrent sur un avenir radieux, qui semble ne pas vouloir se confronter aux aspects les plus complexes, surtout sociétaux, des sujets qu’elles abordent. Et si leur futur de l’humanité dans l’espace n’est certes pas présenté comme sans obstacle, le propos n’en confine pas moins, dans bien des cas, à une étonnante naïveté.
L’ambiance sociétale, politique et sécuritaire que propose Gérard O’Neill dans ses colonies spatiales est à l’image de cette propension à l’ingénuité. S’il prévient qu’« en ce qui concerne la guerre, nous devons nous en tenir aux hypothèses » et qu’il « hésite à prétendre que la colonisation de l’espace pourra résoudre l’un ces plus vieux et des plus angoissants problèmes de l’humanité : la souffrance et la destruction provoquées par les guerres de conquêtes94 », Gérard O’Neill finit par expliquer qu’en raison des spécificités du milieu spatial et de la disparition de l’énergie nucléaire95 au profit de l’énergie solaire, « de toute évidence les conditions des communautés de l’espace tendront à restreindre les attaques menées pour s’emparer d’un territoire étranger. […] Du point de vue stratégique, les habitats de l’espace n’offriront guère d’intérêt comme bases stratégiques96 ». En somme, le futur de l’humanité dans l’espace ne saurait passer par d’autres cadres que celui de la paix.
Plus généralement, les arguments et explications mobilisés par les ouvrages de cette dimension prospective font souvent peu de cas des exigences académiques de la discipline historienne. Même lorsqu’elle est abordée par la vulgarisation dans un objectif didactique, elle peut rapidement dépasser la seule narration pour sublimer son récit par l’émerveillement et l’espoir. À moins qu’ils aient fait l’objet d’un traitement méthodique, le propos et les choix opérés par la majorité des auteurs de cette troisième grande famille doivent être avant tout être perçus comme des objets d’étude potentiels pour l’historien bien plus que comme un premier support sur lequel une étude historique pourrait fermement s’appuyer97.
3.4 Quelques remarques sur la bibliographie de l’espace lointain
Quelques remarques s’imposent à la lecture de cette courte bibliographie. Tout d’abord, la supériorité numérique des publications en langue anglaise est évidente tant en termes de vulgarisation que de production historienne. Elle est en cela aidée par l’institutionnalisation de la recherche en histoire de l’espace engagée notamment aux États-Unis par des organismes publics comme la NASA ou encore la Smithsonian Institution98. La recherche en histoire de l’espace profite également de plusieurs relais pour sa promotion et sa diffusion avec des revues spécialisées de haut niveau comme Space Policy, ou concernées par l’histoire des sciences et des techniques comme Technology and Culture99. D’autres, comme les Acta Astronautica ou le Journal of British Interplanetary Society, participent également à la vitalité de ce champ de recherche mais en privilégiant cette fois un mélange disciplinaire nettement en faveur des sciences dures100.
De tels supports sont loin d’être inexistants en langue française mais leur traitement de l’espace se fait plus rare101. Le plus souvent, il se retrouve confié à des dossiers de recherche spécifiques ou mis en lumière par des articles individuels102. La structure des marchés du livre « grand public » et universitaire, l’héritage spatial américain expliquent en grande partie cette suprématie anglophone. Quant à la langue anglaise, sa suprématie mondiale dans le domaine académique tend à automatiser son emploi. Sans nier la vitalité des bibliographies russe ou française, force est de constater que leurs usages linguistiques déterminent une visibilité moindre auprès des publics avertis comme universitaires.
Une seconde remarque peut être faite concernant la structure même de ces publications. Une partie non négligeable des ouvrages cités, notamment ceux édités par la NASA, sont le fait de collectifs d’auteurs. Ils permettent en cela, pour partie, un croisement des points de vue et une écriture de l’histoire de l’espace plus transversale et ouverte sur les enjeux développés par la New Aerospace History. D’autre part, comme pour l’histoire de l’espace en général, si les recherches sur l’espace lointain se professionnalisent et tendent à se faire plus originales, livres et articles obéissent à une grille de lecture souvent dirigée par l’histoire de l’espace américaine. Quant à leur écriture, elle semble inéluctablement liée à la culture de l’imaginaire. S’ils ne s’essaient pas à concurrencer le genre, nombre des chercheurs de l’espace lointain mobilisent la science-fiction pour enrichir les démonstrations proposées.
Le nombre de sujets possibles, la qualité des sources et l’ampleur de la bibliographie spatiale défendent l’idée qu’une histoire de l’espace par la notion d’espace lointain est possible. Plus que possible, celle-ci est même nécessaire pour agrandir le champ de recherche de l’histoire de l’espace. En dépassant le seul contexte de l’exploration, le regard porté sur cette région de l’espace, son occupation ponctuelle et ses perceptions, peut se faire différent : au risque de se créer de toutes pièces, mais avec l’avantage de continuer à questionner notre rapport au domaine spatial dans son ensemble.