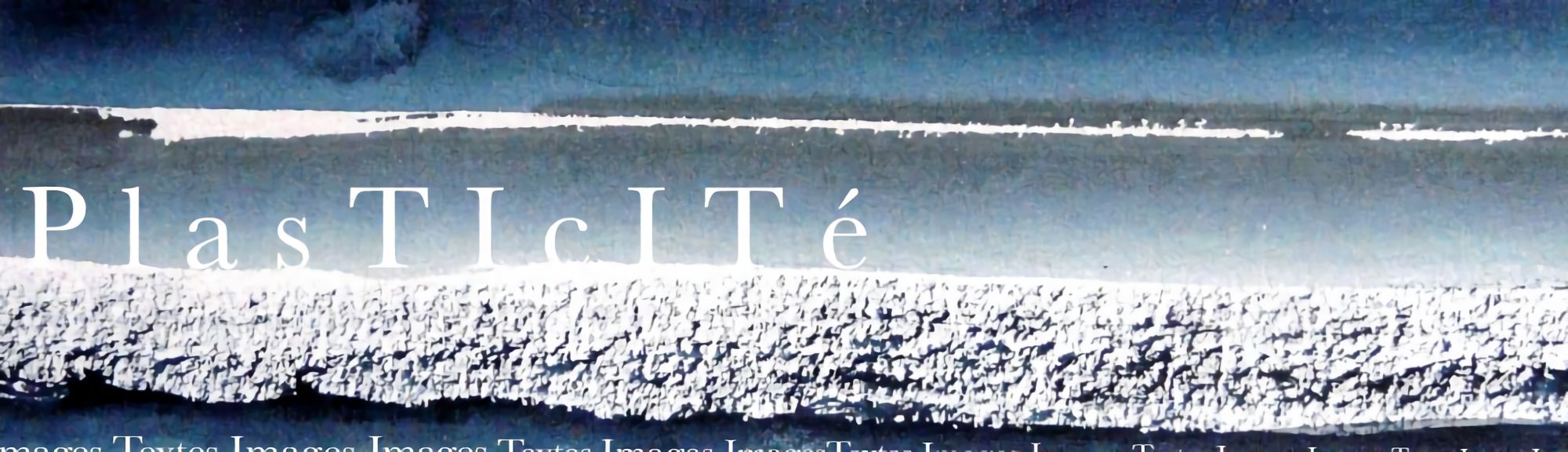« Observer et imaginer » : ces deux verbes qui reviennent dans Nymphéas noirs de Michel Bussi sont un appel au regard et à l’interprétation du lecteur. L’histoire de ce roman paru en 2011 et qui reçut de nombreux prix est complexe et se joue des attentes d’un lecteur qui devine un éventail de possibles à partir d’énigmes. Au centre de l’intrigue, le village de Giverny, l’ombre de Monet, sa maison, les touristes, les peintres amateurs, des tableaux bien sûr mais aussi des cadavres, car la trame du roman est policière.
En 2019, en paraît la réécriture graphique, réalisée par Fred Duval et Didier Cassegrain – une réécriture en bande dessinée de ce roman si pictural, réputé pourtant inadaptable en images1. Fred Duval construit le scénario, Didier Cassegrain s’occupe des dessins : l’album paraît dans la collection « Aire libre » des éditions Dupuis. Nymphéas noirs prend dès lors un autre relief : le contraste entre roman noir et impressionnisme devient visuel comme le signale d’emblée la couverture2.
Cet article a pour objectif d’explorer ce tissage intermédial qui, à partir d’une réécriture graphique d’un roman, procède de la peinture impressionniste, de la bande dessinée, de la photographie, sur fond de roman à énigmes et d’enquête policière : nous verrons comment la bande dessinée parvient à créer un univers singulier propice à l’immersion3.
Cette exploration intermédiale se développera en trois étapes, à la manière d’un jeu de pistes : dans un premier temps, nous ferons la lumière sur le tissage impressionniste comme toile de fond de l’intrigue, avant d’envisager ensuite les paramètres du récit en images d’une histoire complexe. Enfin, nous nous interrogerons sur la pertinence des choix graphiques afin de stimuler l’imagination des lecteurs puisque l’objectif est bien de montrer sans révéler.
L’impressionnisme en majesté : tableaux en embuscade
Si l’univers pictural s’invite dès le début du roman, le passage à l’image opéré par la bande dessinée modifie profondément la réception graphique : ce que les mots suggéraient s’impose par les couleurs dès la première vignette.
Un roman atypique à la croisée des genres
Dans l’avant-propos du roman, Michel Bussi précise que la part du réel concerne les lieux et les événements en relation avec Claude Monet, ainsi que les vols d’œuvre d’art, avant de conclure : « Tout le reste, je l’ai imaginé » ; cela ouvre des perspectives considérables pour une fiction qui s’appuie très étroitement sur cet univers graphique.
Pour l’écrivain, Nymphéas noirs n’est pas uniquement un roman policier, il suggère qu’il s’adresse à un lectorat très étendu : ceux qui aiment l’art ou les romans d’amour, avec du suspense et une surprise à la fin. Le roman est par ailleurs selon lui un excellent exemple de ce qu’il souhaite construire en termes d’écriture et de public4. Cette diversité de la fiction va se retrouver dans la réécriture graphique.
Michel Bussi signe l’album avec Didier Cassegrain et Fred Duval et il souligne l’étroite collaboration des trois signataires pour réaliser la bande dessinée :
« Le dessin de Didier Cassegrain est absolument superbe et restitue avec finesse l’atmosphère impressionniste du roman… Quant au scénario, le livre était réputé inadaptable en image, or la BD prouve le contraire ! […] Fred et moi avons vraiment travaillé main dans la main, avec de fréquents allers-retours. Je validais tout, mais son travail me semblait presque toujours déjà parfait. On s’est beaucoup amusés à jouer sur le cadrage, le passage d’une case à l’autre… Tout en respectant, bien sûr, le texte initial5. »
L’écrivain s’est félicité du résultat final, en soulignant la parenté du roman avec le cinéma et la peinture, confirmant la croisée des genres présente dès l’écriture :
« La bande dessinée était le média parfait pour adapter ce roman très visuel, conçu comme un scénario. […] Les auteurs ont su allier mystère et dimension poétique. Nymphéas noirs est un polar qui se passe à Giverny, lié à l'univers de la peinture. Un polar impressionniste où les gens peignent, se promènent dans la nature, visitent les musées, regardent le ciel. Un récit contemplatif, avec en outre une histoire d'amour6. »
L’Impressionnisme, lumineuse toile de fond
Si le roman se montre inventif en précisions visuelles pour intégrer les lieux dans l’histoire, dans la bande dessinée l’entrée dans un univers se révèle immédiate : dès la couverture (illustration n°1), la palette graphique impressionniste tire l’album vers la peinture avec, en valeur ajoutée, une traînée sanglante atypique qui interpelle le futur lecteur.
Il existe une deuxième couverture, celle en double page de l’édition limitée (777 exemplaires) qui présente l’héroïne à vélo, une fillette de dos et une femme âgée assise sur un banc : l’effet produit sur le lecteur gagne en subtilité dans la mesure où l’adjectif qualifiant les nymphéas du titre – noirs – ne trouve pas d’emblée une interprétation. Le réseau des Libraires Ensemble a bénéficié par ailleurs d’une jaquette originale présentant les trois figures féminines dans une double page. Enfin, l’édition en tirage limité de novembre 2019 ne montre que des nymphéas de couleurs. Ces quatre couvertures sont autant d’interprétations qui renvoient chacune à des pièces du puzzle sans en dévoiler l’image globale : le suspense reste intact.
Le défi du dessinateur Didier Cassegrain7 était de s’inspirer des toiles de Monet sans pour autant copier l’impressionnisme : faire reconnaître l’aspect visuel des personnages et du village de Giverny, et semer des indices pour créer l’univers d’une véritable enquête, objectif partagé avec le scénariste Fred Duval8. Il souligne dans les propos qui suivent le soin apporté à la fois à la composition, à la lumière, aux couleurs, à la place des personnages dans la vignette qui met en scène une rencontre déterminante entre Stéphanie et Laurenc, l’inspecteur qui mène l’enquête (illustration n°2) avec, comme contrainte supplémentaire, la fidélité à un décor naturel – la maison de Monet :
« C'est une planche contemplative avec un accent mis sur le décor. J'ai dessiné la maison en contre-plongée pour lui donner de l'importance ainsi qu'à l'héroïne qui surplombe l'inspecteur qui arrive dans l'ombre : le lecteur doit, comme lui, s'en prendre plein les yeux devant cette façade pleine de lumière et de couleurs. […] La composition de la case doit être la plus simple possible, pour ne pas éloigner le lecteur de l'essentiel : ici l'héroïne est celle qui doit être au centre de toutes les attentions. Tout le reste doit demeurer dans l'ombre. Il faut que ce soit clair et net. Seul le sol s'éclaire peu à peu pour marquer le passage de l'ombre à la clarté. Cette mise en lumière est accentuée par les fleurs situées en avant-plan. Elles soulignent ainsi la profondeur et le contraste entre ce qui est proche du lecteur et ce qui va être illuminé au loin. Il m'est impossible d'attaquer les couleurs sans penser en amont à la lumière, une fois que je sais où elle se situe, je pense taches de couleurs chaudes comme le jaune ou le rouge de la maison. Ensuite, je reviens à une peinture qui cherche davantage à exalter les matières, telles les fleurs, le mur, les gravillons au sol... Une fois la peinture posée je l'accentue au trait noir pour bien délimiter le cerné propre à la bande dessinée9.»
Les deux premières pages de la bande dessinée respectent avec minutie le texte au mot près tandis que le dessin ajoute une multitude d’informations complémentaires, notamment par l’omniprésence des couleurs et motifs liés au style impressionniste. Dans le roman, l’impressionnisme se devine dans l’énoncé implicite d’une phrase : « Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny » (p. 5). La palette des couleurs, les motifs, les délicats fondus (p. 9-10) constituent une toile de fond sur laquelle se détachent les personnages, participant à un effet de tableau animé.
L’impressionnisme comme courant pictural y occupe une place de choix, en priorité lorsqu’il est question de la maison de Monet, rose aux volets verts (p. 67-69), dont la chambre, la cuisine, la salle à manger s’invitent dans la bande dessinée. Au détour d’une vignette, un tableau accroché au mur souligne la continuité de motif entre la robe d’un personnage du tableau et celle de Stéphanie tout en rappelant l’influence du Japonisme sur les Impressionnistes (p. 68/2). Des tableaux existant se trouvent aussi représentés comme le tondo de Monet au musée de Vernon (p. 108/6), Impression, soleil levant (p. 36/5)… L’histoire du peintre Eugène Murer est contée, accompagnée d’un passage en nuances de gris pour montrer à la fois l’antériorité de cette histoire racontée à partir d’un tableau et la tristesse de la trahison (p. 51-53). Un point de vue souligne dans une planche la mise en abîme des perspectives : Fanette peint un tableau à la manière de Monet dans une vignette qui fait de même… (p. 56/1). Le dessinateur se permet même un clin d’œil pictural : la planche de la page 83 reprend le style de Van Gogh par les couleurs et la touche, avec un effet saisissant par le choix du cadrage. Le lecteur apprendra plus tard que le responsable de la mort du peintre se nomme Vincent : le dessinateur dépose incidemment un indice graphique inédit, le peintre James ressemble par ailleurs beaucoup à Monet (p. 38, 39, 66) dont le buste apparaît au début du récit (p. 14/2). Enfin, les surnoms donnés par l’héroïne Fanette à ses amis confirment l’allusion à cet univers pictural (p. 130/7) : Camille (Pissaro ou Corot), Paul (Cézanne), Vincent (Van Gogh), Mary (Cassat10).
Nymphéas noirs est un roman qui fait preuve d’érudition sur l’impressionnisme et cette précision est finement exploitée graphiquement : le courant pictural accompagne le lecteur à chaque page, entre ombre et lumière car certaines planches apparaissent très sombres. Le travail graphique se révèle minutieux comme une enquête policière, précision déterminante car nombre de vignettes comportent des indices.
Une intermédialité construite par l’univers graphique
Si l’impressionnisme est très présent, des références à d’autres courants picturaux se retrouvent également dans les planches ; et la diversité des traitements graphiques favorise en outre l’immersion dans un univers.
Le Rouen de la fin du XIXe siècle apparaît ainsi en noir et blanc, toile de fond qui met en valeur une incrustation de la couleur pour le XXe siècle (illustration n°3) : les deux périodes se trouvent ainsi rassemblées graphiquement. La variété des médiums représentés souligne le choix de l’intermédialité pour rendre compte d’une temporalité qui passe par l’image et non par le récitatif : la reproduction d’une « Une » à la manière du Parisien (p. 55/3) ou de France soir (p. 136/1) plonge le lecteur dans une antériorité, tout comme la reproduction de la pochette du disque de Françoise Hardy Le temps de l’amour est à la fois une signature sonore, un repère temporel (les années 60) et un signe visuel de la mélancolie de Stéphanie par les similitudes entre les deux portraits (p. 131/4-5). L’immersion dans les différentes strates temporelles qui structurent le récit est également favorisée par les photographies – certaines en noir et blanc – (p. 32-33, 43), le site internet « Copains d’avant » (p. 54/2), des images d’archives, des inscriptions manuscrites… Le détail est souvent minutieux : la reproduction de la couverture de l’édition de poche de 1963 du livre Aurélien d’Aragon dont est extraite une phrase-indice (« Le crime de rêver je consens qu’on l’instaure ») opère comme un clin d’œil textuel (p. 27/7-8).
Ainsi, la version graphique procède à la mise en place d’un univers à partir d’un scénario appuyé sur un roman : la toile de fond impressionniste accueille une inscription immersive dans des époques variées par la diversité des médias présents. Cette bande dessinée multiforme et intermédiale se révèle pleine de ressources et de finesse.
Raconter en images une histoire complexe : l’art de l’ellipse
Une fois cette immersion impressionniste posée comme décor, il reste à structurer une intrigue spatio-temporelle complexe.
Le temps, quatrième dimension narrative
L’histoire de Nymphéas noirs se déroule sur treize jours, précision donnée dès l’incipit. Le texte passe cependant sous silence le fait que ces journées abritent chacune plusieurs strates temporelles à partir d’un lieu unique, Giverny, figé dans ses murs – l’école, les jardins et la maison de Monet, le moulin : l’histoire se déploie sur trois niveaux temporels, correspondant aux trois silhouettes présentées à la page 5 (illustration n°4)11.
En effet, trois époques alternent dans un récit qui semble linéaire. La planche de la page 139 (vignettes 3 à 5) montre cette superposition à partir de trois années déterminantes : en 1937, Fanette a 11 ans, elle est entourée d’amis qui portent des surnoms de peintres : Paul, Camille, Mary et Vincent, James aussi, le peintre américain qui l’encourage pour le concours Robinson et qui sera assassiné. Paul, surnom impressionniste12 d’Albert Rosalba, meurt également cette année-là. En 1963, Stéphanie Dupain a 37 ans, elle s’est mariée avec Vincent (surnom de Jacques Dupain) à son retour à Giverny après ses études, elle est institutrice dans l’école où elle était écolière à 11 ans et elle a renoncé à peindre suite à la mort de Paul/Albert. Elle rencontre l’inspecteur Laurenc Serenac lorsque le corps de Jérôme Morval est retrouvé dans la rivière. Jérôme Morval avait pour surnom Camille et il s’est marié avec Patricia/Mary. En 2010, Stéphanie a 84 ans, elle est bientôt veuve au début de la bande dessinée et elle découvre l’histoire de sa vie par les révélations de son mari, Jacques, à l’agonie. C’est le premier jour du reste de sa vie, le jour 1 de l’histoire.
Les treize jours qui passent déroulent le temps du souvenir qui ne suit pas un ordre chronologique mais qui enchaîne les moments, à partir d’associations d’images. Ces journées sont celles de l’annonce du coupable à la veuve de Jérôme Morval 47 ans plus tard, et de l’enquête de l’inspecteur Laurenc Serenac devenu le commissaire Laurentin qui va élucider les crimes de Paul/Albert et de James.
Dans ce tissage mémoriel où Stéphanie entrelace le fil de ses souvenirs sans souci de datation, un événement coïncide exactement avec le présent : il s’agit du jour 3, le 15 mai 2010 (p. 30/8). À 2h12, Stéphanie débranche volontairement la perfusion de son mari, entraînant sa mort, avant d’appeler l’infirmière à 2h46, ennuyée que son chien reste seul toute la nuit. À cet instant, elle pourrait passer pour une meurtrière, mais la suite de l’histoire dessine un miroir à deux faces. Le point de vue narratif est ici central puisque c’est celui de la femme âgée qui guide les vignettes et qui donne un sens à la fois à l’écriture et à la mise en image de l’histoire.
L’ellipse, arme secrète de la bande dessinée
Plusieurs tentatives se sont révélées infructueuses pour porter Nymphéas noirs à l’écran, en raison d’une intrigue retorse. Mais pour Fred Duval, le scénariste, la bande dessinée est un médium sur mesure pour ce texte multiforme par son art de l’ellipse : selon lui, adapter un roman noir sans en dévoiler le dénouement équivaut à « embarquer le lecteur dans une histoire assez linéaire et qu’il comprenne à la fin que l’histoire n’est pas si linéaire13 ».
L’ellipse est en effet fondamentale dans la bande dessinée puisqu’elle repose sur la compétence interprétative du lecteur et permet au dessinateur de faire l’économie de vignettes : il s’agit presque d’une forme d’accord tacite entre dessinateur et lecteur. Ici, la situation est particulière car l’ellipse constitue à la fois une clé d’entrée et un code secret que le lecteur ne découvrira qu’à la fin. C’est l’ellipse qui amène le lecteur dans le récit de la vieille femme avec un postulat d’illusion : le lecteur croit à une narration objective menée d’un point de vue extérieur, alors que c’est le point de vue de la femme âgée qui conduit la narration. Le lecteur le réalise dans les dernières pages ; plus exactement la caractéristique est mentionnée dès le départ avant d’être floutée ensuite, de sorte qu’il est donc possible de ne pas la repérer lors de la première lecture : « La première, la plus vieille, c’était moi ! » (p. 10/8). Cette vignette rencontre un écho à la fin de l’album, telle une boucle temporelle : « C’était il y a 13 jours, le 13 mai. Depuis, j’ai passé mes journées à revivre ces quelques heures où l’on me vola ma vie… à repasser le film pour essayer de comprendre avant d’en finir. Vous avez dû me prendre pour un fantôme. » (p. 137/2).
Cette ellipse temporelle majeure se trouve relayée par des ellipses régulières tout au long de la bande dessinée. À la page 118, un chevauchement de deux niveaux temporels se glisse sous l’apparente continuité narrative, matérialisé par deux colonnes verticales : 16h30 marque la fin de la classe, les enfants s’échappent en courant à gauche et Stéphanie, institutrice en 1963, part à vive allure sur son vélo dans la colonne de droite. À la ligne suivante, côté gauche, gros plan sur Paul qui court récupérer le tableau de Fanette, nous sommes donc en 1937 : les vignettes sont côte à côte mais n’évoluent pas dans la même temporalité, 1937 à gauche et 1963 à droite. Le lien qui les unit est l’impatience – de ramener le tableau de Fanette pour Paul, de retrouver Laurenc pour Stéphanie –, puis la mort qui se profile pour Paul et le billet d’adieu de Laurenc écrit sous la contrainte de Jacques Dupain. Le fil conducteur de la planche est la double rupture pour la jeune femme à deux moments déterminants de son existence, à cause de la même personne – Vincent devenu Jacques ou inversement – et de son amour exclusif. À la page 97 (vignettes 1-5), le procédé est similaire : d’une vignette à l’autre, Patricia et Stéphanie sont dessinées à 37 ans puis à 11 ans. Le fil thématique est conservé (les enfants, l’école, la maîtresse, le concours du peintre en herbe, la récréation) sans linéarité du fil chronologique : grâce à l’habileté du dessin et du scénario, le récit semble parfaitement cohérent. Cette planche se construit en miroir avec celle de la page 137 dans laquelle le nom de l’assassin de Jérôme est dévoilé en 2010.
L’ellipse prend parfois la forme de retours en arrière avec un effet de flash-back. Certains sauts dans le passé apparaissent en noir et blanc, nous l’avons vu pour la représentation de Rouen au XIXe siècle et c’est aussi le cas pour les photographies qui guident l’enquête de l’inspecteur Serenac (p. 32), d’autres à l’inverse se révèlent très colorés. Les cinq planches (p. 132-136) très saisissantes qui retracent les aveux de Jacques Dupain à l’agonie jouent avec talent de la couleur. Jacques raconte ce que Stéphanie ne sait pas, il s’agit donc d’un récit de première main qui s’achève par une révélation majeure. Le cadre du récit s’organise à partir de nuances de vert, les retours en arrière se détachent en noir en blanc, à la manière du crayonné avant le passage de la couleur décrit par le dessinateur : cette incrustation d’un état antérieur du dessin instaure un dialogue graphique qui fait écho aux planches 30-31 dont le sens échappait en partie au lecteur à ce stade de l’histoire mais qui s’éclaire à la fin du volume, comme les verres des lunettes de Stéphanie laissent voir son regard après la révélation (p. 136/9).
Les fils conducteurs, alliés de la cohérence narrative
Si ces ellipses temporelles sont très fréquentes, elles n’entraînent pourtant ni rupture, ni césure narratives. Paradoxalement, ces sauts séquentiels sans transition donnent une impression de fluidité et de linéarité dans la lecture : au-delà de la temporalité élastique, c’est bien la cohérence du récit personnel qui en assure la solidité.
Ce fil narratif fédérateur est relayé par des adjuvants : c’est le cas de Neptune, un berger allemand qui traverse les trois époques (1937, 1963, 2010) et participe à la linéarité du récit. L’explication est donnée à la fin (p. 138/8) : six bergers allemands ont jalonné la vie de Stéphanie, tous appelés Neptune en mémoire d’un caprice de petite fille qui aurait voulu que son chien soit éternel. La voix off narrative occupe également un rôle central : les récitatifs sont en effet omniprésents dans Nymphéas noirs, parfois pour donner des informations difficiles à illustrer mais surtout pour assurer la cohérence narrative, qui n’est pas une cohérence chronologique. Le procédé est presque cinématographique, tant cette voix surplombante donne un sens à l’ensemble avec d’un côté de vraies ruptures temporelles et de l’autre un décalage habilement dissimulé qui reste cohérent par rapport à la situation d’énonciation. Dans la planche de la page 13 par exemple, tout porte à croire que c’est la vieille dame qui voit le cadavre et qui empêche son chien d’approcher, et finalement ce n’est pas le cas puisque 47 ans séparent les deux scènes, qui se trouvent graphiquement associées par le souvenir du lieu. Le chien Neptune est également coutumier de ces sauts temporels : il passe d’une vignette à l’autre et franchit les années (p. 20/4-5), il est servi en cela par un village un peu figé dont le décor ne change guère : la complémentarité entre texte et image organise aussi l’égarement du lecteur.
La césure temporelle se trouve parfois magnifiée par la proximité de l’émotion : la page 41 présente, sous la pluie de Giverny, trois enterrements répartis sur trois bandes horizontales. La première se situe en 1963, c’est Jérôme Morval qui est enterré puisque dans l’assistance se distinguent Patricia Morval, l’inspecteur Laurenc, Stéphanie et son mari. La deuxième bande renvoie à 1937, lors de l’enterrement du jeune Paul/Albert : le lecteur reconnaît les enfants Vincent/Jacques, Fanette/Stéphanie, Mary/Patricia, Camille/Jérôme. Enfin, la suite de la planche montre Stéphanie âgée et seule aux obsèques de Jacques Dupain son mari (qui s’appelait Vincent quand ils étaient enfants), la plaque mortuaire le confirme. C’est ainsi l’enterrement du mari de Stéphanie, dans le cimetière où Paul et Jérôme sont déjà enterrés, qui déclenche le fil mémoriel dans une cohérence thématique évidente au regard du rôle de Jacques dans les deux disparitions.
Au détour des pages, des séquences graphiques se révèlent pleines d’émotion. C’est le cas pour trois planches bleutées (p. 112-114), unies par la question : « comment fuir Giverny ? ». Sur fond de pleine lune, la succession de vignettes forme un ensemble même si l’époque diffère. La rêverie rythmée par des phylactères sans appendice interroge sur l’avenir bien différent selon les époques : la mort pour Stéphanie en 2010, le concours de peinture pour Fanette en 1937, le départ avec Laurenc pour Stéphanie Dupain en 1963. Trois rêveries, trois manières de fuir Giverny. L’esthétique de ces planches laisse transparaître les liens entre les trois figures féminines, sans lever complètement le voile cependant : cette impression diffuse qui suscite l’émotion est un vrai cadeau du dessin.
Le défi à relever : ménager le suspense, montrer sans révéler
Si les techniques sont diverses, nous l’avons vu, la priorité est toujours laissée à l’imagination des lecteurs, avec un défi majeur quand le visuel s’invite : comment, dans la version dessinée, montrer sans révéler, semer des indices et des couleurs qui donnent à voir tout en laissant l’imagination poursuivre son chemin ?
Une bande dessinée à énigmes
Les très nombreux sauts séquentiels sans transition contribuent à organiser une incontestable confusion temporelle. Le premier indice qui amène à s’interroger sur sa lecture quand le texte n’est pas connu est tardif : il s’agit du retour de Neptune censé être mort à la page 125/8, car Jacques l’a tué trois pages plus tôt. Le chien sort d’un buisson à l’appel de la vieille dame : le nom est identique, aucun doute n’est possible, le lecteur n’a d’autre choix que de s’interroger. Commence dès lors un effet de lecture /relecture du lecteur qui revient en arrière pour repérer les indices : la démarche minutieuse participe au plaisir de la lecture car au-delà de la linéarité toujours affichée, le lecteur prend conscience d’un deuxième niveau d’interprétation sous le premier… et il se prend au jeu en cherchant les indices dissimulés dans les vignettes.
C’est le cas pour plusieurs exemples d’ellipse temporelle, qui laissent le lecteur à l’écart de la révélation : à la page 50, Stéphanie âgée entre chez Patricia Morval en déclarant, à propos de Jérôme Morval, « je connais le nom de son assassin » ; elle en ressort quatre planches plus tard mais le lecteur n’en sait pas plus. À la page 111 (vignette 6), à la demande de l’inspecteur Laurentin à la retraite, la mère d’Albert Rosalba (Paul, mort quand il avait onze ans), désigne le coupable du doigt mais le cadrage empêche le lecteur de voir la photo qu’elle regarde…
La pièce manquante : le tableau que le lecteur ne voit jamais
Dans ce travail permanent sur la dimension visuelle, un mystère demeure, celui du tableau que l’on ne voit jamais et qui est décrit dans le roman (p. 259-260)14 : les nymphéas peints par Fanette15. Il est pourtant souvent commenté, dans sa technique et son rendu. Le lecteur sait que l’objectif de Fanette est de « peindre des nymphéas de jeune ! Avec un arc-en-ciel ! » (p. 56/2) : « Monet, il voulait montrer l’eau qui dort, qu’on ait l’impression de s’enfoncer… Moi je veux faire l’inverse, que mes nymphéas aient l’air de flotter. Je veux peindre comme si Monet avait peint quand il avait 11 ans ! » explique-t-elle à Paul (p. 80/5). Elle affirme sa perception sans copier Monet (p. 79/6). Graphiquement, la technique utilisée pour préserver le mystère est le contrechamp (illustration n°5) : les enfants voient le tableau, Vincent en sera même jaloux puisque le talent de Fanette pourrait lui faire gagner le concours et l’éloigner de Giverny.
Le tableau est obscurci par Fanette après la mort de Paul (p. 130/1), il prend alors le nom de Nymphéas noirs : « il me restera bientôt plus que Neptune et vous, mes nymphéas ! Mes nymphéas en noir ! Ici, dans le plus sombre recoin de mon donjon, personne ne peut vous voir, aucune lumière ne vous trouble… Les fleurs du deuil… Les plus tristes qui aient jamais été peintes… » (p. 19/4-6). Stéphanie l’a conservé toute sa vie et le redescend du grenier après les révélations de son mari (p. 136/9).
Ce tableau très symbolique constitue le fil rouge de l’histoire : il fonctionne en palimpseste puisque sa lumière est obscurcie par la douleur de la disparition, « personne ne pourra imaginer qu’une autre vie pleine de lumière se cache en dessous » (p. 139/2). Le tableau est si réussi qu’il peut changer une vie (p. 120/4) ; le dessinateur ne va pas sur ce terrain, il reste en retrait devant ce tableau secret irreprésentable – il est seulement suggéré (p. 139/1) – et partage avec Fanette la volonté de ne pas copier Monet.
Il est aussi une métaphore du retour à la lumière, de l’élucidation de l’énigme : la vieille femme sort le tableau de l’ombre lorsque le commissaire Laurentin revient dans sa vie à la faveur de cette dernière enquête et attire les nymphéas vers la lumière. De la même façon, Stéphanie a gardé tout au long de sa vie les rubans argentés déposés dans les cerisiers pour éloigner les oiseaux, offerts par Paul car c’est la parure des princesses (p. 92/5). Elle s’en pare à nouveau lors du retour du commissaire, comme promesse d’une renaissance (p. 140/3).
Ce tableau toujours dissimulé est à réinventer, tel un cadeau de la version graphique : il est décrit indirectement dans le texte, des nymphéas arc-en-ciel puis noirs qui semblent en mouvement. Dans la bande dessinée, l’absence de représentation au profit des commentaires des personnages laisse toute la place à l’imagination du lecteur : nombre d’entre eux se sont d’ailleurs interrogés sur l’existence de ces nymphéas noirs peints par Monet…
La magie préservée
La question des nymphéas est emblématique de la richesse de la bande dessinée. Une seule lecture ne suffit pas car les surprises demeurent, à l’image de la complexité de reconstruction du fil narratif par exemple : trois niveaux temporels, une mémoire sensorielle et sélective, un tissage mémoriel personnel. L’ensemble génère la lente remontée hypnotique d’une existence, depuis les rêves enfantins où tout est possible, surtout gagner un concours de peinture qui emmènera très loin, jusqu’à l’enfermement d’un amour trop exclusif et la révélation d’un mari, juste avant sa mort, qui donne une autre clé d’interprétation. C’est cette reconstitution que le lecteur est invité à faire par sa relecture. Le passage au dessin, grâce à l’intermédialité, le permet en donnant cette vision graphique, logiquement plus discrète dans le roman.
La complémentarité entre texte et image est donc bien réelle sur cette toile de fond impressionniste, les personnages se révèlent stylisés et attachants. Un risque de ce tissage mémoriel, à la fois spatial et temporel, serait de créer une confusion entre les fils narratifs. À l’inverse, ils se trouvent ici entremêlés avec subtilité, en un savant dosage entre linéarité et incohérence. Le dernier chapitre modifie radicalement la perception de l’ensemble, il n’est pas une fin en soi cependant mais une invitation à la relecture : la dernière vignette de la planche (p. 136) renvoie le lecteur à la page 13, puisque la promenade matinale évoquée rappellera à Stéphanie le cadavre dans la rivière. L’album est jugé envoûtant selon un libraire, initiant une expérience de lecture unique, associant promenade entre les tableaux, complexité grandissante et doute qui s’impose au fil des pages.
Conclusion
L’intermédialité construite par cette réécriture graphique d’un roman à énigmes conduit la bande dessinée à pousser au plus loin ses propres codes – qu’il s’agisse de l’ellipse, des retours en arrière, du récitatif – pour les mettre au service de dessins qui doivent faire avancer l’intrigue sans tout dévoiler. Elle relève le défi de mettre en couleur tout en préservant jusqu’au bout le suspense d’une histoire à entrées multiples, semant çà et là des vignettes déterminantes.
Le lecteur, souvent délibérément égaré, peut croire par erreur à la linéarité des planches avant de s’apercevoir à la fin que cette linéarité n’était qu’une construction graphique soigneusement élaborée. La densité interprétative entre dessins, tableaux, photographies invite à une relecture au terme des 140 pages, afin de rechercher les indices : elle interroge de fait la notion de dénouement. La bande dessinée amplifie cette caractéristique du roman par l’aventure immersive qu’elle permet en donnant corps aux personnages dans ce voyage intérieur.
La bande dessinée Nymphéas noirs se révèle finalement très atypique et elle a rencontré un vrai succès à sa sortie. Elle dépasse l’univers du genre et donne une seconde vie au roman. Tout comme le roman était policier mais pas seulement, la réinterprétation graphique intermédiale n’est pas davantage cloisonnée ; elle est d’ailleurs encensée par la critique spécialisée comme par le public élargi. Cette réécriture graphique immersive entraîne son lecteur dans une incertitude de sens, avec des profils de personnages attachants et subtils : « une BD somptueuse au service d’une histoire remarquable, un chef d’œuvre de ce début d’année » relève un libraire16.
À ce jour, le duo Fred Duval et Didier Cassegrain travaille sur l’adaptation d’un autre roman de Michel Bussi, Ne lâche pas ma main : à suivre !17