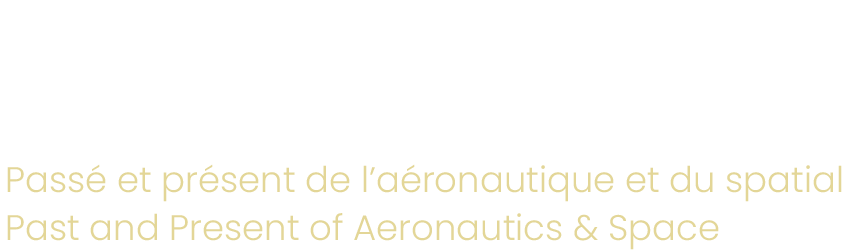« Mais tous les ciels sont beaux », peut-on se dire à la lecture de la très vaste et remarquable étude d’Elsa Courant, Poésie et cosmologie dans la seconde moitié du xixe siècle. Nouvelle mythologie de la nuit à l’ère du positivisme. Si le sous-titre est un peu trompeur, la nuit étant peu évoquée pour elle-même1, c’est bien un ample et magistral panorama de la poésie cosmologique que dresse Elsa Courant. Les liens entre poésie et cosmologie ont déjà pu être explorés, comme le rappelle l’autrice ; ils trouvent dans la seconde moitié du xixe siècle, de nouveaux reliefs, en ce que la poésie cosmologique est « un des lieux où se négocient les nouveaux termes du débat entre la religion et la science » (p. 192).
Ce sont d’abord, comme le signale Elsa Courant dans sa première partie (2 chap.), « Chanter le cosmos après le Romantisme. Introduction contextuelle et méthodologique à la poésie du ciel (1840-1900) », les découvertes scientifiques de la période, qui nourrissent l’imaginaire poétique. Plus largement inscrite dans l’histoire des sciences et des idées du xixe siècle, en se plaçant dans le champ (littéraire) de l’épistémocritique, l’étude présente avec un détail précieux l’importance du positivisme et de la pensée socialiste des sciences, souvent centrée autour de la figure (majeure) de Fourier, dont l’héritage est régulièrement rappelé dans ses différentes réminiscences, tant chez Victor Hugo, que chez Allan Kardec ou Jean Reynaud. Les systèmes d’autres penseurs (parfois de sectes) socialistes, comme le saint-simonisme, auraient peut-être pu être davantage pris en compte2, mais l’étendue et la précision des sujets abordés impressionnent. Science du ciel, la cosmologie est en effet à la fois une discipline ancienne, à la tradition séculaire, et une discipline non expérimentale, qui peut parfois sembler spéculative et datée aux contemporains. La découverte de Neptune en 1846 par Le Verrier relance la scientificité, selon de nouvelles modalités, de la cosmologie. La parution en 1845 du très vaste Cosmos d’Alexandre Humboldt contribue à la création du nom « cosmos » et de sa discipline3. L’influence majeure de l’ouvrage est suivie très précisément par Elsa Courant, qui en détaille la réception et les échos. Le deuxième chapitre est aussi une synthèse, cette fois de ce qu’est la poésie cosmologique, « au-delà du didactisme », c’est-à-dire de la poésie scolaire4 ou de vulgarisation scientifique, mais ouvrant plutôt une « voie orphique » de médiation entre le ciel et la terre, par l’entremise du poète. Si le chapitre précédent n’oubliait pas la question des types des textes et des discours, ce chapitre est plus franchement poétique, en présentant la généalogie de la « poésie du ciel », base de l’éthos du poète, mis en parallèle avec le « sacerdoce de l’astronome ».
Après cette première partie, qui pose les fondements nécessaires à la compréhension de la poésie cosmologique du xixe siècle, les trois parties suivantes s’organisent à partir des imaginaires et des spiritualités engagés par la poésie cosmologique. La poésie du ciel n’est pas une poésie terrestre : elle pose d’abord un « enjeu spirituel », comme l’explore la deuxième partie (4 chap.). À partir de la métaphore du Livre-Monde, pour laquelle Elsa Courant s’appuie fructueusement sur les travaux de Hans Blumenberg, elle retrace et étudie les rapports entre foi (traditionnelle) et la science. Le « désenchantement du ciel », vidé de ses dieux, est réinvesti par Mallarmé, dont Elsa Courant offre une analyse aussi précise que stimulante et originale. La sécularisation de sa poésie conduit à un « rêve cosmologique », qui se confond dans l’absolu du Livre rêvé, aboutissant à la pensée de la constellation comme « modèle esthétique et formel », faisant du « Coup de dés » la réalisation du Livre cosmologique (dans la quatrième partie). La « rupture rationaliste », que Mallarmé éprouve en proclamant que « Le Ciel est mort », n’est pas celle ni de Camille Flammarion, à l’origine d’un « retour poétique des mirabilia »5, ni de Lamartine, figures d’une « réconciliation » de la science et de la foi, non sans raccourci ou négligence de la factualité scientifique – autant d’erreurs poétiquement fécondes, dont Elsa Courant retrace rigoureusement le parcours, en en montrant la productivité. Le sixième chapitre de cette partie est probablement le plus inattendu : « l’invention de nouveaux cosmos religieux » ouvre la porte du spiritisme, notamment de la métempsycose et de la réincarnation, en laissant une large place à Victor Hugo.
La troisième partie (3 chap.), « Une nouvelle mythologie de la nuit : le paradoxe des redécouvertes », aborde la question des savoirs cosmologiques d’une manière qui pourra surprendre : le ciel qui inspire les poètes n’est pas seulement celui des savants, mais aussi celui des mythologues. Le xixe siècle est en effet le siècle qui voit la (re)découverte des mythes extra-occidentaux, notamment hindouistes. En partant des mythes gréco-latins, sans oublier le statut délicat du texte biblique, l’autrice montre comment s’opère un syncrétisme mythologique au cœur même de la poésie du ciel – syncrétisme dont La Légende des siècles d’Hugo constitue un parangon. Le « cosmos oriental des dieux disparus » montre comment les savoirs philologiques (loin d’une cosmologie scientifique) nourrissent de nouveaux imaginaires, en ouvrant la cosmologie aux ciels de papier. L’épineuse question de la véracité scientifique se déplace de la cosmologie à la mythologie comparée, dont l’autrice analyse avec finesse les enjeux (le bouleversement) et la réception.
La quatrième partie (3 chap.), « Formes et registres de la poésie cosmologique, de l’avant-garde aux parodies » conjugue étroitement histoire des idées, des sciences et analyse formelle. Les expérimentations d’Henri Cazalis, de Jean Berge, de René Ghil ou de Frank Vincent sont explorées dans leurs spécificités. Le renouvellement majeur des formes poétiques opéré au xixe siècle trouve, en rencontrant les nouvelles interrogations cosmologiques, des formes originales : ainsi la forme fragmentaire du Livre du Néant, d’Henri Cazalis, peut « refléter une vision pessimiste de l’ordre cosmique, voire une réflexion plus générale sur l’incohérence du monde et l’hétérogénéité des connaissances scientifiques, philosophiques ou religieuses » (p. 583). Ghil, pour sa part, développe un programme de « poésie cosmique », selon lequel « [l]e principe cosmique devient un principe de composition, la poésie épousant l’ordre du monde » (p. 605), principe de composition poussé encore à un nouveau paroxysme chez Frank Vincent, mais surtout chez Mallarmé. Si ces expérimentations renouvellent aussi le genre épique, c’est dans les parodies et les « poèmes-récits astronomiques » de la fin du xixe siècle que se trouvent aussi les éclats des grandes formes antiques. Les deux derniers chapitres de l’ouvrage sont respectivement consacrés aux utopies extra-terrestres et à l’humour, « au service d’une anti-poésie du ciel ». Il peut sembler étonnant de démarrer cette partie par les avant-gardes les plus poétiques et formelles, et de la poursuivre par des tonalités plus mineures. Le récit renoue avec la tradition, heuristique, des voyages, et il est aussi révélateur « du statut acquis par la poésie cosmologique » (p. 687) à la fin du xixe siècle. Les poèmes humoristiques ne sauraient ainsi être cantonnés au statut de minores, mais doivent être aussi appréhendés en ce qu’ils montrent ce que les codes peuvent aussi produire de « clichés ». Cette « lyre désaccordée » conduit Elsa Courant à d’abord présenter les parodies mettant en scène des animaux, avant d’analyser les satires, parfois anticléricales, dans la lignée des bibles farce6. L’humour noir laisse ensuite la place aux « fous littéraires » et au comique involontaire : ce paradoxe, qui fait culminer l’ouvrage sur l’étude des auteurs les plus dénués d’auctorialité, permet de confirmer l’unité de l’ensemble du corpus cosmologique, confirmant l’émergence d’un « type », parodiable, même sans référence directe.
Si Elsa Courant refuse, dans son introduction, de parler d’un « genre » cosmologique, en raison de la trop grande disparité formelle des textes de son corpus, des modalités se font néanmoins jour, au-delà de l’unité poético-thématique. Le vaste corpus est présenté dès le début de l’étude, et synthétisé dans des tableaux récapitulatifs permettant une vue d’ensemble, avant les analyses plus monographiques. L’étonnante sous-représentation des femmes dans ce corpus est remarquée et commentée, sans qu’il y ait encore d’explication précise à apporter7. La structuration, ni thématique, ni complètement chronologique, de l’ouvrage permet d’aborder la disparité de ce corpus sans verser dans la revue, tout en analysant précisément les textes : quelques retours de grands noms (Hugo, Mallarmé) peuvent surprendre, mais ces retours permettent de valoriser les minores, tout en plaçant les grands auteurs dans leur époque et leur histoire littéraire. S’il peut être plus difficile de suivre le parcours des poètes les plus connus, cette structuration, facilitée par des enchaînements clairs et toujours didactiques, met au premier plan l’histoire des formes et des idées, de manière toujours convaincante. Une impressionnante bibliographie (41 pages) et un grand appareil de notes, toujours utiles, complète l’ouvrage, dont on regrettera seulement que l’index (déjà important) ne tienne compte que des sources primaires (poèmes édités en volume, pour une bonne part non réédités depuis le xixe siècle), et non des études critiques. L’ensemble se lit avec profit et plaisir, tout en suscitant l’envie d’approfondir à son tour, par la découverte de textes et d’auteurs méconnus – voire de prendre la plume des cieux.