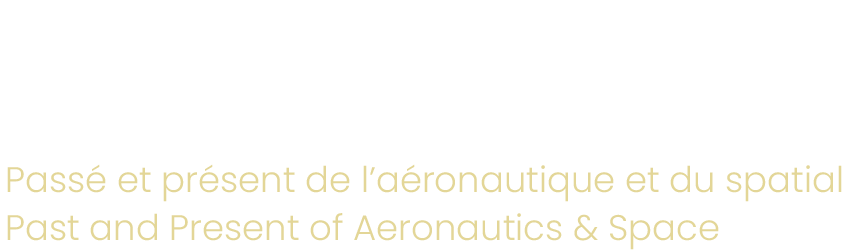Introduction
L’aéronautique civile ne connaît pas la crise en Europe, encore moins en ce moment où Boeing s’enfonce dans les difficultés avec son 737MAX, dont la production a été suspendue pour cause de déficiences multiples1. Les réussites concomitantes d’Airbus hissent d’autant plus ce modèle d’entreprise atypique au rang de référence2 : fruit du politique et de l’industrie, de la coopération entre plusieurs nations – surtout franco-allemande –, Airbus fait figure, avec Arianespace, d’emblème d’une coopération industrielle efficace, spécialement dans les technologies de pointe, qui a rendu possible de contester la domination américaine sur le marché de l’aviation civile en créant de toutes pièces un système performant de production transnationale intégré. Pourtant, ce succès n’a pas été facile à mettre en place : rapprocher des États différents, des entreprises et des modes de managements divers n’était pas une évidence ni un gage de succès… La preuve en est l’échec cuisant du projet européen Unidata, lancé en 1973 entre CII (Compagnie internationale pour l’informatique), Philips et Siemens pour concurrencer IBM, et avec l’objectif de créer une grande industrie informatique européenne… projet qui s’arrête brutalement dès 19753.
Parallèlement, la simple évocation d’Airbus joue aujourd’hui un rôle de sésame4 : au printemps 2014, Siemens proposait au gouvernement français la constitution d’un « Airbus de l’énergie et un Airbus du ferroviaire » afin d’éviter le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric5 ; fin 2016, le groupe italien Fincantieri affirmait pour sa part vouloir créer un « Airbus des chantiers navals » en prenant la place du coréen STX, en faillite, dans le capital des Chantiers de l’Atlantique6 ; récemment, un projet d’« Airbus des batteries », dont l’objectif est de contrer la situation de quasi-monopole des Asiatiques dans le domaine des motorisations électriques, a même obtenu le soutien de la Commission européenne7.
De fait, nous allons nous demander si Airbus, qui est effectivement représentatif d’une belle réussite dans le domaine transnational, le doit à l’application d’une méthode communautaire à part entière. Pour cela, nous allons étudier ici le contexte politique et économique, tant à l’échelle des nations qu’à celle de la Communauté, dans lequel le projet a germé et comment il s’est réalisé, jusqu’à la mise en place du consortium en 1970. L’article ne portera donc pas tant sur Airbus lui-même que sur les facteurs nationaux, européens et internationaux qui ont rendu possible son existence.
1. Une dynamique insensible de rapprochement entre politiques nationales
1. 1. Un État plus souple
De retour au pouvoir en 1958 en France, le président de Gaulle annonce une inflexion de la politique économique qui semble mettre en danger le projet européen depuis peu sur les rails. On sait que le Général se méfie d’un plan qu’il prétend à vocation fédérale, autant qu’il se méfie des hommes qui, tel Jean Monnet, l’ont inspiré. L’effort économique que de Gaulle entend mener semble s’arrêter aux frontières du pays et tourner autour du Plan, présenté comme une « ardente obligation »8 qui s’impose à tous les Français. L’un de ses premiers engagements est cependant d’accepter le Marché commun, mais c’est d’abord parce qu’il y voit le moyen de moderniser les structures du capitalisme hexagonal. Il perçoit en effet la Communauté économique européenne (CEE) comme un espace où développer les groupes industriels nationaux qui seront fers de lance d’une politique d’indépendance vis-à-vis des États-Unis. Même les collaborations européennes, quand il y en a, se font de manière dirigiste et stato-centrée : dans l’aéronautique, la France construit ainsi le Concorde avec le Royaume-Uni, un pays non communautaire, qui plus est suivant la volonté de De Gaulle.
La politique industrielle de Georges Pompidou change de dimension : il s’agit de laisser tomber la « Grandeur » chère au Général pour un pragmatisme plus réactif. Cette prise de conscience se précise d’abord dans le milieu des hauts fonctionnaires proches des allées du pouvoir : le conseiller de Pompidou pour les questions industrielles et scientifiques, Bernard Esambert, est ainsi l’un des premiers à évoquer le concept de « guerre économique » opposant les États-Unis et les pays d’Europe occidentale9, dans une période où le primat de l’indépendance nationale est mis en difficulté par le tournant libéral que connaît alors le monde10 ; le chef de service du Plan à la direction générale de la recherche scientifique et technique – qui dépend directement du Premier ministre – Pierre Cognard, évoque pour sa part un « défi » qu’il s’agit de relever11 ; quant à Pierre Massé, commissaire au Plan de 1959 à 1966, il s’intéresse aux « écarts » et aux « retards » de la France vis-à-vis de ses partenaires/concurrents12. En la matière, les statistiques économiques que livre une organisation telle que l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), publiques et documentées, permettent à chacun des États de connaître leur position dans le monde et d’en tirer des enseignements13.
Cette prise de conscience traduit d’abord un bouleversement des relations économiques transatlantiques, qui ont été réappréciées par Washington. Depuis 1947 et le plan Marshall, celles-ci faisaient l’objet d’une gestion bienveillante, bien qu’intéressée, de la part des États-Unis, mais un tournant se fait sentir à partir des années 1960. La mise en place de la Politique agricole commune (PAC) en 1962 ouvre tout de suite ce que les contemporains ont appelé la « guerre des poulets » à propos de la taxation de la volaille américaine par la CEE (1963), dont le chancelier Adenauer dira qu’il en a plus entendu parler dans ses échanges avec le Président Kennedy que de Berlin, du Laos ou de la baie des Cochons14. Certains observateurs américains se récrient alors contre la supposée ingratitude des Européens, comme le formule le journaliste-vedette du New York Times Edwin Dale, qui se demande si l’Amérique doit continuer à « fumer la marijuana de l’unité européenne »15. Cette inquiétude porte essentiellement sur le développement des secteurs modernes de l’économie européenne, nous rappelant que la technologie fait partie des enjeux que les Américains souhaitent contrôler, comme ils l’ont démontré dans leur volonté constante de gérer l’atome.
Cette phase de concurrence effrénée semble en tout cas démontrer les limites de la politique des « champions nationaux » : certes, en favorisant des rapprochements entre entreprises existantes, l’État permet au champion d’atteindre une taille critique, mais cette pratique ne réussit généralement pas à produire une unité performante. Si cet échec semble se révéler peu à peu dans le courant des années 1960, reste maintenant à trouver des partenaires pour ne pas le prolonger.
1. 2. Potentialités franco-allemandes
Le rapprochement franco-allemand est au cœur de la dynamique d’intégration, mais l’épisode le plus connu de celui-ci n’est pas forcément représentatif de la prise de conscience que l’on évoque ici : le traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963, et qui aboutit à l’institutionnalisation d’une coopération accrue entre Bonn et Paris, exclut les compétences économiques ; de plus, il a été volontairement bridé par les Allemands qui, pour leur part, y ont ajouté un protocole additionnel rappelant leur attachement à l’OTAN et à une perspective fédérale, ce qui n’est pas pour plaire au Général16. Le rapprochement économique entre les deux pays a de toute façon déjà eu lieu, vérifiable par l’installation croissante d’entreprises de part et d’autre du Rhin17 et par la signature de traités de commerce comme celui de La Celle Saint Cloud (11 octobre 1954), qui rend une coopération possible, notamment dans le domaine aéronautique18.
C’est bien en dehors du traité de l’Élysée que se mettent en place deux institutions spécifiques créées pour évaluer une coopération franco-allemande en termes de politique industrielle : le bureau industriel franco-allemand (1965-1967), composé de fonctionnaires des deux pays, puis le comité franco-allemand de coopération économique (1967-1968), qui associe les industriels19. Les résultats restent néanmoins extrêmement modestes, faute de facteurs contraignants aussi bien chez les Français que chez les Allemands.
Cette situation rappelle que les velléités de rapprochement ne sont pas forcément de nature « européenne » de part et d’autre du Rhin : côté français, on s’inquiète de plus en plus de l’autonomisation de la RFA lancée dans son Ostpolitik, qui semble signifier le retour au premier plan des Allemands sur la scène internationale ; du côté de Bonn, l’objectif est plus centré sur la question économique, dans un pays où, depuis 1945, certaines industries, notamment dans l’aéronautique, sont morcelées, et où les meilleurs ingénieurs ont pris leur envol ailleurs, parfois même de l’autre côté du Rhin20. Ces motivations, plus ou moins avouables, poussent à une coopération qui dépasse le simple stade de la connexion.
Dans ce contexte, la France propose des options s’apparentant à des coups de sonde, mais qui soulignent un changement d’état d’esprit. Paris présente ainsi à ses partenaires européens un mémorandum sur la « politique de la recherche scientifique et technique », alors que le pays occupe la présidence du Conseil de la CEE, le 4 mars 1965. Il ne s’agit pas de suggérer une politique commune dans ce secteur, mais de procéder à une rationalisation des politiques nationales. À la fin du même mois, une note sur la « société européenne » est présentée pour faciliter, du point de vue juridique, le rapprochement suggéré en mettant sur pied une structure destinée à faciliter les coopérations transnationales pour atteindre une taille critique sur le marché mondial21. Appliquées dans le cadre franco-allemand, ces propositions aboutiraient à la constitution d’une sorte de « bureau de mariage industriel »22 relevant d’un modèle d’Europe « organisée »23 encadré par les pouvoirs publics, comme c’est déjà le cas avec le programme des satellites expérimentaux de télécommunications « Symphonie » inauguré en 1967 (bien que les lanceurs restent américains).
Même si les convergences entre France et RFA peuvent être limitées par la prégnance des objectifs politiques, les pratiques des deux pays en matière de coopération industrielle et l’importance croissante du fait communautaire semblent amener une approche associant nationalisme économique et cadre européen, un cadre défini comme naturel bien que non exclusif.
1. 3. Le « défi technologique », un débat qui monte en intensité
Les discussions sur les déséquilibres croissants entre États-Unis et Europe dépassent le cadre de la CEE : l’OCDE parle dans son rapport de 1967 d’un « gap technologique » avec Washington facilité par la fragmentation du marché européen, et évoque la nécessité de créer des groupes industriels transnationaux24. Ce rapport livre des chiffres qui démontrent la disparité technologique croissante entre les États-Unis et les pays occidentaux : les premiers ont ainsi investi six fois plus dans les projets techniques et scientifiques que les six pays de la CEE en 1966.
Ces discussions touchent également chacun des États : Raymond Aron reprend, dans ses tribunes de presse, ce thème du « fossé technologique » et appelle à revoir la politique industrielle des pays européens25 ; certains hommes politiques, tel Pierre Sudreau, s’inquiètent de la perte de terrain dans les secteurs de pointe à l’heure d’une révolution technique qui exige des moyens de production différents26. Ces hommes de différents bords ne sont pas des fédéralistes, mais des défenseurs de la loi de la dimension pour lesquels l’État n’est plus l’échelle adéquate, et qui insistent sur un point : une éventuelle collaboration européenne en matière technologique part de zéro, ce qui représente une chance que n’a pas eue le projet mort-né d’armée européenne.
Le livre qui porte le débat le plus loin est sans conteste Le Défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber, sorti en 196727. Sa thèse principale est la suivante : les États-Unis et l’Europe se livrent une guerre économique silencieuse où cette dernière semble totalement dépassée, tant au niveau des méthodes modernes du management que de l’équipement technologique et de la capacité de recherche. L’ouvrage, traduit en quinze langues, se vend à des millions d’exemplaires et fait mouche, notamment en France où il contredit la vulgate gaulliste sur la grandeur retrouvée du pays, surtout en un temps où le taux de croissance, qui avait atteint 7,2 % en 1960, a tendance depuis à reculer (il est de 4,6 % en 1967), et rappelle cette tendance troublante : les investissements américains en Europe ont doublé entre 1950 et 1958, puis triplé entre 1958 et 196628.
Côté allemand, la prise de conscience est similaire. Le ministre fédéral des Finances Franz Josef Strauss livre un véritable plaidoyer en faveur d’une politique industrielle européenne dans son ouvrage Défi et réponse (1968) qui va dans le même sens que celui de Servan-Schreiber, ouvrage lui-même préfacé par ce dernier29. Lui aussi avance des chiffres percutants et espère faire prendre conscience à ses concitoyens des véritables rapports de force entre États-Unis et Europe : il rappelle ainsi que 3 612 chercheurs européens sont partis Outre-Atlantique entre 1956 et 1966, dont une majorité d’Allemands30. La nécessité d’une coopération européenne en matière technologique s’impose à peu près au même moment dans la plupart des pays occidentaux (rapport Plowden de décembre 1965 au Royaume-Uni, commission de réorganisation de l’aéronautique présidée par Giuseppe Caron entre 1967 et 1969 en Italie), sans que l’on ne se questionne véritablement sur la forme que pourrait prendre cette coopération.
De fait, trois domaines de haute technologie d’avenir sont très en retard en Europe d’après les observateurs : la technique spatiale, la fabrication d’ordinateurs et la construction aéronautique. Dans ces secteurs, certains pensent qu’il vaut mieux maîtriser plutôt que subir, ce qui pose la question, avec une ardeur renouvelée, d’une véritable politique industrielle européenne.
2. Vers une politique industrielle européenne ?
2. 1. Des précédents décevants
La politique industrielle européenne, c’est « l’Arlésienne de l’Europe : comme dans l’opéra de Bizet, on en parle souvent, mais on ne la voit jamais31 ». Pour bien comprendre cette maxime, un retour en arrière s’impose. C’est en effet dans l’industrie que se concrétise en 1951 l’idée même de Marché commun, avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Cette communauté, que l’on peut présenter comme l’embryon de la future CEE, a néanmoins un objectif d’abord politique, qui consiste à sceller la réconciliation entre la France et la RFA par la mise en commun de leurs ressources en charbon et en acier. Il s’agit aussi d’en finir avec certains archaïsmes nationaux : en France, le gouvernement espère rompre avec le « malthusianisme » d’un capitalisme replié sur lui-même et sur ses colonies en adoptant un modèle anglo-saxon basé sur le libre-échange et la productivité des entreprises. Il est vrai que la manne du plan Marshall que prodiguent les Américains dépend elle aussi du respect de ces principes.
Cependant, malgré des débuts prometteurs, la CECA ne peut rien faire en matière de production ni surtout agir quand elle le pourrait. C’est ainsi le cas lors de la crise charbonnière que rencontrent les pays membres dès 1959, contre laquelle la Haute Autorité – l’organe exécutif de la CECA – souhaitait décréter l’« état de crise manifeste » de manière à fixer des quotas de production pour stabiliser les prix du charbon, ce qui est refusé par les États. À partir de là, et dans une situation où la production carbonifère continue à péricliter, la CECA se contente désormais d’émettre des recommandations générales32.
La nécessité d’une politique industrielle n’est ainsi pas perçue dans ces débuts de la coopération européenne, et l’on doit rappeler qu’elle n’est même pas mentionnée dans le traité de Rome, signé le 25 mars 195733. Ce dernier, qui fonde la CEE, vise en effet avant tout à créer un marché sans frontières. L’union douanière qu’il projette prévoit « l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux »34. L’horizon n’est cependant pas bouché, un article du traité de Rome stipulant que la CEE n’était pas condamnée à rester une simple organisation commerciale puisqu’elle vise à fusionner progressivement les économies par processus d’intégration35.
Il n’empêche que les bases de travail des toutes jeunes autorités communautaires portent prioritairement sur l’instauration de la libre circulation des biens manufacturés dans l’espace communautaire et sur la constitution d’une législation européenne de la concurrence à partir des articles 85 (ententes) et 86 (positions dominantes) du traité CEE. Il s’agit ici des fondamentaux concernant l’activité principale de la Commission européenne au départ, qui laissent par ailleurs le soin aux forces du marché de modeler progressivement le cadre économique communautaire.
Le premier objectif d’une politique industrielle étant d’éviter des interventions désordonnées et contradictoires des pouvoirs publics mais aussi du marché, on ne peut pas dire que la suppression des obstacles aux échanges suffise en soi pour parler d’une action à l’échelle européenne.
2. 2. Une prise de conscience croissante
Le débat rebondit dans les années 1960 autour de deux types de régulation macro-économique qu’il s’agit d’assurer à l’échelle communautaire, alors que la construction européenne est sur les rails : dans le domaine de la concurrence, la doctrine ordo-libérale préconise la limitation de l’intervention publique dans l’économie ; dans celui de la politique industrielle, certains évoquent la nécessité d’une action volontariste de renforcement de la structure existante.
Ces débats débouchent sur deux conceptions différentes de l’Europe économique. La première cherche à préserver les intérêts du consommateur dans un cadre neutre parce qu’universel, suivant la doctrine libérale ; la seconde, s’interrogeant sur la place de la CEE sur le marché mondial, vise plus à définir un cadre européen susceptible de protéger les pays du Marché commun. Cette dernière politique, qui nous intéresse plus particulièrement ici, encourage donc l’intervention des autorités publiques suivant des considérations économiques et des objectifs de cohésion sociale ou territoriale (lutter contre la crise et les disparités économiques) ou des finalités de puissance industrielle et politique (renforcer certains secteurs stratégiques et les industries de pointe) afin d’affirmer l’identité de l’Europe.
La nécessité d’une politique industrielle n’est pourtant toujours pas perçue36 : on compte dans l’organigramme de la Commission mise en place par le traité de Rome une simple direction « industrie, artisanat et commerce », elle-même dans le giron de la direction générale « marché intérieur ». Il faut attendre 1967 pour qu’une structure baptisée « Affaires industrielles » soit créée suite au Traité de fusion des exécutifs communautaires (8 avril 1965), sous l’autorité de l’Italien Guido Colonna di Paliano, la même année où le commissaire européen à l’Économie et aux Finances, Robert Marjolin, se fait l’avocat d’une « communauté technologique » européenne37.
Pourtant, de nombreux problèmes qui affectent le secteur industriel européen sont soulignés parmi les acteurs de terrain, notamment ceux des secteurs de pointe les plus avancés, qui souffrent d’un manque de compétitivité face aux Américains : les entreprises y sont trop petites, avec des moyens consacrés à la R & D limités et une base commerciale trop étroite. Ces problèmes sont d’autant plus préoccupants que ces secteurs hautement technologiques sont alors en plein développement, eux-mêmes confrontés à une libéralisation croissante de l’économie mondiale avec les retombées du Kennedy Round.
Une première globalisation des perspectives est proposée par la Commission européenne avec l’institution d’un Comité de politique économique à moyen terme, proposition adoptée par le Conseil des ministres le 15 avril 196638. Dans cette structure qui cherche à articuler politiques industrielles nationales et politique industrielle européenne en cours de définition, on parle d’assurer la promotion des concentrations intracommunautaires, de permettre une meilleure connaissance des investissements étrangers dans la CEE et d’encourager une politique de recherche plus intégrée. Un accent particulier est porté sur les industries d’avenir (nucléaire, espace, aéronautique, pharmacie, électronique), pour lesquelles il s’agit de retrouver une « certaine autonomie » et d’établir « une coordination des efforts nationaux39 ». Ces points sont de nouveau évoqués dans le mémorandum sur la politique industrielle de la Communauté (4 juillet 1967), qui insiste plus particulièrement sur la menace que représentent les entreprises américaines40.
2. 3. Une réflexion renouvelée
Pourquoi ces débats sur une politique industrielle intégrée se tiennent-ils au même moment aussi bien au sein des États qu’au plus haut niveau des institutions européennes ?
Il y a d’abord une question de circonstances liée à la socialisation de hauts fonctionnaires aussi bien nationaux qu’européens, en place tant dans les instances décisionnelles communautaires que dans celles des pays membres de la CEE, qui se connaissent, échangent les uns avec les autres et sont préoccupés par l’idée de modernisation économique. Cette génération, qui a la quarantaine à la fin des années 1960, n’est pas forcément européiste mais pense en termes de compétition internationale et moins de dirigisme. Parmi ces hommes, côté français, on peut citer François-Xavier Ortoli, qui a été directeur général du Marché intérieur à la Commission européenne en charge des affaires industrielles avant de devenir responsable du Secrétariat général des affaires européennes (SGCI) auprès de Georges Pompidou de 1962 à 1966, puis commissaire général du Plan de 1966 à 196741 ; Jean Dromer, lui, a été également secrétaire général du SGCI de 1966 à 1967 après avoir été membre de la délégation française pour la négociation des traités de Rome ; Alain Prate, conseiller économique de De Gaulle, a fait partie de la délégation pour la signature des traités de Rome et a travaillé dans différentes directions générales de la Commission européenne, notamment auprès de Guido Colonna di Paliano en 1966. Côté allemand, on distingue certains hauts fonctionnaires qui sont passés par des réseaux de socialisation dans le cadre du rapprochement franco-allemand (Winfried Böll), ont œuvré dans les premières structures de coopération économique européenne (le secrétaire d’État à l’Économie Wolfram Langer, premier président du Comité de politique économique à moyen terme) ou qui ont une expérience personnelle de ce rapprochement (Carlo Schmid, coordinateur des relations franco-allemandes en 1969, lui-même né à Perpignan d’une mère française).
Ces hommes connaissent donc les coulisses de Bruxelles et sont conscients des enjeux qui se jouent au-delà des frontières nationales. Tous plaident pour un rapprochement entre des économies européennes désormais plus réticentes face au leadership américain. À Bruxelles même, certains fonctionnaires sont sur la même ligne. C’est par exemple le cas de Robert Toulemon ou de Michel Albert. Le premier, énarque et inspecteur des finances en 1954, rejoint la Commission européenne en 1962 où il devient directeur général des Affaires industrielles, technologiques et scientifiques, et milite dès lors pour la création d’une véritable politique industrielle européenne42. Michel Albert est directeur de la structure et du développement économique à la Commission de 1966 à 1969. Proche de Jean-Jacques Servan-Schreiber, il lui a fourni documentation et rapports que celui-ci a utilisés pour rédiger Le Défi américain43, et il fait de même avec Jean Dromer, alors secrétaire général du SGCI.
De fait, la crainte que peut susciter le renouveau de la puissance allemande, qui a toujours inquiété Paris, ne disparaît pas complètement mais s’atténue désormais devant le danger américain, et une vraie politique industrielle communautaire paraît être un moyen pour s’en protéger, puisque ce danger se situe clairement dans le champ économique.
Néanmoins, après la crise de la chaise vide de 1965 suite au bras de fer institutionnel entre le Général de Gaulle et la Commission, et qui se termine par la minorisation de cette dernière, une politique globale paraît difficile à mettre en place. La prise de conscience est naissante, mais l’absence de bases juridiques est rédhibitoire. Dans ces conditions, il s’agirait plutôt pour Bruxelles de se concentrer sur des actions plus pragmatiques qui permettraient d’inciter des actions de rapprochement44. Même si certains fonctionnaires européens imagineront s’appuyer sur cette dynamique pour évoluer vers un système intégré45, les rares coopérations industrielles vont se développer de manière intergouvernementale, en dehors des institutions bruxelloises, et c’est bien avec ce bémol-là qu’il faut observer l’européanisation économique alors en cours.
Cette évolution, certes, remet en cause le tabou fédéraliste de l’Europe institutionnelle avant tout, chère à Jean Monnet ; mais en même temps, l’option confédérale est elle aussi critiquée : du point de vue économique, elle aboutit à un morcellement qui n’augure rien de bon et appelle à une réaction, fût-ce par le biais d’une coopération à l’échelle européenne où les États, conscients des enjeux, sont prêts à prendre l’initiative.
3. Le cas de l’aéronautique
3. 1. Premiers pas
Il faut pourtant faire le constat de la fragmentation initiale du marché européen dans ce secteur, que l’OCDE a rappelée dans le rapport que nous avons déjà rencontré, où était évoquée la nécessité de créer des groupes industriels transnationaux européens. Le diagnostic est repris dans le rapport Colonna de la Commission européenne (1970), qui conclut à la nécessité d’une politique intégrée en matière d’industrie, notamment dans les secteurs de haute technologie, et en particulier l’aéronautique46. Les États sont depuis longtemps les principaux prescripteurs dans ce secteur, par leurs commandes militaires et celles qui concernent les compagnies aériennes nationalisées. Ces commandes gouvernementales qui ne visent que les producteurs nationaux atteignent jusqu’à 65 % du marché européen de l’aéronautique47, dont les montants sont cependant loin des standards américains48. Aux États-Unis, Boeing doit beaucoup à la fois aux commandes publiques et au soutien des militaires, mais cette situation ne suffit pas à expliquer les carences des avionneurs européens par rapport à leurs rivaux américains : il leur manque une stratégie d’ouverture technologique susceptible de leur permettre de repousser très loin les espoirs de gain commercial par ce mariage entre initiatives technologiques et lien avec la puissance publique, central aux États-Unis.
L’européanisation du marché de l’aéronautique paraît ainsi difficile, surtout du fait du facteur technologique qui prend de plus en plus d’importance dans sa croissance. En effet, les armées nationales étaient traditionnellement investies de la gestion de ce facteur, plaçant de facto la technologie sous haute surveillance, une autorité de tutelle encore plus sourcilleuse en matière aéronautique. Cette primauté était reconnue par les traités européens eux-mêmes, qui ont entériné une dérogation au droit communautaire dans le domaine de la défense49.
L’autorité strictement militaire en matière de haute technologie s’est cependant peu à peu déployée au début des années 1960 vers des structures civiles, que ce soit, en France, le ministère des Transports (aviation civile), le CNES (espace) ou les PTT (télécommunications pour l’électronique). En effet, la similarité des exigences technologiques civiles et militaires, qui était un fait dans les années 1940 et 1950, est peu à peu remise en cause par le développement des performances et des coûts de la recherche stratégique au début des années 1960, qui ne sont plus en rapport avec les besoins et les moyens de l’aviation civile50. Cette dernière est peu à peu aspirée vers la conquête d’un marché plus large et le souci de la rentabilité. Les années 1960 voient également en Europe les débuts d’une stratégie de coopération européenne, qui commence par le secteur privé, par exemple chez Dassault qui collabore avec SABCA, Fokker, Fiat et Dornier. Ces rapprochements correspondent aux débuts du Concorde, lancé en 1962, qui vise à casser le monopole américain sur les longs courriers. Dans le secteur strictement militaire se mettent également en place des projets plurinationaux, comme ceux des avions de chasse Tornado (Italie, RFA, Royaume-Uni) ou de l’avion de transport franco-allemand Transall51.
Il y a donc bien une prise de conscience de la nécessité d’homogénéiser l’offre européenne afin d’obtenir la taille optimale pour le marché mondial, mais aucun des gouvernements ne renonce à faire cavalier seul. Chacun espère d’abord obtenir pour soi des transferts de technologie américain, ce qui rend impossible la constitution d’un véritable groupe multinational européen de l’aéronautique.
3. 2. Constat du retard
La prise de conscience des lacunes dans le secteur aéronautique n’est pourtant pas si récente. Dès le rapport Spaak constitué à la veille de la constitution de la CEE, le ministre des Affaires étrangères belge s’inquiétait des lacunes économiques européennes, et celui-ci citait parmi les exemples de « ce que signifie, face aux possibilités du monde moderne, le cloisonnement européen des marchés » l’incapacité pour « aucun des pays du continent de construire de grands avions de transport sans apports extérieurs52 ». Mieux, la dernière partie du rapport indiquait trois secteurs prioritaires que devait favoriser le Marché commun : il s’agissait de l’énergie, des postes et télécommunications et des transports aériens, auxquels on liait l’industrie de construction aéronautique53.
Ces projections n’aboutissent pas immédiatement, mais peu à peu le besoin d’une collaboration se fait sentir, qui ne résulte pas forcément d’une conscience européenne mais de la peur d’une hégémonie américaine, de plus en plus choquante au travers des statistiques : entre 1958 et 1985, les entreprises américaines ont ainsi représenté 83 % du marché des avions à réaction, dont plus de la moitié pour Boeing. Dans cette optique, un rapprochement entre avionneurs européens apparaît comme la « meilleure option54 ». Faire un grand marché permettant de réduire les coûts est par ailleurs un exemple porté par les Américains eux-mêmes, à l’échelle de leur vaste pays. La « panique de Spoutnik55 » fouette dans le même temps les grands programmes technologiques des pays occidentaux, inquiets des avancées de la recherche et de la technologie soviétiques, même si les Européens sont bien incapables de relever le défi dans le secteur spatial.
Il se trouve que l’aéronautique est à ce moment-là prise dans un développement accéléré de ses structures et de ses ambitions. La pression est en effet lourde sur l’aviation civile, au nom du toujours plus vite (c’est l’ère supersonique), du toujours plus près (avec le développement des avions à atterrissage ou décollage court pour se rapprocher du cœur des villes) et du toujours plus gros (il s’agit d’assurer un transport de masse au meilleur marché possible). Or, le retard est dramatique dans le secteur des longs courriers, particulièrement concerné par ces évolutions. Il y a eu jusqu’ici monopole américain dans ce domaine où se sont succédées les plus grandes réussites : Douglas avec son DC4 puis DC6, Lockheed avec son Constellation puis Super Constellation, et plus récemment Boeing et son 707 ainsi que Douglas et le DC8. Il est vrai que, dans les moyens courriers, les Européens ont connu quelques demi-succès, comme le Trident et le BAC 111 pour les Britanniques, le Fokker F-27 ou la Caravelle. Ce dernier modèle a même eu une certaine réussite, mais qui est restée fragile car le marché des avions suppose une adaptation permanente et coûteuse indispensable à la carrière commerciale d’un appareil, ce que peuvent se permettre les Américains mais pas les Européens.
3. 3. Le passage à l’acte
C’est cette prise de conscience, facilitée par les débats d’opinion et un contexte économique en plein retournement, qui favorise les débuts d’une coopération plus ambitieuse. L’entente se fait autour de la construction en commun d’un avion à rayon d’action moyen, à la base du projet Airbus A300, qu’il reste à mettre sur les rails. Dès le début des années 1960, Anglais et Français y travaillent, bientôt rejoints par les Allemands (1966). Le 26 septembre 1967 à Londres, les trois ministres des Transports allemand, britannique et français signent un protocole d’accord destiné à préparer le lancement d’un avion gros-porteur européen56.
Les difficultés commencent alors et tournent autour du moteur : les Britanniques devaient le construire dans les usines Rolls Royce, mais l’entreprise entend courir plusieurs lièvres à la fois en produisant en parallèle un moteur pour l’Américain Lockheed. Après maintes péripéties (et l’envol des conditions tarifaires de l’entreprise britannique), Londres se retire du projet en mars 1969 et celui-ci devient réellement franco-allemand : Jean Chamant, ministre français des Transports, et Karl Schiller, le ministre fédéral de l’Économie, portent alors Airbus sur les fonts baptismaux, le 29 mai 1969 lors du Salon du Bourget, flanqués par les industriels Bernhardt Weinhardt (Deutsche Airbus) et Henri Ziegler (Sud-Aviation). L’originalité de l’organisation repose sur la décision qu’il n’y aura qu’une seule chaîne de montage, à Toulouse, et sur la volonté de rationalisation de la production, répartie par nations : les différents éléments de chaque avion (carlingue, cockpit, ailes, empennage…), fabriqués dans les pays contractants, seront ensuite acheminés dans la Ville rose pour l’assemblage final.
Cette organisation s’applique également en matière de gouvernance. Le Concorde pâtissait de sa gestion difficile, liée à la nature purement interétatique du projet, aboutissant à la constitution d’une direction bicéphale franco-britannique, elle-même assistée de trois comités directeurs (avions, moteurs et gestion) dirigés par une présidence tournante. Pour éviter cette structure propre à l’enlisement, Airbus doit trouver un autre modèle. Une formule originale, entre association et société anonyme, est ainsi adoptée avec la constitution d’un « groupement d’intérêt économique » (GIE), qui vise à favoriser la coopération entre entreprises cherchant à accroître leur puissance tout en gardant leur autonomie et leur souplesse. Les statuts à l’origine du consortium Airbus-Industrie sont ainsi déposés le 18 décembre 1970, concrétisant un compromis entre industriels, qui gardent l’initiative, États qui ont le contrôle par le biais des fonds publics engagés, et cadre européen, puisqu’Airbus est bien d’entrée une entreprise plurinationale.
Les clés de la réussite sont donc en place dès le départ – même si le succès n’est pas immédiat –, et résultent de plusieurs facteurs : la combinaison de secteurs européens déjà excellents ; le triomphe de la norme commerciale sur le modèle de l’arsenal, qui a montré ses limites avec le projet Concorde ; la concentration sur un objectif simple et ne se compliquant pas de visées technologiques trop ambitieuses. Les États, quant à eux, acceptent de franchir le pas, non pour des raisons européennes mais mondiales, résultat de leur prise de conscience des enjeux imposés par les principes d’une économie ouverte. Il ne s’agit pas pour eux de brader leur souveraineté mais de se montrer stratèges (lâcher la bride aux entreprises pour en tirer le meilleur parti) et pratiques (se situer à l’échelle adéquate), soutenus en cela par la « république des ingénieurs57 » de part et d’autre des frontières.
Certes, le groupement est intergouvernemental et n’arrive pas à transformer l’idée d’un Marché commun de l’aéronautique58, mais il donne à l’Europe les bases de son autonomie scientifique, technologique et industrielle dans un domaine où elle a été pionnière. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les mots de Bernard Esambert, pour qui Airbus est un « projet européen, mais non communautaire59 ».
Conclusion
Avant 1980, Airbus n’a pas vraiment de programme misant sur l’intégration, car ce sont des intérêts nationaux qui ont présidé à sa naissance, mais l’architecture particulière de l’avionneur lui permet d’échapper au cadre franco-allemand et d’acquérir peu à peu ses galons d’entreprise européenne. C’est d’ailleurs la pression des rationalisations qui remet en question la structure du consortium. Le 10 juillet 2000, le GIE est dissous et laisse place à une « société européenne » à part entière, intégrée au sein d’EADS (European Aeronautic Defence and Space Company).
Airbus, entre fusion et association, ne permet pas de conclure à la pureté d’un modèle, mais pourrait être l’illustration de ce que Luuk van Middelaar appelle la « sphère intermédiaire » européenne, celle qui, au fond, a permis les plus grandes avancées en dehors de tout cadre théorique contraignant60. Cette sphère se situe entre ce qu’il nomme la « sphère interne » qui, s’appuyant sur les traités fondateurs, est animée par les institutions communautaires, et la « sphère externe », celle des nations membres de l’UE, dont la légitimité est diplomatique et le mode d’action celui du marchandage. Airbus est la concrétisation de la progression que permet cette « sphère intermédiaire », dont les acteurs restent les États, mais agissant en tant qu’adhérents à un « cercle de membres » où les marchandages ont laissé place à de véritables échanges et à une responsabilité partagée. En ce sens, l’histoire d’Airbus démontre que « la coproduction des avions en Europe ne passe pas à côté de l’intégration européenne […] Elle la croise bel et bien61 ».
Ainsi, l’industrie européenne d’aujourd’hui doit beaucoup aux efforts menés au carrefour des années 1960-1970 dans des domaines précis : Airbus pour l’aéronautique, mais aussi Ariane pour l’aérospatial, aujourd’hui des espaces européens d’indépendance. Dans ces domaines, il a été démontré la réussite globale du passage d’un modèle national, portant des programmes liés directement ou indirectement au militaire, à un modèle plus intégré qui s’appuie sur l’Europe en construction. L’important est la coordination : il ne s’agit pas de déterminer une stratégie globale unique, mais de faire en sorte que des stratégies différentes se connectent pour produire mieux et plus. C’est le plus beau compliment que l’on puisse faire à Airbus, et peut-être une préfiguration de la manière dont l’Europe peut se réaliser sans passer par un fédéralisme plus théorique que pratique.