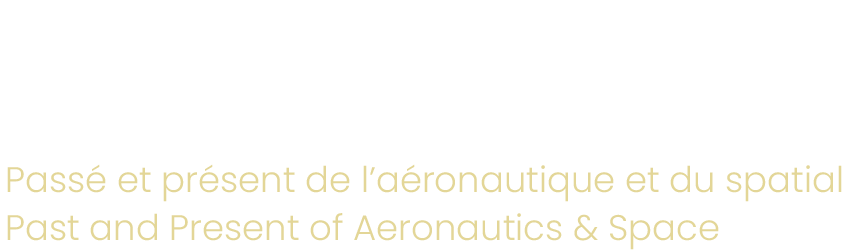L’émergence d’un domaine de recherche centré sur les questions spatiales1 s’organise en France, au lendemain de la guerre, à partir des laboratoires militaires et de quelques laboratoires de physique, comme celui d’Yves Rocard à l’École Normale Supérieure. Ce sont tout d’abord les initiatives militaires qui ont organisé les recherches sur l’espace : le Ministère de l’Air a ainsi développé 35 programmes de 1938 à 1959.
Toutefois, le déploiement d’une politique nationale concertée, axée sur l’exploration scientifique de l’espace, est lié à la création du Centre National d’Études Spatiales (CNES). Prévue par les gouvernements de la IVe République, puis mise en œuvre sous la Ve République, cette institution est chargée d’organiser, de financer et d’orienter les recherches scientifiques. Le CNES est donc associé à une série de laboratoires déjà existants (comme le Service d’Aéronomie, le Service d’Électronique Physique du Commissariat à l’Énergie Atomique [CEA]2 …) ou dont il suscite la création en province. Dans cet article, je propose de saisir plus précisément les processus politiques, scientifiques et économiques qui ont permis l’implantation, la création et/ou le transfert en province de structures scientifiques centrées sur le spatial : le complexe spatial toulousain, le Laboratoire d’Astrophysique Spatiale de Marseille et le Groupe de Recherches Ionosphériques à Orléans. Ces trois ensembles rassemblent des caractéristiques d’implantation très différentes ; en les comparant, il est possible de saisir une gamme étendue de structurations des activités spatiales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour chacune de ces opérations, nous dégagerons les grandes lignes des logiques territoriales à l’œuvre et nous envisagerons leur inscription dans le mouvement décentralisateur d’après-guerre. L’enjeu est de saisir comment une géographie des laboratoires spatiaux s’est élaborée. Selon quels critères s’est-elle mise en place ? En suivant quels cadres politiques et scientifiques a-t-elle été imaginée ?
Il s’agit ici d’étendre les propositions tirées du geographic turn qu’ont connu les Science and Technology Studies depuis les années 19903. En insistant sur la matérialité des lieux, la distribution des dispositifs de connaissance et la circulation des savoirs, un certain nombre d’historiens et de sociologues des sciences ont transformé la saisie géographique des manières de connaître. Ce tournant géographique est aujourd’hui plus général, puisqu’il ne concerne plus seulement la spatialité intrinsèque des lieux de sciences, mais l’ensemble des mobilités et des fixations topographiques qui organisent désormais l’activité scientifique.
J’envisagerai ici de croiser ces approches en termes de géographie des lieux de science, et celles interrogeant les logiques politiques d’aménagement du territoire. Les activités de recherche spatiale ont été localisées, sur la carte nationale des potentialités scientifiques, selon des modalités, des rythmes et des enjeux d’administration publique fort différents.
J’ai mobilisé, pour cette étude, trois types de sources complémentaires : les archives du CNRS qui rendent compte des différentes décisions pour la localisation et la translation des laboratoires ; les archives départementales de la Haute-Garonne qui rassemblent les documents relatifs à l’implantation du CNES à Toulouse ; et des archives ministérielles qui informent des discussions politiques présidant à l’aménagement du territoire.
1. La décentralisation du CNES à Toulouse : le poids des logiques locales
Pour saisir les logiques territoriales de distribution des compétences spatiales, telles qu’elles opèrent dans le cas de la décentralisation du CNES à Toulouse, il convient de restituer les travaux d’aménagement de l’espace national entrepris sous la IVe République et poursuivis au début de la Ve République4. Une série de lois et de décrets en 1954 et 1955 fournissent la trame législative d’une décentralisation concertée avec les régions d’accueil d’un certain nombre de structures scientifiques (sans toutefois que celles-ci soient sous-citées)5. Surtout, l’accent est mis sur une dialectique « local/national », qui doit permettre aux autorités régionales (préfets, comités d’expansion économique, conseils généraux) de participer aux processus d’aménagement du territoire. Les administrations gaullistes de la Ve République reprennent la question de l’aménagement du territoire en la modelant aux formes d’un idéal planificateur6. De nouvelles structures sont chargées de coordonner les actions à tous les échelons du territoire : le Comité Interministériel à l’Aménagement du Territoire (CIAT) mis en place en 1960 ; la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT), installée au sein du Commissariat Général au Plan en 1963 ; et enfin la Direction à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR), créée par le décret du 14 février 19637. C’est à l’intérieur de ce cadre politique et économique qu’est peu à peu décidé le transfert du CNES à Toulouse.
À la suite de la mise en place, en 1954, des Comités d’expansion économique destinés à densifier les relations entre les acteurs économiques locaux, le préfet de la Haute-Garonne, également Inspecteur Général de l’Administration en Mission Exceptionnelle, Émile Pelletier, produit en mars1954 un rapport sur l’activité économique du département. Il décrit une situation difficile entre asphyxie des entreprises, faiblesse des industries, prégnance du secteur agricole et chômage endémique8. Dans une lettre au ministre de l’Industrie le 12 juillet 1954, Pelletier souhaite éclairer « le gouvernement sur la situation économique » de la région et suggère que l’État soutienne « les efforts locaux » d’un territoire « qui risque de se détériorer plus gravement si des remèdes n’y sont pas prochainement apportés »9. Le préfet saisit très rapidement l’opportunité qui semble se dessiner dans les cabinets ministériels d’un possible transfert de certaines activités économiques parisiennes. Il réclame « une décentralisation des centres industriels vitaux » et rappelle que plusieurs Conseils Généraux de la région « ont émis le vœu de voir installer dans le Sud-Ouest une pile atomique ou un Centre de Recherches Nucléaires ». Il insiste sur le fait que « la présence à Toulouse d’établissements d’enseignement supérieur »10 faciliterait cette implantation. La décentralisation et l’aménagement du territoire apparaissent donc comme une occasion de revitaliser une région aux faiblesses économiques patentes. Surtout, le préfet Pelletier imagine de créer des « formules nouvelles », proches par exemple de la Tennessee Valley Authority11. Il décide de réunir et de faire travailler ensemble les différents acteurs de la vie économique locale afin de transmettre quelques propositions au gouvernement. Le 9 décembre 1954, il réunit à la préfecture les préfets et les présidents des chambres de commerce de la cinquième région administrative (qui correspond à la défunte région Midi-Pyrénées, étendue aux départements des Landes, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales). Pelletier insiste pour que des Comités d’Expansion Économique soient créés le plus rapidement possible et précise que la région doit « bénéficier de [la] décentralisation (…) ». Il insiste enfin, auprès de ses interlocuteurs, pour trouver le modus operandi dans les relations entre les différents acteurs :
Je pense que s’il y a une articulation à établir (…) entre les devoirs qui sont ceux de l’État, ceux des hauts-fonctionnaires représentant l’État dans chaque province et ceux incombant aux initiatives professionnelles, eh bien, tout cela doit se faire étroitement et délibérément d’abord dans le cadre de Régions économiques et de vos Chambres de Commerce12.
Si les activités centrées sur le nucléaire retenaient jusque-là l’attention du préfet et des acteurs économiques, elles sont peu à peu remplacées, dans l’ordre des priorités, par les questions aéronautiques. Toulouse dispose, depuis l’entre-deux guerre, d’entreprises (Bréguet, Latécoère, Dewoitine) inscrites dans ce secteur. Dans l’avant-projet de programme d’action pour la région de Toulouse, la référence à une « décentralisation (…) d’usines aéronautiques effectuées à la veille de la dernière guerre » dans le Sud-ouest ainsi que la présence d’une école technique d’aéronautique permettent de réclamer « le transfert dans cette ville, et plus généralement dans la région, d’organismes d’études et de recherches, de centres d’essais et d’établissements d’enseignement spécialisés13 ».
1.1 Point de bascule
Ces demandes restent vagues et n’indiquent rien de plus que la volonté de renforcer un domaine industriel déjà existant. En revanche, trois ans plus tard, en février 1958, dans le plan d’action régionale, qui résulte des réflexions concertées des fonctionnaires et agents économiques de la région, l’industrie aéronautique est présentée comme un « des éléments fondamentaux de l’industrie de la région toulousaine ». Le rôle même de Toulouse dans un plan d’aménagement du territoire beaucoup large est désormais clairement défini. La ville doit devenir « une de ces grandes capitales régionales » qui fera « contrepoids à l’influence tentaculaire de la centralisation parisienne »14. Ce discours appelle la constitution d’une grandeur toulousaine – cette grandeur civique, identifiée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot qui offre un horizon d’attente structuré autour du bien commun15. La ville, jusqu’ici ignorée, à l’écart des grands axes et trop faiblement industrialisée, doit devenir une métropole régionale conséquente. C’est autour de ce principe civique supérieur que doit s’organiser l’action des fonctionnaires, des responsables sociaux et économiques (syndicats, chambres de commerce et industriels…). Dès lors, les opérations de décentralisation qui vont suivre s’inscrivent dans cette constitution d’une grandeur toulousaine régionale. Le plan régional de 1958 précise : « La vocation aéronautique de Toulouse doit permettre de considérer avec faveur le transfert dans cette ville de l’École supérieure de l’aéronautique, dans le cadre de la décentralisation des établissements scientifiques et technique d’État prescrite par l’un des décrets du 10 juin 1955 »16. Les transferts de l’École Nationale Supérieure d’Aéronautique (ENSA) et de l’École Nationale d’Aviation Civile (ENAC) ont été discutés directement avec le Premier ministre de l’époque, Michel Debré, dès le mois de novembre 195817.
Il est difficile de saisir comment l’on a pu passer, après quelques tâtonnements autour de la recherche nucléaire, à l’affirmation une vocation aéronautique affirmée, doublée d’une décentralisation effective de deux grandes écoles parisiennes. Le mythe de Toulouse comme capitale aéronautique a été, semble-t-il, volontairement mis en œuvre par les services de la préfecture18. Le responsable du service économique, François Laffont, explique ainsi :
Nous avons parlé des vertus de Toulouse au niveau de l’aérospatiale (…) nous avons glissé dans le préambule (…) du programme qu’il serait important (…) que le gouvernement octroie à Toulouse (...) la vocation [de] capitale de l’aviation française (…). Pour réaliser cette vocation sur le terrain [il fallait] créer un élément moteur qui serait [un] complexe scientifique autour (…) de la nouvelle faculté des sciences. (…) La chimie et le gaz de Lacq nous échappaient (…) donc il restait l’aéronautique. Mais nous restions très en retrait par rapport à Marseille, Bordeaux ou Saint-Nazaire.
Nous avons dit « Nous allons faire jouer les sentiments. Nous allons nous accrocher à ce mythe de Toulouse, à cette épopée : Mermoz, Saint-Exupéry, Didier Daurat (…) et nous allons introduire dans le programme la reconnaissance de Toulouse comme capitale de l’aéronautique »19.
La construction d’un récitatif politique autour de la vocation aéronautique de Toulouse vient soutenir le travail de la préfecture pour obtenir des instances de l’aménagement du territoire qu’elles accueillent avec faveur le projet, pour la ville, d’occuper une position plus avantageuse dans l’espace national. Si les décrets de 1954 et 1955 ont offert des opportunités pour les villes de province d’obtenir le transfert d’industries, de structures d’enseignement supérieur et de centres de recherche, il n’a pas suffi de les saisir ou de se porter candidat20. La mobilisation du mythe vient redoubler la rhétorique sur l’indispensable grandeur de Toulouse. Il convient de remarquer que l’opération sera facilitée par le fait qu’en 1958 François Laffont quitte la préfecture pour rejoindre la mairie en tant que secrétaire général et que le préfet, Émile Pelletier, devient ministre de l’intérieur du gouvernement nouvellement mis en place21. L’articulation entre les administrations parisiennes et provinciales s’opère donc également par des transferts de compétences et d’individus qui poursuivent, au-delà de leurs propres fonctions, les actions engagées précédemment.
1.2 L’agrégation décentralisatrice
La décentralisation de l’ENSA et de l’ENAC est longue et illustre la difficulté du processus de transfert de ces institutions prestigieuses. Les réticences sont nombreuses, de la part des administrateurs des écoles notamment, qui redoutent un contexte toulousain moins favorable pour la qualité de leur enseignement comme pour leur reconnaissance. Le délégué ministériel pour l’armement chargé, en 1962, d’examiner les conditions de réalisation du transfert, se montre très critique. Il explique que « l’étude de l’implantation d’une nouvelle École de formation d’Ingénieurs de l’Aéronautique hors du contexte scientifique, technique et industriel de la région parisienne pose (…) des problèmes difficiles qu’il faut envisager dans leur ensemble en raison de leurs interactions mutuelles »22. Les ressources locales et les compétences professorales paraissent insuffisantes à l’administration de tutelle de l’École23. L’éloignement de la capitale amoindrirait le prestige des institutions jusque-là parisiennes. L’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées chargé de superviser les possibilités de transfert de l’ENAC saisit parfaitement l’importance de ces décentralisations pour le gouvernement en notant qu’il s’agit d’une « puissante incitation psychologique »24. Le Premier ministre confirme, dans une lettre au préfet de Haute-Garonne du 28 septembre 1960 qu’il s’agit bien d’un geste fort pour engager un processus plus vaste d’aménagement du territoire. Il y a, assure-t-il, une « urgence des problèmes de décentralisation » et les demandes qu’il a adressées aux ministres des Travaux Publics et de l’Armée (qui sont les tutelles de l’ENAC et de l’ENSA) visent à « prendre quelques décisions exemplaires »25. Tout le travail du préfet consiste donc à tempérer les inquiétudes des écoles parisiennes et à offrir des garanties sur la qualité de l’environnement intellectuel et matériel qu’elles trouveront à Toulouse. Lors des réunions préparatoires en 1961 et 1962, les responsables de la préfecture précisent qu’il n’y aura pas de « baisse de niveau et de réputation de l’ENSA ». Les synergies qui se créeront avec l’Université permettront de « faire de Toulouse la capitale de la recherche aéronautique »26. Le transfert de l’École participe de la (future) distinction toulousaine ; l’ENSA bénéficiera donc de la spécificité et de l’originalité d’une ville totalement orientée vers l’aéronautique. En décembre 1961 le Conseil interministériel à l’Aménagement du Territoire a confirmé le transfert de l’École. Le préfet rassure les responsables de l’ENSA :
Des garanties ont également été demandées afin que soit réalisée une politique générale de décentralisation des grandes Écoles, le transfert de l’ENSA ne devant pas rester une opération isolée (…). La décentralisation à Toulouse de l’Office National d’Études et de Recherches Aéronautiques (ONERA) serait très favorable à la décentralisation de l’ENSA27.
L’administration préfectorale a donc mis en œuvre une politique d’agrégation décentralisatrice qui doit permettre d’assurer le transfert de l’ENSA et de l’ENAC tout en poursuivant l’idéal d’une grandeur toulousaine centrée sur l’aéronautique. Cette stratégie est payante puisque le 31 juillet 1963, le Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire confirme les transferts de l’ENSA et de l’ENAC, décide la création, à Toulouse, en lien avec le CNRS, de laboratoires spécialisés dans les recherches spatiales (comme le Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements) et demande la décentralisation du Centre Technique du CNES28. À sa création, le CNES installe son siège à Paris (rue de l’Université) et sa Direction Scientifique et Technique à Brétigny-sur-Orge, près de l’aérodrome militaire et du Centre d’Essais en vol. Après le déplacement du Centre Technique, ce sont les services des fusées-sondes (septembre 1968) puis les activités ballons (à l’automne 1969) et des satellites (de 1971 à 1973) qui complètent une décentralisation très étalée dans le temps. Les transferts d’une partie du CNES, de l’ENSA, de l’ENAC et de certains éléments de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) ainsi que la création de nouveaux laboratoires (le Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements, le Laboratoire d’Automatique et de ses Applications Spatiales [LAAS] en 1968) résultent d’une patiente construction d’une orientation scientifique toulousaine vers le spatial. Lorsque le nouveau préfet, Roger Moris, tente de convaincre, en 1964, le Président de la Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil de s’impliquer dans le développement local, il insiste sur le procès de décentralisation en cours : « À bref délai, la ville de Toulouse va ainsi bénéficier de la présence de plusieurs milliers de professeurs, [d’] ingénieurs, [de] chercheurs et [d’] étudiants qui vont en faire un centre scientifique capable de rivaliser avec la région parisienne »29. Le préfet met en exergue le renversement d’un rapport de force territorial qui fait de Toulouse l’équivalent –pour l’espace– de la capitale.
Ainsi, la logique territoriale ici à l’œuvre repose à la fois sur une dynamique locale exploitant les possibles offerts par une législation favorable aux rééquilibrages des potentialités économiques et scientifiques de l’espace national, et sur l’effet de « masse critique » qu’un transfert conjugué de plusieurs structures peut avoir pour une région.
2. Le Laboratoire d’Astronomie Spatiale de Marseille : l’extension d’une logique scientifique
La création du Laboratoire d’Astronomie Spatiale de Marseille (LAM) est liée au parcours de son premier directeur, Georges Courtès. Ce dernier, après avoir mené des études de physique à Montpellier, est dirigé, par un de ses enseignants, vers les observatoires de Marseille et de Haute-Provence que dirige Charles Fehrenbach30. Il y effectue sa thèse et ses premiers travaux, en tant qu’aide-astronome, sur la matière interstellaire des galaxies au début des années 195031. Fehrenbach, de son côté est très « intéressé par les premières expérimentations spatiales »32 menées aux États-Unis et en URSS. Courtès envisage des recherches dans le domaine spatial qui puissent prolonger les premiers résultats obtenus dans l’étude de l’émission de gaz (principalement l’hydrogène) dans les galaxies33. La principale difficulté à laquelle il se heurte concerne la sensibilité insuffisante des mesures au sol.
L’observatoire de Marseille ne dispose d’aucun équipement particulier pour mener des expériences spatiales et ce domaine reste, à la fin des années 1950, très embryonnaire en France. Jacques Blamont, qui a travaillé à l’Observatoire de Haute-Provence (où il a rencontré Courtès) dirige le Service d’Aéronomie installé en région parisienne. Ce laboratoire s’est très tôt thématiquement orienté vers le spatial. Blamont a mené, au sein de l’Observatoire de Haute-Provence où il disposait d’une instrumentation rudimentaire, des « recherches photométriques et spectroscopiques sur la lumière du ciel nocturne et les émissions crépusculaires (…) »34. Surtout, le développement rapide du Service d’Aéronomie (avec un accroissement massif du nombre de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens) à la fin des années 1950 permet à Blamont d’envisager le lancement d’expériences spatiales hors de l’atmosphère. Le Comité d’Action Scientifique de la Défense Nationale propose, pour l’année 1958, une série de tirs de la fusée Véronique (le premier eut lieu le 7 mars 1959). Georges Courtès est directement associé aux études que Blamont développe sur les caractéristiques physiques des différentes couches de l’atmosphère35. L’instrumentation qu’il a mise au point pour l’étude de l’hydrogène (i.e. réseau-filtre à bandes passantes multiples) est ici directement réexploitée36.
Le positionnement de Courtès au sein de l’observatoire de Marseille est original : il travaille sur les compositions des galaxies en développant une instrumentation novatrice (avec la mise au point d’un filtre-réseau à bandes passantes) et participe, dans le même temps, aux premières expériences spatiales qui se déroulent en dehors de l’observatoire. C’est en joignant ces deux types de pratiques que lui-même et un petit nombre de chercheurs imposent l’idée d’un laboratoire d’astronomie spatiale au sein même de l’Observatoire de Marseille37. En effet, les premiers résultats obtenus convainquent le doyen de la Faculté des Sciences, Rouard, d’octroyer un laboratoire à la jeune équipe. Mais les dimensions de cette structure sont trop modestes pour envisager de déployer des projets spatiaux d’envergure impliquant un personnel plus nombreux et du matériel plus important. Les liens noués avec Jacques Blamont, devenu au milieu des années 1960 directeur scientifique et technique du CNES, permettent d’accélérer l’institutionnalisation du Laboratoire d’Astronomie Spatiale de Marseille (LAM).
Officiellement créée en 1965, cette structure s’installe dans la banlieue de Marseille dans de vastes locaux38. La logique d’implantation ici à l’œuvre ne s’appuie guère sur les ressources locales. Courtès travaille avec le Service d’Aéronomie, situé en région parisienne, et l’implantation de son laboratoire semble faire abstraction de l’ancrage territorial du laboratoire. Toutefois, les premiers comités de direction mettent en lumière la difficile articulation entre une logique scientifique élaborée à partir d’un réseau de relations s’étendant hors de la région phocéenne et une insertion géographique indispensable, en termes de recrutement et d’échanges industriels, pour un laboratoire de recherches spatiales.
La mobilisation d’un personnel compétent constitue un problème permanent dans les premières années du LAM. Courtès indique, en 1968, que l’« absence de technologie élevée dans la région marseillaise (…) »39 complique l’intégration de techniciens disposant d’une connaissance suffisante des spécificités du spatial. La Faculté des Sciences ne dispose pas d’une filière particulière qui serait centrée sur le domaine spatial. De plus, Courtès souhaite employer « des techniciens ayant déjà une expérience professionnelle (…) ». Il précise que les techniciens « ayant commencé leur carrière dans le Laboratoire n’ont pas acquis le peu d’efficacité indispensable en recherche spatiale »40. Le recrutement des ingénieurs est tout aussi problématique. En 1971, Courtès constate que la jonction entre « le schéma proposé par les chercheurs et la réalisation en laboratoire ou en sous-traitance des instruments définitifs » nécessite un personnel spécifique capable d’articuler les champs de compétences scientifiques et industrielles. Il déplore de ne pouvoir recruter des ingénieurs capables de pallier, à ce niveau, « certaines insuffisances du Laboratoire »41.
Le LAM est faiblement arrimé au tissu économique local. Il ne parvient que très difficilement à nouer des relations avec les entreprises phocéennes. En 1972, le directeur souligne que les « industriels n’ont pas encore acquis les compétences suffisantes pour assumer la conception, la responsabilité et la réalisation d’expériences scientifiques (…) »42. Deux ans plus tard, le comité de direction du laboratoire note que les problèmes avec les sous-traitants locaux sont nombreux et plusieurs membres fustigent « l’incompétence de certains industriels »43. En d’autres termes, l’articulation « recherches spatiales-industrie » a constitué davantage une difficulté qu’une opportunité pour le LAS.
La création du LAM semble en effet abstraite des problématiques d’aménagement du territoire. Les archives concernant la régionalisation du Ve Plan indiquent, au moment de la création du LAM au milieu des années 1960, que la composante spatiale ne constitue pas un axe majeur pour appuyer une politique scientifique territoriale spécifique. La Délégation générale à Recherche Scientifique et Technique note, en suivant les conclusions du groupe de travail de la région Provence – Côte d’Azur – Corse qu’il « importe de mettre l’accent sur deux directions de recherche (…) celle du pétrole et de la pétroléochimie, et celle de l’atome (…) »44. À la différence de la région toulousaine, la zone provençale n’est pas programmée, par les instances scientifiques nationales, pour développer une vocation spatiale. La période dans laquelle le projet de laboratoire spatial est créé à Marseille correspond en outre à une remise en cause des dynamiques planificatrices qui caractérisait les précédentes opérations de rééquilibrage du territoire. L’Observatoire de Haute-Provence travaille cependant sur les satellites D-1C et D-1D (Diadème I et II) dès janvier 1965, et l’Observatoire de Nice sur D-1A Diapason en 1966 et les Diadème en 1967.
Le positionnement du laboratoire marseillais n’est en rien comparable aux autres institutions spatiales. Né au sein de l’Observatoire de Marseille, il conserve avec ce dernier des liens puissants. Georges Courtès assure en 1968, qu’il continue de passer « la moitié de son temps à l’Observatoire de Marseille car il n’est pas question pour lui d’abandonner son activité dans le domaine de l’Astronomie »45. Le Laboratoire est d’ailleurs encouragé à plusieurs reprises, au début des années 1970, par les dirigeants du CNES, à poursuivre des collaborations régulières avec les autres laboratoires de l’Observatoire marseillais. Cet adossement à une structure scientifique inscrite dans le champ disciplinaire de l’astronomie permet, d’une certaine manière, de forcer à la création de réseaux d’échanges locaux. Toutefois, c’est bien avec les autres laboratoires spatiaux (qu’ils soient français ou étrangers) que le LAM poursuit les collaborations les plus denses et les plus fécondes46. Né d’une association conjoncturelle avec le Service d’Aéronomie, il se construit donc à l’écart des politiques d’aménagement du territoire. Le relatif isolement dans lequel le place cette genèse atypique est contrebalancé par l’adossement à l’Observatoire de Marseille, structure matricielle et référent local principal.
3. Une décentralisation partielle : le Groupe de Recherches Ionosphériques à Orléans
Le Groupe de Recherches Ionosphériques illustre à la fois les modes de structuration de la recherche scientifique d’après-guerre, le souci d’un rééquilibrage volontariste des potentialités géographiques nationales et le rôle important que jouent les élus politiques locaux dans les mouvements d’aménagement du territoire. Le Groupe de Recherches Ionosphériques (GRI) est créé en 1961 à partir du Groupe Ionosphère de Bagneux. Il est d’abord installé à Issy-les-Moulineaux, puis à Saint-Maur. Son transfert partiel à Orléans participe d’une double dynamique. D’une part, le CNRS se montre sensible, dans les années 1960, aux recommandations du Plan visant à une déconcentration des potentialités de recherche fortement implantées à Paris. Dès 1962, Jean Coulomb, directeur général du CNRS exprime le « souhait de développer des unités de recherche en province »47. D’autre part le maire d’Orléans, Roger Secrétain, mène une véritable campagne pour attirer dans sa ville des structures scientifiques.
La cité ligérienne est en effet dans l’aire d’attraction parisienne et peine à se distinguer des autres villes de la grande couronne parisienne48. Il souhaite adjoindre à sa ville un « Oxford français »49, un nouveau quartier fonctionnant comme une « ville jumelle » d’Orléans et centrée sur « la fonction universitaire »50. En 1960, la municipalité acquiert le domaine de la Source en 1959 et celui de Concyr en 1962. Roger Secrétain mobilise Pierre Sudreau, ministre de l’Éducation nationale qui soutient le « projet d’aménagement de la ville universitaire (…) »51. Le maire d’Orléans valorise son projet lors d’une importante réunion à Paris rassemblant notamment Maurice Bokanowski, ministre de l’Industrie et du Commerce, Paul Delouvrier, Commissaire Général du District de Paris et le géographe Jean-François Gravier52. Secrétain défend « un modèle d’organisation administrative fédérale, [et] vante la décentralisation universitaire (…) »53. Il s’inscrit alors totalement dans le mouvement de décentralisation du milieu des années 1960 qui voit l’État axer ses efforts aménageurs sur le rayonnement des villes de province54 à travers notamment le programme des métropoles d’équilibre55.
À partir de la deuxième moitié des années 1960, on y redistribue géographiquement une série de laboratoires jusqu’ici ancrés à Paris et dans la région parisienne. Le GRI est le quatrième laboratoire à s’implanter sur le campus orléanais. Le souhait des responsables du CNRS (notamment W. Mercouroff, directeur général) est de renforcer la composante géologique du GRI dans une Académie universitaire que les planificateurs veulent vouer à la géologie56. Les difficultés matérielles et cognitives sont nombreuses. Une partie des chercheurs ne souhaite pas quitter Saint-Maur. Le déplacement d’une partie du GRI à Orléans apparaît donc comme un compromis témoignant d’une césure profonde au sein du laboratoire. Dès 1969, l’interruption des recrutements au CNRS met à l’épreuve l’équilibre fragile d’une déconcentration partielle. Le directeur du GRI, J. Hiéblot indique qu’« une partie du personnel tant chercheur que technicien avait pris des dispositions personnelles pour vivre à Orléans et s’intégrer au complexe d’Orléans-La Source ». Il évoque même le cas d’un « chargé de recherche [du laboratoire] qui démissionna du CNRS pour prendre un poste de maître-assistant à Orléans et y résider (…) »57. Hiéblot fait remarquer au Recteur de l’Académie que le blocage des postes permettra aux sceptiques restés à Saint-Maur de se présenter « comme la preuve vivante de l’impossibilité d’une décentralisation réelle en recherche scientifique »58. Hiéblot souhaite que les efforts consentis par certains membres de son laboratoire ne soient pas vains et que la décentralisation soit effective afin que les opposants n’y voient pas une occasion supplémentaire de justifier leur refus. Les autorités politiques font de la venue d’une partie du GRI à Orléans un emblème de reterritorialisation des potentialités scientifiques. Le Recteur de l’Académie d’Orléans indique à Hieblot, en 1968, que « le risque d’échec d’une importante opération de décentralisation »59 est pris au sérieux.
Le directeur général du CNRS, Mercouroff, prend acte de la tension géographique qui traverse le GRI. Il s’efforce, lorsqu’il le peut, de favoriser le site orléanais. Il indique, en 1973 que le CNRS ne souhaite pas renforcer l’équipement de Saint-Maur. Il compte même accélérer le transfert de nouvelles activités de Saint-Maur à Orléans : ainsi l’ordinateur PDP II, installé provisoirement en région parisienne devra finalement être confié à l’équipe orléanaise60. Les réseaux de télécommunications, essentiels pour permettre aux chercheurs installés dans le Loiret de poursuivre les échanges de données et de calculs avec d’autres laboratoires parisiens, font l’objet d’une attention particulière. Ainsi, dès 1967, Hiéblot organise, avec le ministère des PTT, des lignes de transmission entre la capitale et Orléans.
Engagé dans le processus de décentralisation, le CNRS et les autorités politiques nationales imposent la réussite du transfert partiel du GRI. Les moyens mobilisés sont à la hauteur d’un enjeu politique qui doit pouvoir constituer, par la suite, l’exemple d’une gestion équilibrée des potentialités scientifiques sur le territoire national. Dans cette perspective, l’implantation à Orléans et les liens avec les structures créées ou déjà présentes sur place sont soigneusement étudiés. Afin de permettre des échanges et de susciter des collaborations, les chercheurs du GRI sont incités à travailler régulièrement au sein de l’Observatoire magnétique de Chambort-la-Forêt et du Centre de Recherches Géophysiques61. Avant la venue du GRI à La Source, « l’Université d’Orléans accueillait une équipe mixte (…) qui développ[ait] des études sur la composition chimique de l’ionosphère (…) »62. L’ancrage local est donc favorisé par une politique d’immersion des chercheurs du GRI dans le campus orléanais. Les liens avec les industriels sont eux activés à travers le Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
Les tensions fortes nées de la scission géographique du GRI entre Orléans et Saint-Maur se sont finalement cristallisées dans la dislocation du laboratoire en 1975 : la structure de Saint-Maur devient le Laboratoire de Géophysique Externe et le Centre de Recherche en Physique de l’Environnement Terrestre rassemble les chercheurs qui travaillaient au GRI à Orléans.
La distribution des compétences spatiales n’est pas donc pas, dans le cas du GRI, strictement liée à la question des recherches spatiales. Elle s’articule ici à des choix politiques larges (i.e. la décentralisation, la volonté du CNRS de s’y inscrire), des options scientifiques décrétées par le CNRS (i.e. la composante géophysique du laboratoire très favorisée) et des opportunités locales (i.e. le maire d’Orléans a fait montre d’un fort volontarisme politique pour créer le campus de La Source).
Conclusion
Les trois cas explorés ici mettent en exergue des logiques d’aménagement du territoire fort différentes. Nous insistons, à la suite de Jacques Lévy, sur le fait qu’elles s’inscrivent dans trois temporalités distinctes de la politique de décentralisation. La période qui s’étend des débuts de la IVe République à la fondation de la DATAR et à laquelle renvoie le transfert du CNES à Toulouse correspond à une réflexion d’ampleur sur les déséquilibres territoriaux. La création du LAM correspond à une période de remise en cause du mouvement décentralisateur, ce qui explique, au moins en partie, l’absence de liens entre la mise en œuvre du laboratoire et les questions d’aménagement du territoire. Enfin, l’arrivée d’une partie du GRI à Orléans, à la fin des années 1960, s’inscrit dans une réflexion accrue sur les développements des villes de province63.
Les genèses, les implantations et les structurations de la recherche spatiale française ne se laissent pas enfermer dans un modèle historique qui décrierait, pour les années 1950 et 1960, les phases repérables d’une distribution géographique concertée des compétences spatiales (entendues comme des potentialités de recherche ventilées dans des espaces distincts). Il n’existe pas une logique monolithe d’aménagement du territoire permettant de dégager une distribution concertée des forces scientifiques de la recherche spatiale. Le transfert ou la création d’institutions liées au spatial ressortissent d’opérations hétérogènes qui, pour certaines s’inscrivent dans des mouvements profonds et politiquement structurés de remodelage du territoire (i.e. Toulouse et Orléans) et qui, pour d’autres (i.e. Marseille) ignorent presque totalement les dispositifs d’aménagement à l’œuvre. Le croisement de l’histoire des recherches spatiales et de l’histoire de la décentralisation permet de déployer l’analyse géo-historique à la fois en direction des processus structurels à long terme et vers les dynamiques conjoncturelles plus brèves et plus labiles.